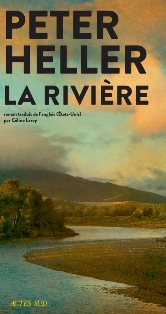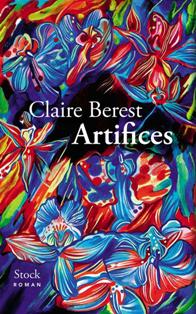J'ai beaucoup aimé
Titre : Murène
Auteur : Valentine GOBY
Editeur : Actes Sud
Parution : 2019
Pages : 384
Présentation de l'éditeur :
Hiver 1956. Dans les Ardennes, François, un jeune homme de vingt-deux
ans, s’enfonce dans la neige, marche vers les bois à la recherche d’un
village. Croisant une voie ferrée qui semble désaffectée, il grimpe sur
un wagon oublié… Quelques heures plus tard une enfant découvre François à
demi mort – corps en étoile dans la poudreuse, en partie calciné.
Quel
sera le destin de ce blessé dont les médecins pensent qu’il ne survivra
pas ? À quelle épreuve son corps sera-t-il soumis ? Qu’adviendra-t-il
de ses souvenirs, de son chemin de vie alors que ses moindres gestes
sont à réinventer, qu’il faut passer du refus de soi au désir de
poursuivre ?
Murène s’inscrit dans cette part d’humanité où
naît la résilience, ce champ des possibilités humaines qui devient,
malgré les contraintes de l’époque – les limites de la chirurgie, le peu
de ressources dans l’appareillage des grands blessés –, une promesse
d’échappées. Car bien au-delà d’une histoire de malchance, ce roman est
celui d’une métamorphose qui nous entraîne, solaire, vers l’émergence du
handisport et jusqu’aux Jeux paralympiques de Tokyo en 1964.
À l’origine du roman, l’image
du champion de natation Zheng Tao jailli hors de l’eau aux Jeux
paralympiques de Rio en 2016, qui flotte en balise cardinale parmi les
remous turquoise. Je contemple l’athlète à la silhouette tronquée, son
sourire vainqueur, sa beauté insolite. Autour, les gradins semi-vides
minorent cette victoire. Je m’aperçois que j’ignore tout de l’histoire
du handisport, ce désir de conformité avec les pratiques du monde valide
en même temps que d’affirmation radicale d’altérité, qui questionne
notre rapport à la norme. À travers le personnage de François,
sévèrement mutilé lors d’un accident à l’hiver 1956, Murène en restitue l’étonnante genèse.
Mes
romans s’attachent souvent à des personnages en résistance, luttant
obstinément contre les obstacles, dont ils viennent à bout. François est
de ceux-là, seulement la volonté ne suffit pas. À une époque où
balbutie encore la rééducation, et où l’appareillage ne parvient pas à
compenser les manques de son corps, l’imagination est encore le plus
puissant recours contre le réel, que François tente de plier à ses
désirs.
Mais Murène est moins
l’histoire d’un combattant que d’un mutant magnifique : la
transformation profonde d’une identité et d’un rapport au monde quand
l’obstacle devient chance de métamorphose. Le handisport en sera
l’artisan, qui substitue alors à l’idée de déficience celle de
potentiel, une révolution du regard et de la pensée. Dans l’eau des
piscines, François devient semblable aux murènes, créatures d’apparence
monstrueuse réfugiées dans les anfractuosités de la roche, mais
somptueuses et graciles aussitôt qu’elles se mettent en mouvement.
L’œuvre
d’Ovide évoque tour à tour les métamorphoses punitives qui emmurent
les êtres et celles qui les délivrent. François connaît l’une puis
l’autre, l’impuissance face à la tragédie que l’existence lui impose,
mais aussi et surtout une mutation patiente, solaire, qui l’ouvre à des
possibles insoupçonnés.
Le mot de l'éditeur sur l'auteur :
Valentine Goby publie depuis quinze ans pour les adultes et pour la jeunesse. Elle reçoit en 2014 treize prix littéraires pour Kinderzimmer,
paru chez Actes Sud. Passionnée par l'histoire et par la transmission,
la mémoire est son terrain d'exploration littéraire essentiel. Murène est son treizième roman.
Avis :
En 1956, un accident laisse François pour mort. Contre toute attente et après un long comas, le jeune homme de vingt-deux ans survit. Mais il est grièvement brûlé et a dû être désarticulé des deux épaules. A la torture de la douleur s’ajoute celle d’une vie à réinventer, malgré le refus de soi et le regard d’autrui, dans l’humiliation de la dépendance et de mille renoncements quotidiens. A cette époque, les possibilités d’appareillage sont extrêmement limitées pour son cas. C’est dans le sport, plus précisément la natation, que François va progressivement retrouver l’estime de soi et le goût de vivre.
Le sujet est grave et ne peut laisser de marbre. Symbolisé avec force par l’image du mannequin Stockman sans épaules, le thème de l’infirmité physique est ici exploré posément et sans pathos, au travers d’un personnage fictif d’un parfait réalisme et d’une lumineuse humanité. Ce livre est d’abord le portrait bouleversant, tout en nuances et sans la moindre complaisance, d’un être dépossédé de ce qui faisait sa vie, son identité sociale et sa dignité humaine, en même temps que de son intégrité corporelle et de ses capacités physiques. Infirme, François sort de la sphère qui était la sienne, pour se retrouver marginalisé sur un bas-côté de la vie. A peine s’il se sent encore considéré comme un humain à part entière, tant seule sa différence tend à le définir dans les regards portés sur lui.
Lorsque François se met en tête d’apprendre à nager sans bras à la fin des années cinquante, personne n’imagine alors que le sport, la compétition et l’exploit puissent être du ressort de personnes estropiées. Son parcours du combattant est l’occasion de retracer l’émergence du handisport et la création des jeux paralympiques, dans une intéressante rétrospective historique qui fait prendre conscience du chemin parcouru depuis. C’est d’ailleurs la médaille d’or et le record mondial du nageur chinois sans bras Tao Zheng, en 2016, qui a servi de déclic à l’écriture de ce roman, clairement sous-tendu par une documentation approfondie.
Ce livre plein d’empathie et d’une grande beauté d’écriture est un magnifique hommage à toutes les personnes souffrant d’infirmités et aux extraordinaires capacités de résilience dont l’espèce humaine sait faire preuve. Si la science n’a pas fini de faire progresser chirurgie et appareillages, du chemin peut aussi être encore parcouru dans l’acceptation et l’oubli de la différence. Alors que la malchance ou la fatalité contraignent certains d’entre nous à faire face au handicap ou à l’infirmité, l’obstacle supplémentaire de la discrimination et de la dévalorisation ne devrait jamais venir alourdir le destin. (4/5)
Citations :
C’est le chirurgien qui le lui a appris, s’adresser aux malades même s’ils sont à demi conscients, même s’ils dorment, même en coma profond. Elle dit qu’elle parle tous les jours à un homme endormi depuis un an, on ne sait jamais s’il y a une brèche, même étroite, si la voix s’y engouffre à la façon d’une eau dans la fissure d’un mur, un goutte-à-goutte patient qui à la fin peut faire écrouler le mur – des métaphores de plombier, elle s’excuse, son père est plombier.
Il décrète le corps étranger à lui-même, il se persuade. Mais la morphine manque, si souvent. Mais le corps ruse et le torture : il n’a pas de phalanges et ses phalanges fourmillent ; il n’a pas de paumes, des décharges électriques les traversent ; la vieille fracture de son pouce droit se réveille, sa montre se fait enclume à son poignet, il n’a ni pouces ni poignets ; il a d’atroces mirages de chairs écrasées tordues à la place des bras. Mais les nuits précédant les pansements sont tunnels de terreur qui anticipent la souffrance, la devancent, la redoublent. Les pansements ont raison de ses fantasmes de mise à distance. Mum écrit sa joie de le savoir conscient, elle n’a pas idée de ce que ses nerfs endurent, du supplice de la chair à l’arrachage des peaux, de l’odeur de charogne dont l’eau de Cologne et l’essence d’eucalyptus ne viennent jamais à bout. Il supplie qu’on le délivre mais on craint la surdose de morphine, les nausées, l’extrême constipation. Quand ils lui accordent enfin du Dolosal, il se rétracte au fond de sa grotte. Il espère le bloc opératoire. Il l’attend, qu’importe ce qu’ils feront du corps dans ce temps mort, l’anesthésie effacera jusqu’à son nom, les vingt et un grammes de conscience qui lui restent, farewell.
Chaque réveil est un cauchemar. Il pense à Grandma à qui la nuit ramenait Jack, son mari, gommait la catastrophe. Le sommeil était une régression heureuse dont la splendeur n’apparaissait pleinement qu’à rebours, au matin, quand Grandma redécouvrait la mort de Jack. Il était re-mort. Elle n’était pas de celles qui dressent le couvert pour l’absent, prient et parlent aux spectres. Le jour, elle savait. La nuit elle oubliait, la blessure se rouvrait à l’aube et cette répétition de la mort n’en atténuait pas la violence. Jack mourait tous les jours. François a des Jack à la place des bras. Tous les jours on ampute François et des fantômes convoquent les manques, histoire qu’il en soit sûr : il est foutu.
Le pire est passé, avait écrit Robert il y a plusieurs semaines, persuadé que survivre était le plus grand défi. Vivre exige un effort colossal.
Il ne pourra plus se brosser les dents, boutonner une chemise, se raser, cirer-lacer-délacer ses chaussures, enduire un mur, pincer la joue de Sylvia, boire une chope, attraper un ballon, écrire une lettre, sculpter un bâton, glisser la clé dans la serrure, déplier le journal, rouler une cigarette, tirer la luge, décrocher le téléphone, se peigner, changer un pneu de vélo, ceinturer son jean, se torcher, payer à la caisse, couper sa viande, se suspendre aux branches, tendre un ticket de métro, héler le bus, applaudir, mimer Elvis à la guitare, signer, serrer une fille contre lui, danser avec une fille, donner la main à une fille, passer les cheveux d’une fille derrière son oreille, dénouer un ruban, toucher l’oreille d’une fille, la cuisse d’une fille, le ventre d’une fille, le sexe d’une fille, son sexe à lui, se pendre, s’ouvrir les veines, se tirer une balle, même se foutre en l’air il ne peut pas. Chaque jour s’allonge la liste des gestes impossibles, si écrasante qu’elle éteint toute résistance, il se résigne aux consignes médicales.
Le plus dur est passé, affirmait Robert.
La science a beau avoir désenchanté les monstres au XIXe siècle, les déclarer œuvres de la nature et non du diable, si on ne les jette plus comme à Sparte dans le gouffre des Apophètes ou comme à Rome au fil du fleuve, il est d’autres bas-fonds où nos yeux les relèguent. Le dégoût. Le rire. La pitié poisseuse qui console de nos propres misères.
Ne vous méprenez pas, on est petits. Tout est à faire. Une poignée de participants pour chaque activité, c’est très confidentiel encore. Le sport pour handicapés est pratiqué quasi exclusivement en rééducation, autrement dit à l’hôpital, exception faite des sourds qui font du sport en club depuis 1918 eux, ils ont une avance considérable… et des aveugles. C’est du sport d’hôpital, donc, et le plus souvent en institution militaire. Après l’hôpital, il n’y a plus de structures d’accueil. Nous voulons les développer.
Les mots franchissent ses lèvres en slogans qui claquent : rétablissement physique, autonomisation, convivialité, confiance en soi, dépassement moral. Et il rappelle la devise de de Lattre qui a porté son engagement contre Hitler : “Ne pas subir.”
— Le but, c’est aussi de reprendre sa place dans la communauté des gens normaux. Vous comprenez ?
De se réintégrer, de refuser l’exclusion sociale. La norme est clairement établie, deux bras deux jambes greffées à un tronc, l’ensemble complètement fonctionnel, plus on s’écarte du modèle dominant plus on glisse vers l’exclusion.
Le voile des mariées. Un fin réseau de mailles, plus d’ajours que de fils. Ce ne sont pas des trous, ce sont des ajours. Le tissu est entier comme il est. Pas d’accrocs à recoudre. La dentelle est pareille. Faite d’ajours. La résille aussi, les filets pour tenir les coiffures, les chignons des danseuses… Je veux être comme le tulle, entier avec mes ajours. Pas de prothèse.
(…) elle évoque sa détestation du mot infirme – celui qu’une incapacité intrinsèque empêche d’agir –, lui préférant handicapé – celui qui a pioché une mauvaise mise, ce qui ne préjuge en rien de ses possibilités réelles, donne une chance au combattant en lui.
— Vous parliez de ghetto en évoquant les jeux de Stoke Mandeville. Vous disiez que vous trouviez dommage que les handicapés soient séparés entre eux de façon si hermétique dans les rencontres sportives en général, médullaires d’un côté, amputés de l’autre si j’ai bien compris… Tout de même, ici, à la piscine, vous ne vous sentez pas dans une sorte de ghetto ? On nagera peut-être un jour avec des tas de paralysés et de polios, des aveugles, des sourds, tout ce que vous voulez… N’empêche, il est énorme le mur qui nous sépare des gens normaux. Vous avez beau dire, on y est, dans le ghetto. Philippe Braque avale une gorgée de bière.
— Vous nageriez avec des valides ?
— Non.
— Vous voyez.
— Quoi ?
— Le ghetto, comme vous dites, ce n’est pas si mal.
— L’entre-soi me déprime.
— Je n’ai pas de solution.
Philippe suce une olive, crache le noyau.
— Les déportés ont des associations. Les anciens combattants ont des associations. Ce qu’ils ont vécu, ils ne peuvent pas le partager avec tout le monde. Ou bien difficilement. Nous c’est pareil.
— On n’en parle pas entre nous, de nos histoires.
— Encore heureux !
— C’est quoi le but alors ?
— Vous n’êtes pas qu’un handicapé, Sandre. Mais vous êtes ça aussi, vous pratiquez le sport avec des handicapés parce que ça vous sécurise. Ça ne fait pas de vous un extraterrestre ni un paria, en tout cas de mon point de vue. Tenez, je fais du sport à l’Amicale mais ma femme et mes gosses ont deux jambes et deux bras, mon patron et mes collègues pareil, je vais au cinéma, au marché comme n’importe qui, en vacances quelquefois, il se trouve que j’ai perdu une jambe, voilà tout. L’Amicale c’est une halte. Mieux, un sas. Pas un cachot.
— Tu nages quoi ?
— La brasse, sur le ventre et le dos. Un peu le crawl.
Robert avait souri :
— Enfin la brasse, le crawl… façon de parler !
François avait fixé son père :
— Comment ça, façon de parler ?
Mum s’était levée, sentant l’air s’électriser, quelqu’un en veut encore ?
— Parce que ce n’est ni de la brasse ni du crawl.
— Ah bon ?
— De la brasse et du crawl sans bras… ttttt.
— Bon, avait coupé Claude, en tout cas c’est bien que tu te bouges. Le sport ça fait circuler le sang.
— Le sport, le sport… avait continué Robert en lui versant du vin. Mettons de l’activité physique. Ce n’est pas du vrai sport.
Pas du vrai sport. La phrase résonnait dans la tête de François qui ne se défendait pas, plus vaincu encore qu’avant de passer à table. Pas un vrai corps, donc pas du vrai sport, la première assertion commandait toutes les autres, pas un vrai frère, pas un vrai fils, un vrai amant, un vrai amoureux, un vrai prof, un vrai ami, un vrai homme. Un handicapé en toutes choses.
Il vient de battre le record du monde en une 1 minute 10 secondes et 84 centièmes. On ne voit plus que le gros plan de son visage crispé par l’effort, et les séquelles d’une rage froide, carnassière. Il tient l’or et le record du monde. “Supercrip !” titreront les journaux, exulteront les commentateurs, l’infirme d’exception, le handicapé génial, le donneur de leçons de vie, le courage fait homme. François Sandre verra un champion. Un guerrier au visage de guerrier. Une image de la puissance. Et il maudira les médias qui louent le handicapé et négligent l’athlète. Au moins célèbrent-ils une forme d’exploit.