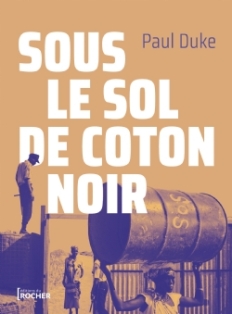J'ai beaucoup aimé
Titre : Tant qu'il y aura des cèdres
(Am Ende bleiben die Zedern)
Auteur : Pierre JARAWAN
Traducteur : Paul WIDER
Parution : en allemand en 2015,
en français en 2020
(Héloïse d'Ormesson)
et 2021 (Le Livre de Poche)
Pages : 496
Présentation de l'éditeur :
Après avoir fui le Liban, les parents de Samir se
réfugient en Allemagne où ils fondent une famille soudée autour de la
personnalité solaire de Brahim, le père. Des années plus tard, ce
dernier disparaît sans explication, pulvérisant leur bonheur. Samir a
huit ans et cet abandon ouvre un gouffre qu'il ne parvient plus à
refermer. Pour sortir de l'impasse, il n'a d'autre choix que de se
lancer sur la piste du fantôme et se rend à Beyrouth, berceau des contes
de son enfance, pour dénicher les indices disséminés à l'ombre des
cèdres.
Voyage initiatique palpitant, Tant qu'il y aura des cèdres révèle la beauté d'un pays qu'aucune cicatrice ne peut altérer. À travers cette quête éperdue de vérité, se dessine le portrait d'une famille d'exilés déchirée entre secret et remord, fête et nostalgie.
Voyage initiatique palpitant, Tant qu'il y aura des cèdres révèle la beauté d'un pays qu'aucune cicatrice ne peut altérer. À travers cette quête éperdue de vérité, se dessine le portrait d'une famille d'exilés déchirée entre secret et remord, fête et nostalgie.
Le mot de l'éditeur sur l'auteur :
Pierre Jarawan est auteur, poète, scénariste et modérateur à Munich où il vit. Fils d’un Libanais et d’une Allemande, il est né en 1985 à Amman en Jordanie. Il est champion de slam depuis plusieurs années en Allemagne. Son premier roman Tant qu’il y a des cèdres a paru aux EHO en 2020.Avis :
Ses parents ayant fui le Liban déchiré par la guerre en 1983, Samir nait l’année suivante en Allemagne. Sa vie y est sereine, jusqu’à ce qu’elle bascule brutalement l’année de ses neuf ans, lorsque, perturbé par une vieille photographie retrouvée, son père quitte leur domicile sans préavis ni explication, pour ne plus jamais donner de ses nouvelles. Devenu adulte, Samir reste obsédé par ce père disparu. Il se rend au Liban pour tenter de retrouver ses traces, passées bien sûr, mais peut-être aussi plus récentes…
Ce livre est bâti sur une obsession : celle d’un fils marqué au plus profond par une blessure d’abandon, incapable de se construire sur cette béance d’autant plus dévastatrice qu’elle s’assortit de la plus noire incompréhension. Pourquoi ce père est-il parti ? Vit-il ailleurs ? Donnera-t-il signe de vie un jour ? Pour Samir, la quête est fondamentale, identitaire même, puisqu’elle le mène inévitablement à ses racines et à la découverte du pays de ses ancêtres. A l’abandon vient se superposer l’exil, dans une surenchère de déchirements accumulés sur plusieurs générations. Et le parcours désespéré de Samir sur les traces ténues de son père disparu devient inévitablement un cheminement initiatique, au plus près d’un passé où se mêlent drames familiaux et histoire du Liban.
Très vite attaché aux personnages, le lecteur partage bientôt le besoin de savoir de Samir et se retrouve suspendu aux incertitudes de sa quête. Peu à peu, au hasard des rencontres et des fatalités qui vont paver son chemin non sans émotion ni poésie, Samir découvre ce que fut la vie de ses parents au Liban, en même temps qu’il prend la mesure de ce pays et qu’il s’imprègne de ses parfums, de sa chaleur et de ses drames. Se révèle ainsi, au fil des pages, l’âme de ce territoire si particulier du Proche-Orient, qui, de la trépidante Beyrouth aux rudes montagnes enneigées abritant des cèdres millénaires, se vit progressivement impliqué dans le conflit israélo-palestinien dès la fin des années soixante, bascula dans une guerre civile interconfessionnelle, se retrouva occupé par la Syrie, plus tard en guerre contre Israël, et toujours dans une grande instabilité politique. C’est bien sûr le coeur serré que le lecteur projette les personnages dans l’actualité libanaise postérieure à la narration…
Avec ses protagonistes tous plus attachants les uns que les autres, son exploration humaine, sensible et poétique de l’identité libanaise et des affres de sa diaspora, ce récit s’avère captivant, autant pour la tension romanesque qui le traverse, que pour sa vivante et instructive peinture du Liban contemporain. Un premier roman magnifique, sur l’exil, l’identité et la filiation. (4/5).
Ce livre est bâti sur une obsession : celle d’un fils marqué au plus profond par une blessure d’abandon, incapable de se construire sur cette béance d’autant plus dévastatrice qu’elle s’assortit de la plus noire incompréhension. Pourquoi ce père est-il parti ? Vit-il ailleurs ? Donnera-t-il signe de vie un jour ? Pour Samir, la quête est fondamentale, identitaire même, puisqu’elle le mène inévitablement à ses racines et à la découverte du pays de ses ancêtres. A l’abandon vient se superposer l’exil, dans une surenchère de déchirements accumulés sur plusieurs générations. Et le parcours désespéré de Samir sur les traces ténues de son père disparu devient inévitablement un cheminement initiatique, au plus près d’un passé où se mêlent drames familiaux et histoire du Liban.
Très vite attaché aux personnages, le lecteur partage bientôt le besoin de savoir de Samir et se retrouve suspendu aux incertitudes de sa quête. Peu à peu, au hasard des rencontres et des fatalités qui vont paver son chemin non sans émotion ni poésie, Samir découvre ce que fut la vie de ses parents au Liban, en même temps qu’il prend la mesure de ce pays et qu’il s’imprègne de ses parfums, de sa chaleur et de ses drames. Se révèle ainsi, au fil des pages, l’âme de ce territoire si particulier du Proche-Orient, qui, de la trépidante Beyrouth aux rudes montagnes enneigées abritant des cèdres millénaires, se vit progressivement impliqué dans le conflit israélo-palestinien dès la fin des années soixante, bascula dans une guerre civile interconfessionnelle, se retrouva occupé par la Syrie, plus tard en guerre contre Israël, et toujours dans une grande instabilité politique. C’est bien sûr le coeur serré que le lecteur projette les personnages dans l’actualité libanaise postérieure à la narration…
Avec ses protagonistes tous plus attachants les uns que les autres, son exploration humaine, sensible et poétique de l’identité libanaise et des affres de sa diaspora, ce récit s’avère captivant, autant pour la tension romanesque qui le traverse, que pour sa vivante et instructive peinture du Liban contemporain. Un premier roman magnifique, sur l’exil, l’identité et la filiation. (4/5).
Citations :
– Les cèdres sont menacés. Les gardiens veillent à leur santé, procèdent à des reboisements et s’occupent du parc existant. Et, comme tous les gardiens, ils doivent aussi s’opposer aux intrus.
– À savoir ?
– Les bergers.
– Les bergers ?
– Absolument. Ils font paître leurs troupeaux sur les zones de reboisement, car l’extension des forêts diminue leurs pâturages. Et leurs chèvres mangent les jeunes plants.
Son regard se promène parmi les arbres.
– Mon père a rejoint les rangs des gardiens des cèdres après la guerre. (…)
Les arbres sont si énormes, si majestueux. Il semble inconcevable qu’ils puissent un jour ne plus se dresser en ces lieux.
– La plus grande menace, c’est le changement climatique, dit Nabil, qui semble décidément lire dans mes pensées. L’altitude idéale pour les cèdres se situe entre mille deux cents et mille huit cents mètres.
– À quelle altitude sommes-nous ici ?
– Environ mille quatre cents mètres. Autrefois, c’était parfait, la neige tombait régulièrement et tenait longtemps au sol, qui restait des mois durant froid et humide. Sans le froid, les cèdres ne peuvent germer, ce qui signifie…
Il me guette comme un professeur attendant une réponse.
– Ce qui signifie que leur habitat naturel se trouve à des altitudes de plus en plus élevées, complété-je.
– Exactement, approuve Nabil. Mais les monts du Liban ne se hissent pas à l’infini. S’il ne pleut pas l’été, et que les arbres ne peuvent même plus tirer un minimum d’humidité de la brume printanière, alors tôt ou tard il n’y aura plus de cèdres.
Cette perspective me bouleverse. À mes yeux, le Liban est indissociable de ces géants.
– Quelle splendeur ! dis-je plus pour moi-même que pour mon compagnon. Ils sont identiques à ceux sur le drapeau.
De nouveau, Nabil opine.
– C’est pourquoi nous disons parfois qu’ils ont « la forme du drapeau ». L’eau du sol ne peut nourrir l’arbre que jusqu’à une certaine hauteur.
Il observe la cime de l’arbre devant nous.
– De huit à dix mètres, environ. Ensuite, le sommet meurt et le cèdre commence à prendre son allure caractéristique.
Il dessine dans l’air les branches se superposant horizontalement. Nous parcourons un moment les prairies et les sentiers étroits. J’essaie d’imaginer ce qui arrivera peut-être un jour – l’herbe haute et sauvage, les cèdres desséchés voire exterminés. En levant les yeux, on ne découvrirait plus de sommets enneigés, rien que des éboulis et des roches blanches. Qu’est-ce que cela signifierait, pour ce pays qui a fondé sur cet arbre son identité et même son nom – le pays des cèdres ? Le cèdre est partout ici, sur les timbres, les billets de banque. Le Liban, un pays sans nom ?
– Ne prenez pas cet air bouleversé, dit Nabil en me tapant sur l’épaule. Quand le dernier cèdre disparaîtra, il y a longtemps que nous ne serons plus là. Ces arbres sont beaucoup plus endurants que nous. Il se pourrait aussi que la mer reprenne possession de la côte et que tout retourne ici à son état préhistorique.
Il éclate d’un rire insouciant. Aussi curieux que cela puisse paraître, l’idée que les humains ne verront pas mourir les cèdres a quelque chose de rassurant.
– À savoir ?
– Les bergers.
– Les bergers ?
– Absolument. Ils font paître leurs troupeaux sur les zones de reboisement, car l’extension des forêts diminue leurs pâturages. Et leurs chèvres mangent les jeunes plants.
Son regard se promène parmi les arbres.
– Mon père a rejoint les rangs des gardiens des cèdres après la guerre. (…)
Les arbres sont si énormes, si majestueux. Il semble inconcevable qu’ils puissent un jour ne plus se dresser en ces lieux.
– La plus grande menace, c’est le changement climatique, dit Nabil, qui semble décidément lire dans mes pensées. L’altitude idéale pour les cèdres se situe entre mille deux cents et mille huit cents mètres.
– À quelle altitude sommes-nous ici ?
– Environ mille quatre cents mètres. Autrefois, c’était parfait, la neige tombait régulièrement et tenait longtemps au sol, qui restait des mois durant froid et humide. Sans le froid, les cèdres ne peuvent germer, ce qui signifie…
Il me guette comme un professeur attendant une réponse.
– Ce qui signifie que leur habitat naturel se trouve à des altitudes de plus en plus élevées, complété-je.
– Exactement, approuve Nabil. Mais les monts du Liban ne se hissent pas à l’infini. S’il ne pleut pas l’été, et que les arbres ne peuvent même plus tirer un minimum d’humidité de la brume printanière, alors tôt ou tard il n’y aura plus de cèdres.
Cette perspective me bouleverse. À mes yeux, le Liban est indissociable de ces géants.
– Quelle splendeur ! dis-je plus pour moi-même que pour mon compagnon. Ils sont identiques à ceux sur le drapeau.
De nouveau, Nabil opine.
– C’est pourquoi nous disons parfois qu’ils ont « la forme du drapeau ». L’eau du sol ne peut nourrir l’arbre que jusqu’à une certaine hauteur.
Il observe la cime de l’arbre devant nous.
– De huit à dix mètres, environ. Ensuite, le sommet meurt et le cèdre commence à prendre son allure caractéristique.
Il dessine dans l’air les branches se superposant horizontalement. Nous parcourons un moment les prairies et les sentiers étroits. J’essaie d’imaginer ce qui arrivera peut-être un jour – l’herbe haute et sauvage, les cèdres desséchés voire exterminés. En levant les yeux, on ne découvrirait plus de sommets enneigés, rien que des éboulis et des roches blanches. Qu’est-ce que cela signifierait, pour ce pays qui a fondé sur cet arbre son identité et même son nom – le pays des cèdres ? Le cèdre est partout ici, sur les timbres, les billets de banque. Le Liban, un pays sans nom ?
– Ne prenez pas cet air bouleversé, dit Nabil en me tapant sur l’épaule. Quand le dernier cèdre disparaîtra, il y a longtemps que nous ne serons plus là. Ces arbres sont beaucoup plus endurants que nous. Il se pourrait aussi que la mer reprenne possession de la côte et que tout retourne ici à son état préhistorique.
Il éclate d’un rire insouciant. Aussi curieux que cela puisse paraître, l’idée que les humains ne verront pas mourir les cèdres a quelque chose de rassurant.
– Il n’existe qu’une université publique au Liban. C’est là que vont tous ceux qui n’ont pas de bourse et ne peuvent se permettre d’aller dans le privé. Mais elle n’a pas le niveau des autres. On raconte que les professeurs manquent des cours sans s’excuser, ou qu’ils mettent des mois à corriger les copies de fin d’année. Seules les universités privées dispensent un enseignement digne de ce nom.
– Et elles sont très chères ?
– Pouah ! lance-t-il en agitant la main comme s’il s’était brûlé. Une année dans une université moyenne coûte environ dix mille dollars. Certains parents mendient pour y envoyer leurs enfants, tu imagines ?
– Ils mendient ?
– D’autres tentent de marchander avec les universités comme au souk, et beaucoup d’établissements privés proposent des rabais en fonction des notes. Les bons étudiants paient moins cher. Il n’empêche, les études coûtent une fortune. Sais-tu ce que font les pères ? Ils partent travailler dans les États du Golfe, où ils gagnent dix fois plus, à Dubaï, à Abou Dhabi ou au Qatar. Grâce à cet argent, ils financent les études de leurs enfants au Liban. Et quand ces derniers réussissent leurs examens, ils vont à leur tour dans les pays du Golfe, ou en Europe, du moins s’ils en ont les capacités.
– Et elles sont très chères ?
– Pouah ! lance-t-il en agitant la main comme s’il s’était brûlé. Une année dans une université moyenne coûte environ dix mille dollars. Certains parents mendient pour y envoyer leurs enfants, tu imagines ?
– Ils mendient ?
– D’autres tentent de marchander avec les universités comme au souk, et beaucoup d’établissements privés proposent des rabais en fonction des notes. Les bons étudiants paient moins cher. Il n’empêche, les études coûtent une fortune. Sais-tu ce que font les pères ? Ils partent travailler dans les États du Golfe, où ils gagnent dix fois plus, à Dubaï, à Abou Dhabi ou au Qatar. Grâce à cet argent, ils financent les études de leurs enfants au Liban. Et quand ces derniers réussissent leurs examens, ils vont à leur tour dans les pays du Golfe, ou en Europe, du moins s’ils en ont les capacités.
La femme qui nous a accueillis a déclaré s’appeler May. Comme motif de notre visite, j’ai dit : « Je suis un parent », ce qui m’a valu un coup d’œil sceptique. Elle n’est toujours pas revenue. Je regarde Nabil d’un air interrogateur.
– Une Sri-Lankaise, explique-t-il. C’est l’usage dans les classes supérieures libanaises.
– J’aurais pensé qu’elle était d’origine africaine.
Il hausse les épaules.
– Ça a commencé dans les années cinquante et soixante, quand le pays prospérait, surtout d’un point de vue économique. Aujourd’hui encore, quand on a un certain standing, il faut avoir une domestique. La plupart venaient du Sri Lanka, autrefois. Du coup, forts de l’indécence que procure l’argent, les riches en ont fait une expression courante. Je conduisais un homme d’affaires un jour, et sais-tu ce qu’il m’a dit ? « Nous avons maintenant une Sri-Lankaise qui vient d’Angola. » Invraisemblable, pas vrai ?
– Beaucoup d’agences de voyage se sont spécialisées dans les mariages civils à Chypre. On arrive le matin, on passe à la mairie, on officialise le mariage à l’ambassade, on fait un crochet l’après-midi par la chambre d’hôtel et on rentre le soir.
– Mais pourquoi ?
– Parce qu’il n’y a pas d’alternative sur le marché libanais. Le mariage civil est impossible ici, et les mariages religieux ne peuvent être célébrés qu’entre personnes de même confession.
– Combien de couples interreligieux veulent se marier ?
– De plus en plus. C’est un sujet d’actualité, surtout chez les jeunes.
– Et les dirigeants religieux y voient une menace ?
– C’est tout le problème. Le sujet divise énormément. S’ils n’ont plus leur mot à dire dans les mariages, leur autorité sera amoindrie. Dans un pays comme le nôtre ? Impossible !
– Pourquoi ne pourrait-on pas autoriser à la fois le mariage civil et le mariage religieux ?
– Parce que ce serait un compromis. Et ces gens n’aiment pas les compromis. Il y a eu cette affaire qui a fait grand bruit dans les médias. Il existe une loi de 1936, un vestige de l’époque du mandat français, avant l’indépendance, qui autorise le mariage civil au Liban, à condition que les deux époux n’appartiennent à aucune religion. Un couple a fait effacer son appartenance religieuse dans le registre des naissances afin de pouvoir en bénéficier. Lui était sunnite, elle chiite. Ç’a été un beau bordel. Le ministre de l’Intérieur a dû statuer sur la légalité de leur union.
– Mais pourquoi ?
– Parce qu’il n’y a pas d’alternative sur le marché libanais. Le mariage civil est impossible ici, et les mariages religieux ne peuvent être célébrés qu’entre personnes de même confession.
– Combien de couples interreligieux veulent se marier ?
– De plus en plus. C’est un sujet d’actualité, surtout chez les jeunes.
– Et les dirigeants religieux y voient une menace ?
– C’est tout le problème. Le sujet divise énormément. S’ils n’ont plus leur mot à dire dans les mariages, leur autorité sera amoindrie. Dans un pays comme le nôtre ? Impossible !
– Pourquoi ne pourrait-on pas autoriser à la fois le mariage civil et le mariage religieux ?
– Parce que ce serait un compromis. Et ces gens n’aiment pas les compromis. Il y a eu cette affaire qui a fait grand bruit dans les médias. Il existe une loi de 1936, un vestige de l’époque du mandat français, avant l’indépendance, qui autorise le mariage civil au Liban, à condition que les deux époux n’appartiennent à aucune religion. Un couple a fait effacer son appartenance religieuse dans le registre des naissances afin de pouvoir en bénéficier. Lui était sunnite, elle chiite. Ç’a été un beau bordel. Le ministre de l’Intérieur a dû statuer sur la légalité de leur union.
– Mais… je veux dire, combien existe-t-il de groupes religieux au Liban ? Dix-sept ?
– Dix-huit.
– Dix-huit. Pourquoi n’y voit-on pas une chance et ne permet- on pas des mariages mixtes ? Ce serait un pas décisif. Imagine un Liban où des enfants auraient une grand-mère sunnite et l’autre maronite, et un grand-père chiite et l’autre druze !
– Je vois où tu veux en venir…
– Comment un tel enfant pourrait-il éprouver de la haine pour les membres d’autres religions ? Une telle loi ne permettrait-elle pas de rassembler enfin les diverses minorités ? D’en faire une nation ? Est-ce que ce ne serait pas révolutionnaire ?
– Oui, révolutionnaire, a dit Nabil d’un ton mélancolique. Mais c’est justement ce que redoutent les politiciens, aussi veulent-ils éviter à tout prix un tel changement. Ici, politique et religion ne font qu’un. La paix dont tu rêves est le cauchemar de tous les chefs religieux. Il faut qu’un pays soit divisé pour qu’on les écoute encore…
– C’est un Syrien, dit Nabil. Un enfant de réfugiés.
– Comment le sais-tu ?
– La corniche en est remplie. Surtout dans les rues avec des bars et des restaurants.
Nabil me désigne un vendeur qui tente de fourguer des lunettes de soleil à un couple. L’homme les essaie, mais sa compagne secoue la tête, visiblement sceptique.
– Ce sont tous des réfugiés. Ce garçon est peut-être seul ici, ou avec sa mère. La plupart des réfugiés syriens sont des femmes avec leurs enfants. Soit leurs maris se battent contre Assad, soit ils sont morts, soit ils ont fui dans un autre pays où il est plus facile de trouver du travail afin de pouvoir envoyer de l’argent à leurs épouses. Et les enfants doivent participer à l’effort s’ils veulent s’en sortir.
J’en ai entendu parler aux informations. Le Liban a accueilli plus d’un million de réfugiés, pour une population d’à peine quatre millions d’habitants.
– Ils logent dans les vieux camps, où il y a aussi beaucoup de Palestiniens. Tu sais, dans la périphérie. Sinon, ils habitent dans la ville même, dans des endroits misérables, sans eau courante ni électricité.
– Quelle est l’attitude des Libanais envers eux ?
– Il est difficile de parler des Libanais en général. Les Allemands ont-ils un problème avec les réfugiés dans leur pays ?
– Certains, oui.
Nabil me regarde.
– L’Allemagne a combien d’habitants ?
– Environ quatre-vingts millions. Il fronce les sourcils. – Dans ce cas, il faudrait que vous accueilliez dix-neuf millions de réfugiés pour parvenir au même niveau que nous.
– Comment le sais-tu ?
– La corniche en est remplie. Surtout dans les rues avec des bars et des restaurants.
Nabil me désigne un vendeur qui tente de fourguer des lunettes de soleil à un couple. L’homme les essaie, mais sa compagne secoue la tête, visiblement sceptique.
– Ce sont tous des réfugiés. Ce garçon est peut-être seul ici, ou avec sa mère. La plupart des réfugiés syriens sont des femmes avec leurs enfants. Soit leurs maris se battent contre Assad, soit ils sont morts, soit ils ont fui dans un autre pays où il est plus facile de trouver du travail afin de pouvoir envoyer de l’argent à leurs épouses. Et les enfants doivent participer à l’effort s’ils veulent s’en sortir.
J’en ai entendu parler aux informations. Le Liban a accueilli plus d’un million de réfugiés, pour une population d’à peine quatre millions d’habitants.
– Ils logent dans les vieux camps, où il y a aussi beaucoup de Palestiniens. Tu sais, dans la périphérie. Sinon, ils habitent dans la ville même, dans des endroits misérables, sans eau courante ni électricité.
– Quelle est l’attitude des Libanais envers eux ?
– Il est difficile de parler des Libanais en général. Les Allemands ont-ils un problème avec les réfugiés dans leur pays ?
– Certains, oui.
Nabil me regarde.
– L’Allemagne a combien d’habitants ?
– Environ quatre-vingts millions. Il fronce les sourcils. – Dans ce cas, il faudrait que vous accueilliez dix-neuf millions de réfugiés pour parvenir au même niveau que nous.
Mais pour revenir à ta question, bien sûr que certains Libanais s’opposent à l’afflux de réfugiés. Les Syriens restent un sujet sensible dans ce pays. Voilà moins de dix ans que leurs soldats sont partis, et maintenant ce sont leurs civils qui arrivent. L’armée syrienne n’est pas franchement appréciée par ici. Pour une bonne partie des Libanais, les Syriens représentent des années d’oppression et de brimades. Sans compter qu’il est tout à fait plausible que les Syriens aient assassiné Hariri, l’affaire n’est pas encore résolue. Nous aimions tous Hariri. Le gouvernement libanais est divisé en deux camps : d’un côté les sunnites et les chrétiens, de l’autre le Hezbollah. Les sunnites fournissent des armes et des munitions à l’opposition en Syrie, tandis que le Hezbollah la combat au côté d’Assad. Tu comprends ? Au fond, la guerre civile libanaise s’est déplacée de l’autre côté de la frontière. Tu vois toujours les mêmes aux informations, couchés sur des couvertures dans des camps et ainsi de suite. Mais il y a aussi quantité de riches Syriens qui ont fui et louent des étages entiers d’hôtels, ainsi que ces penthouses que tu vois ici.
Il pointe du doigt les immeubles en face de nous.
– Ils sont nombreux, mais ils n’apparaissent pas dans les statistiques des réfugiés. Ces Syriens appartiennent à une autre catégorie. Pour eux, c’est aussi simple que s’ils rentraient chez eux.
– Chez eux ?
– Beaucoup de Syriens considèrent le Liban comme une partie d’une grande Syrie. À leurs yeux, nous ne sommes jamais devenus indépendants. Si tu les interroges, ils te disent qu’ils se sont juste un peu rapprochés de la mer.
Il pointe du doigt les immeubles en face de nous.
– Ils sont nombreux, mais ils n’apparaissent pas dans les statistiques des réfugiés. Ces Syriens appartiennent à une autre catégorie. Pour eux, c’est aussi simple que s’ils rentraient chez eux.
– Chez eux ?
– Beaucoup de Syriens considèrent le Liban comme une partie d’une grande Syrie. À leurs yeux, nous ne sommes jamais devenus indépendants. Si tu les interroges, ils te disent qu’ils se sont juste un peu rapprochés de la mer.