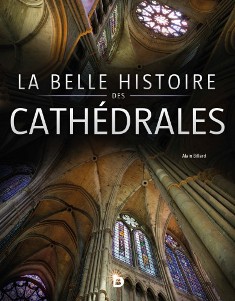Coup de coeur 💓
Titre : Le ciel de Lima (El cielo de Lima)
Auteur : Juan GOMEZ BARCENA
Traducteur : Thomas EVELLIN
Parution : en espagnol en 2014,
en français (Baromètre) en 2020
Pages : 336
Présentation de l'éditeur :
Lima, 1904. Deux jeunes bourgeois épris de littérature partagent la
même passion pour l’écrivain Juan Ramón Jiménez. Frustrés de ne pouvoir
se procurer le dernier recueil du célèbre poète espagnol, ils se
décident à lui écrire en se faisant passer pour une admiratrice du nom
de Georgina Hübner. D’un simple canular naîtra une correspondance entre
le futur prix Nobel de littérature et cette muse singulière. Histoire
d’une vaste supercherie, entre fresque historique et fantaisie
littéraire.
Inspiré d’une anecdote réelle, le roman de Juan Gómez Bárcena nous
plonge dans le quotidien tumultueux de la capitale péruvienne alors
marquée par la crise, les grèves prolétariennes et la répression
policière. Au milieu de ce chaos, deux apprentis poètes en quête de
reconnaissance cherchent pourtant leurs mots… Un récit plein d’ironie
dans lequel se dresse un subtil tableau de la société liménienne du
début du XXe siècle.
Le mot de l'éditeur sur l'auteur :
Publié en Espagne en 2014, Le Ciel de Lima est le premier
ouvrage de Juan Gómez Bárcena traduit en français. Né en 1984 à
Santander, il est l’auteur d’un recueil de nouvelles et de trois romans.
L’année de sa parution en Espagne, Le Ciel de Lima a obtenu
divers prix, dont le « Premio Ojo Crítico de Narrativa » attribué par la
Radio nationale espagnole, et a terminé finaliste du prix du Festival
du premier roman de Chambéry.
Avis :
A Lima en 1904, deux jeunes bourgeois se piquent de littérature et de poésie. Pressés de se procurer l’introuvable dernier recueil de leur maître à penser, le célèbre écrivain espagnol Juan Ramón Jiménez, ils entreprennent de lui écrire en se faisant passer pour une admiratrice. Une correspondance assidue se met en place entre le poète et cette muse inventée sur mesure…
Peu connu en France, Juan Ramón Jiménez est pourtant une figure majeure de la poésie hispanique, consacrée en 1956 par le prix Nobel de littérature. Il est donc la personnalité idéale pour incarner les fantasmes de deux jeunes apprentis écrivains péruviens en quête de reconnaissance, imaginés par l’auteur à partir d’une anecdote réelle. Le résultat est un petit bijou de fantaisie et d’humour que Juan Gómez Bárcena nous cisèle avec un plaisir perceptible, entre fresque historique et comédie pétillante, intelligemment troussée sur le thème de l’inspiration et de la création romanesque.
Tandis qu’outre-Atlantique, le grand homme de lettres se pique au jeu d’une correspondance qu’il croit authentique, la petite supercherie, conçue pour approcher leur idole, ouvre bientôt des perspectives inespérées à l’orgueil des deux jeunes manipulateurs. Si cette Georgina Hübner qu’ils ont inventée réussissait à séduire le poète, ne finirait-il par par lui dédier quelques poèmes inédits, qu’ils pourraient se vanter de lui avoir inspiré ? Voici donc les deux compères engagés dans ce qui devient une véritable entreprise de création littéraire, centrée sur un personnage qu’il leur faut apprendre à incarner avec la plus grande justesse. Georgina, en qui ils investissent de plus en plus de leurs projections personnelles, s’impose peu à peu comme une créature qu’ils ne parviennent plus totalement à modeler à leur guise. Si elle est une part d’eux-mêmes, elle leur impose aussi sa cohérence intrinsèque et les entraîne dans des développements qui pourraient bien les dépasser. De la comédie à la tragédie, il n’y a qu’un pas.
Bluffante satire de la soif de reconnaissance de l'écrivain et de sa relation à son œuvre et à ses personnages, Le ciel de Lima ne restreint toutefois pas le champ de son ironie à ses réflexions sur les détours de la création littéraire. Tout roman se nourrit d’un ressenti et, par conséquent, d’un fond de réalité. Georgina est ainsi directement issue du vécu de ses deux auteurs, dans un environnement lui aussi restitué par Juan Gómez Bárcena dans ses contradictions les plus subtiles. Et c’est avec la même finesse souvent savoureuse que l’auteur brocarde la société de Lima à l’orée du XXe siècle, quand, sous les yeux à peine curieux d’une bourgeoisie plus préoccupée de ses alliances matrimoniales entre aristocrates ruinés et nouveaux riches pressés de dorer d’un blason leur complexe d’un sang parfois mêlé, la misère jette sans recours les filles du peuple dans la prostitution et les ouvriers dans des grèves violemment réprimées.
Ce roman de Juan Gómez Bárcena s’est révélé un succès en Espagne, récompensé par plusieurs prix. Il n’était que temps de le découvrir enfin, superbement traduit en français. Coup de coeur. (5/5)
Citations :
Vous arrive-t-il, à vous aussi, en observant le monde, d’avoir le sentiment qu’il est fait de la matière découlant de vos lectures ? Ne retrouvez-vous pas parmi les passants les personnages de certains romans, les créatures de certains auteurs, les crépuscules de certains poèmes ? Avez-vous parfois l’impression de lire la vie comme on tournerait les pages d’un livre ?
Car, certes, ils n’ont pas de muse et n’accoucheront sans doute jamais d’un poème parfait, et alors, qu’importe, après tout ? Eux, Carlos Rodriguez et José Galvez Barrenechea, ont peut-être été promis à un destin plus noble encore : créer, à partir du néant, la beauté qu’un autre poète célèbrera. Et qui sait, poursuit-il dans sa lancée, peut-être s’agit-il là d’une autre forme de poème parfait, la seule véritablement transcendante : modeler l’argile des mots et lui ordonner de se lever et de marcher. Etre comme Dieu le Père, créateur de toute chose : il oserait bien la comparaison si cela n’était pêché de le dire et même de le penser. Ils sont en train de donner vie à la muse dont Juan Ramon doit tomber amoureux, et cette possible histoire, cette aventure tumultueuse, ce fragment de vie à mi-chemin entre la réalité et la fiction, ce sera leur roman. Et si, un jour, le Maître en vient à écrire un poème sur le feu de cet amour, ne serait-ce qu’un seul, ils sauront secrètement qu’ils ont été capables d’atteindre ce qu’il y a de plus difficile, car toute la beauté de ce poème leur appartiendra davantage que s’ils ne l’avaient eux-mêmes écrit.
La vie des grands de ce monde commence par leur naissance, voire avant, c’est-à-dire par les exploits de leurs ancêtres dont ils ont hérité le nom et les titres. Les modestes, en revanche, en viennent au monde que beaucoup plus tard, quand ils ont les mains pour travailler et les reins pour supporter certains fardeaux. La plupart d’entre eux ne naissent jamais. Ils restent invisibles toute leur vie, nichés dans des coins miteux ignorés par l’Histoire.
Les écrivains publics n’ont ni supérieur ni horaires imposés. Quand ils veulent être pompeux, ils s’autoproclament « secrétaire public » : ce qui revient à dire qu’ils n’ont pour seul bureau que la rue. Ils occupent un coin sous les arcades de la place, y installent chaque matin leur pupitre branlant et attendent que les clients viennent solliciter leurs services. On les appelle aussi « les évangélistes » car, comme ceux du Nouveau Testament, ils transcrivent ce que d’autres leur dictent. (…)
En dehors des analphabètes, de jeunes gens ont également recours à ses services pour trouver les galanteries capables de séduire celui ou celle pour qui leur coeur flanche. Et quand cela arrive, Cristobal ne se contente pas d’être un évangéliste, il devient le poète qui imagine à quel genre de personne il adressera ses vers : ces mots posés sur les élans amoureux de leur jeune prétendant(e).
Une fois sa journée terminée, il s’amuse à viser la corbeille en osier avec ses brouillons chiffonnés. Il les réutilisera ensuite pour allumer le réchaud de la cuisine. Il plaisante souvent à ce sujet : il dit qu’en hiver ce sont les amours des autres qui le réchauffent, des amours dont le feu est éphémère ; un feu qui brûle vite, mais qui ne dégage pas plus de chaleur qu’il ne laisse de cendres.
En repliant la dernière lettre, Cristobal retire simplement ses lunettes, allume un havane et leur demande s’ils ont déjà vu une tapada liméenne. (…)
« J’ai eu la chance de voir les dernières d’entre elles quand j’étais enfant, il y a bien longtemps. La mode à la française était déjà bien répandue : les crinolines, les corsets… et peu de femmes continuaient de porter l’ancienne tenue coloniale. C’était beau à voir… Une longue jupe tombant jusqu’aux chevilles, si étroite qu’il était difficile de mettre un pied devant l’autre, et sur le dos, un manteau plissé qui avait un je-ne-sais-quoi de voile mauresque et couvrait le buste ainsi que toute la tête, ne laissant visible qu’une frange du visage : une fissure de soie au travers de laquelle on n’entrevoyait qu’un seul œil… Et vous savez pourquoi ces femmes gardaient cet œil à découvert ?
- Pour voir où elles mettaient les pieds ? Dit José en riant.
- Par coquetterie, répond Carlos en coupant court à la plaisanterie.
- Tout à fait. Et vous ne croyez pas que les hommes auraient été plus attirés si elles avaient découvert davantage de parties de leur visage ou de leur corps ?
- Non, répond Carlos aussitôt.
- Et pourquoi donc ?
- Parce que ce que l’on montre à moitié est toujours plus suggestif que ce que l’on dévoile totalement, professeur.
- Et auraient-elles été plus séduisantes si elles n’avaient rien montré du tout, si elles avaient été bandées de la tête aux pieds, comme les momies de l’Ancienne Egypte ?
- Sans doute pas, répond-il prudemment. Car tout montrer est aussi peu séducteur que de ne rien montrer du tout. »
Le professeur Cristobal tape si fort de la main sur son pupitre qu’il en perd presque son cigare.
« Exactement ! Même vous, qui êtes de petits bleus en la matière, vous qui sortez à peine des jupes de vos mères, vous comprenez cette règle de base, n’est-ce-pas ? L’amour est une porte entrouverte, un secret qui ne survit que lorsqu’on le dévoile à moitié. Cet œil coquin, c’était l’hameçon avec lequel les femmes de Lima partaient pêcher dans les rues, l’appât qui faisait tomber les hommes comme des mouches. Vous avez entendu parler du langage de l’éventail et du foulard ? Combien de mots d’amour pouvait lancer une femme sans même ouvrir la bouche ? C’était la même chose avec les clins d’oeil des tapadas. Un battement de paupière prolongé voulait dire : je suis à vous. Deux battements courts : je vous désire, mais je ne suis pas libre. Un long, un court... »
On n’écrit pas autrement qu’en parlant de soi-même, y compris quand on écrit au nom d’un autre. A mon sens, tout ce que j’écris dans mes lettres est vrai. La seule chose qui peut être fausse, ce sont les noms de ceux qui les signent…
L’amour n’existe que lorsqu’on a les mots pour le dire. L’amour, c’est du discours, mon jeune ami, comme dans les feuilletons ou les romans. C’est quelque chose qu’on ne peut pas comprendre, ou alors à moitié, si on ne l’a pas écrit quelque part, dans sa tête, sur le papier, qu’importe. N’allez pas confondre les sensations et les sentiments…
- Mais, vous…
- Moi, je suis là pour écrire. C’est justement pour ça que l’on vient me voir. Sans ça, tous ces jeunes galants ne seraient pas prêts à faire la queue sous un soleil de plomb. Ils viennent me voir pour que je mette des mots sur ce qu’ils ressentent, pour que je leur apprenne l’amour et ses mystères. Voilà comment ça marche. Le plus important, ce n’est pas tant de satisfaire le destinataire – que je ne connais pas, après tout -, mais le client, celui qui vient me voir en quête d’amour comme le lecteur dévoué court chercher le dernier épisode de son roman-feuilleton. Et plus, l’histoire que je leur invente est déchirante. Plus je m’épanche sur leurs malheurs, plus ils sont heureux. Vous n’imaginez pas la joie qu’ils ont à vivre toutes ces nouvelles choses, ce bonheur qu’ils ont à ressentir véritablement cet amour ! Voilà pourquoi ils viennent me voir. Et il en va de même pour les destinataires. Eux aussi veulent qu’on leur raconte une belle histoire et sont disposés à tomber amoureux de qui voudra bien la leur écrire. Ils lisent la lettre qu’ils reçoivent comme on se regarde dans un miroir : si ce qu’ils voient leur plaît, c’est dans la poche. Et qui sait ? S’ils se marient un jour, ils reliront peut-être leurs lettres, le soir, au coin du feu, se souvenant de leurs premiers émois, croyant avoir vécu une histoire d’amour passionnelle que j’ai écrite pour eux... »
Détrompez-vous, cher ami, l’amour, tel que vous l’entendez, a été inventé par la littérature, tout comme Goethe a offert le suicide aux Allemands. Ce n’est pas nous qui écrivons des romans, ce sont les romans qui nous écrivent…
Il a vingt ans. A son âge, son père gagnait déjà sa vie dans les plantations de caoutchouc, sa mère était mariée et sur le point d’accoucher, sans parler du grand-père Rodriguez qui mourut avant même d’atteindre cet âge, laissant une veuve et deux orphelins sans les douze sols que coûtait le cercueil. « Les hommes ne sont plus ce qu’ils étaient, dit souvent don Augusto. Ceux d’aujourd’hui n’ont pas la même trempe. A vingt ans, ils pensent encore à jouer comme des gamins attardés. Un jour viendra où ils passeront la trentaine sans femme, sans enfants, sans travail et sans maison, bien disposés à ce que rien ne change. »
Il n’y a bien que dans ces salons décrépits, dans ses immenses salles à manger sans domestiques, dans ces bibliothèques dépouillées de tant de livres vendus à l’unité à des brocanteurs, que leur parfum de nouveaux riches n’incommode plus personne, tous ces nouveaux pauvres n’ayant plus les moyens de faire la fine bouche.
Mais don Augusto ne recherche pas uniquement une bru, Carlos le sait très bien. Il se soucie moins du mariage que de la possibilité de donner enfin à croire, par cette union, que les Rodriguez sont nobles et l’ont toujours été. Aussi loin qu’il s’en souvienne, son père a toujours été obsédé par cette idée, accumulant sur son bureau des livres d’héraldique et des dossiers censés lui fournir des preuves suffisantes pour redorer la blason de la famille. Il n’a pourtant jamais trouvé la moindre trace de quelque descendant espagnol – quel qu’il soit – et encore moins d’un fortuné : que des Indiens, des métis, des quarterons, tous « paysans » ou « enfants du peuple » , comme indiqué sur leurs actes de naissance ; sans oublier cet arrière-arrière-grand-père qu’un curé inspiré avait inscrit comme « fils de la terre ». Mais il ne baisse pas les bras. Il est prêt à retourner les manuscrits dans tous les sens pour s’offrir le passé dont il a toujours rêvé, car, en plus de l’argent et des bonnes manières des Blancs, don Augusto a également hérité de leurs préjugés : difficile de se regarder dans le miroir après avoir, au café, asséné que les Indiens sont condamnés à rester des esclaves pour la simple raison qu’ils ont ça dans le sang.
Les ouvriers aussi retiennent son attention, non sans une certaine surprise d’ailleurs. De là où ils sont, ils semblent ne former qu’un seul corps à la peau écaillée par tous ces visages et ces chapeaux, tel un monstre qui envahirait les docks et les bâtiments qui bordent les quais. (…)
Par-delà les visages décomposés, il voit apparaître les premiers soldats. Plus que sur leurs propres montures, ils semblent juchés sur la masse des protestataires, fendant une houle d’ouvriers qui hurlent et qui fuient en tous sens.