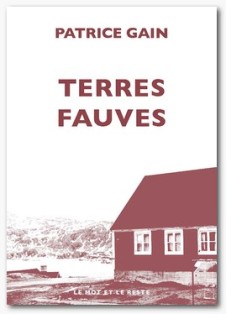J'ai beaucoup aimé
Titre : Mikado d'enfance
Auteur : Gilles ROZIER
Année de parution : 2019
Editeur : L'antilope
Pages : 192
Présentation de l'éditeur :
Quarante ans après les faits, le narrateur
revient sur un épisode traumatisant de son enfance : l’exclusion de son
collège, pour avoir adressé, avec deux camarades, une lettre antisémite à
son professeur d’anglais.
Quelques années plus tard, le narrateur,
fils d’une mère juive et d’un père catholique, deviendra spécialiste de
culture juive. Que s’est-il passé entre ces deux moments de son
histoire ?
Le narrateur tente de décortiquer l’imbrication des
conflits politiques des années 1970 et des malaises familiaux. Il
retrouve cette question tragique que sa mère a posée devant le conseil
de discipline : « Comment voulez-vous que mon fils soit antisémite alors
que mon père est mort à Auschwitz ? »
Gilles Rozier continue de creuser l’identité juive et ses enjeux, au plus profond de l’intime.
Le mot de l'éditeur sur l'auteur :
Traducteur de l’hébreu et du yiddish, écrivain et éditeur, Gilles Rozier est né à Grenoble en 1963.Directeur de la maison de la culture yiddish de 1994 à 2014, il a cofondé, en 2016, les éditions de l’Antilope. Il est l’auteur de six romans.
Son roman Un amour sans résistance a été adapté au théâtre en octobre 2019, dans une mise en scène de Gabriel Debray.
Avis :
Devenu spécialiste de littérature yiddish, l’auteur et narrateur est soudain rattrapé par « l’événement », qui, après quarante ans de refoulement au fond de sa mémoire, resurgit à l’improviste à l’occasion d’un de ses colloques. Lorsqu’il avait douze ans en 1975, sans réaliser la portée du geste et principalement pour tenter de se concilier les bonnes grâces de ses camarades, il avait participé à l’envoi d’une lettre anonyme antisémite à l’un de ses professeurs. Les conséquences avaient été semblables à la foudre pour cet enfant d’ordinaire discipliné et dans l’ensemble peu sûr de lui, et surtout, une chape de plomb l’avait aussitôt écrasé de son silence, au sein de sa famille, juive du côté maternel.
Cet épisode de son enfance est l’occasion pour le narrateur de revenir sur le malaise ressenti, dans les années 70, par la génération de ses parents quant à la judaïcité : alors que sa mère, juive, n’a de cesse de se couler dans la discrétion et de vouloir disparaître aux yeux du monde, le coupant, lui son fils, de ses racines, de son identité et de l’histoire de ses grands-parents assassinés pendant la guerre, la société française peine à se regarder en face alors qu’elle découvre encore peu à peu l’abominable réalité de la Shoah. Lorsque le gamin, qui ne comprend rien à cette énigme qu’il pressent autour de lui, mettra les pieds dans le plat, posant à sa façon la question qui le taraude, personne ne saura gérer la situation raisonnablement. L’attitude générale sera le refoulement, le silence et le déni, creusant chez l’enfant un traumatisant abîme d’incompréhension, de culpabilité et d’injustice, ainsi qu’un questionnement auquel l’adulte qu’il est devenu n’a toujours pas fini de répondre.
Nombre des détails de ce récit prendront le goût des petites madeleines de Proust chez les lecteurs qui ont été collégiens dans la seconde moitié des années 70. L’émotion du souvenir imprègne chaque page, alors que les peines anciennes de l’auteur resurgissent intactes, juste éclairées par sa compréhension d’adulte encore plein de regrets.
Touchante quête de rédemption d’un homme toujours meurtri par la culpabilité et l’humiliation d’un lointain souvenir d’enfance, ce récit autobiographique aborde les sujets les plus graves avec pudeur et humour, et fait mouche. (4/5)
Citations :
Nous n’en parlions jamais et j’aurais pu continuer longtemps à n’en pas convoquer le souvenir, encore des années, des décennies, pour toujours sans doute, car une chose qui ne vient pas à l’esprit ne se compte pas. Ne se conte pas.
La mémoire est une pelote de laine, un nœud de serpents, des grains de riz dans un bocal, un jeu de mikado. Comment tel souvenir est-il invité à remonter à la surface de cet embrouillamini ?
Tous ces souvenirs et les sensations s'y rapportant forment un tas compact, un enchevêtrement d'aiguilles de mikado qui piquent quand on les touche, mais elles ont fini par provoquer la même douleur, quelle que soit leur couleur et le nombre de bagues censées introduire entre elles une hiérarchie.
 |
La Ronde des Livres - Challenge
Multi-Défis d'Hiver 2020 |
|
|