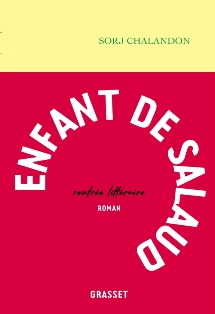jeudi 30 juin 2022
Bilan de mes lectures - Juin 2022
mercredi 29 juin 2022
[Sthers, Amanda] Le café suspendu
J'ai beaucoup aimé
Titre : Le café suspendu
Auteur : Amanda STHERS
Parution : 2022 (Grasset)
Pages : 234
Présentation de l'éditeur :
Le narrateur, Jacques Madelin, un Français installé à Naples après une déception amoureuse, passe le plus clair de son temps installé au café, juste en bas de chez lui, à prendre des notes en observant les personnes qui se croisent, se cachent ou se cherchent, les rencontres amoureuses ou amicales qui se tissent. La peau d’un crocodile de légende transformée en un étrange sac, une femme trompée qui s’arrange avec la maîtresse de son mari pour garder ce dernier, une jeune femme qui doit se débarrasser du foulard légué par sa grand-mère pour retrouver le goût de vivre, un écrivain aux mille visages, un homme qui a peur de dormir, et même un médecin chinois qui veut soigner les gens en bonne santé…
Tout en racontant des histoires pleines d’humanité, de fantaisie, de souvenirs, de récits historiques, légendaires ou imprégnés de psychanalyse, Jacques dessine au fil des pages un bouleversant autoportrait. C’est aussi un livre sur la charité, sur la manière dont la prodigalité se répercute sur nos destins. Le talent de conteuse d’Amanda Sthers fait merveille, alliant grâce poétique, peinture des sentiments et évocation d’une ville à l’atmosphère unique.
Le mot de l'éditeur sur l'auteur :
Avis :
C’est un véritable voyage à Naples que nous propose ce délicieux pêle-mêle d’anecdotes et d’impressions, qui peu à peu laisse entrevoir, en quelques portraits touchants, la vie intime des habitants d’un quartier, comme si l’on y vivait soi-même. Une épouse trompée, un médecin chinois déraciné, un jeune mafieux en fuite, une jeune fille aspirant au bonheur, un écrivain sans visage qui pourrait être Elena Ferrante, une femme légère, un homme insomniaque : autant d’être cabossés par la vie que le simple geste d’un café suspendu va relier, tissant insensiblement la cohésion d’une petite communauté, telle un village au sein de la grande ville.
Avec l’élégance et la délicatesse qui la caractérisent, la plume d’Amanda Sthers cisèle chacun de ces sept contes en petits concentrés d’émotion et de poésie. Si tous n’ont pas le même impact, y flottent toujours un parfum de mélancolie, l’impression d’existences aux rêves demeurés tristement hors d’atteinte. Ce sont les parcours d’êtres anonymes et invisibles, ceux à côté desquels on passe habituellement sans les connaître, et dont chaque partition n’en compose pas moins l’orchestre de la vie.
Une jolie tranche d’humanité, photographiée avec bienveillance dans un moment suspendu à observer le tourbillon de la vie des autres, et une amusante invitation au partage d'un roman... suspendu ! (4/5)
Citations :
Je ne suis pas un spécialiste mais jamais je n’ai goûté de café meilleur que dans le sud de l’Italie. Rares sont ceux qui s’asseyent pour boire leur café. Les petits déjeuners s’avalent au bar dans une cohue joyeuse, jus d’orange sanguine mêlé à la grenade débarrassée de ses pépins par une machine qui n’existe qu’à Naples, gourmandises englouties à la va-vite, du sucre plein les mains. Blagues à la criée. On croirait les salles de marchés boursiers de l’époque où tout le monde hurlait pour vendre et acheter. Nul ne veut rater cette plongée matinale dans la vie. Même les vieux se calent contre le comptoir. Sur les banquettes, on retrouve les dodus, ceux qui comptent rester, ceux qui doivent convaincre une femme de se déshabiller, un homme de signer un chèque, un père de les écouter enfin, et moi, assis avec mon stylo comme dans un bistrot français à ma place habituelle, à l’angle droit du café Nube. Certains retirent leurs alliances chaque matin. Quand une femme entre, il y a un frémissement dont elle se réjouit, les regards s’unissent pour célébrer sa beauté, les voix se font plus fortes sans agressivité. Il faut en être témoin pour comprendre comment les Napolitains regardent les femmes. Un sourire, un café et on s’en va dans la ville sous les yeux du Vésuve. Mauricio aime à me rappeler qu’il est considéré comme le volcan le plus dangereux du monde avec un ton de fierté, comme si cela glorifiait la masculinité napolitaine.
Il m’a fallu du temps pour comprendre que le monde des impressions dépasse de beaucoup celui que l’on considère comme réel. Il y a dans ce qu’on appelle l’intuition, la part essentielle de la vie. Nommez-la : instinct, sensation, atmosphère ; je pense tout simplement à l’espace qui contient l’amour, abrite la haine avant qu’elle ne se loge dans les poings, l’espoir qui fait courir plus vite, la peur aussi, le dégoût, la méchanceté, et le plaisir avant qu’il ne devienne orgasme. J’ai toujours su que mon ouvrage consistait à appréhender cette abstraction pour en faire des mots, des images, des valses d’émotion afin de lui donner une forme. Chaque artiste tire cette couverture invisible du côté qu’il croit être juste ; parfois il prend sa revanche sur la surdité des autres à ce qui l’a fait souffrir, souvent, il pense détenir le secret de la morale. Aujourd’hui, j’ai la conviction que faire le bien c’est avant tout accepter les émotions flottantes sans laisser leurs ondes sales nous articuler tels des pantins de chair. Maintenant que je vieillis, j’ai l’impression qu’une tasse de café suspendu a parfois plus de valeur qu’une œuvre d’art. Du côté de celui qui laisse comme de celui qui reçoit, la vie passe dans cette tasse qu’on tend dans son imaginaire ou qu’on accepte de mains inconnues. Ce qu’on offre, ce n’est pas un café, c’est le monde autour, du chahut à partager, des regards à croiser, des gens à aimer.
« Avez-vous fait l’expérience récente d’une grande joie ou d’une grande peine ?
— Non. Je ne pense pas. Aucun médecin ne m’a jamais posé ce genre de question.
— Nous avons inventé la médecine en observant les êtres vivants et vous en disséquant des corps morts.
— Ah… dis-je sans comprendre tout de suite le rapport. Non, je ne crois pas. Pas de joie ni de peine je veux dire.
— Nous ne sommes pas des morceaux mais un tout. Les choses sont liées : l’esprit, l’âme, le corps entier, les organes entre eux. La maladie se manifeste pour nous dire que l’harmonie nous a quittés. Votre mal de gorge et le mien ne viennent pas du même endroit, voyez-vous ?
— Avez-vous mal à la gorge aussi ?
— Depuis que je suis arrivé en Italie, j’ai perdu mon harmonie, monsieur Madelin.
— Puis-je vous aider à la retrouver ?
— C’est moi le médecin, monsieur Madelin.
— Certainement. » J’ajoutai un « désolé » car je vis que cela l’avait mis en colère.
« C’est l’anniversaire ?
— Pardon ?
— Anniversaire de joie ou de peine ? »
Je tremblais. C’était en effet l’anniversaire du décès de ma sœur dans des circonstances si violentes que personne dans ma famille n’en parlait jamais. Nous avions fait comme si elle n’avait jamais vécu. Je ne lui dis donc rien, mais je sentais qu’il savait déjà.
Dans la langue italienne, on emploie peu le futur. Les choses qui vont arriver sont déjà inscrites, on les formule au présent. Les outils d’expression des Italiens expliquent fort bien leur tempérament ; ils usent d’un passé formulé dans une syntaxe empreinte de nostalgie aiguë, d’un conditionnel baigné de belles promesses et d’un temps qui même présent reste hypothétique et flottant. Ferdinando ne parle que sa langue natale, le napolitain, version encore plus forte de la langue de l’immédiateté, de l’amour de la vie et comme on lui a interdit d’évoquer les jours d’avant, aujourd’hui est tout ce qui existe. La vie de Ferdinando, c’est maintenant, maintenant, maintenant.
Nous, les écrivains, ne sommes que l’instrument d’une force qui nous dépasse, vous le savez bien. Nous réfléchissons, nous construisons, nous croyons travailler mais en fait nous ne sommes qu’une antenne réglée sur une fréquence qu’on appelle l’inspiration, nous écrivons sous la dictée. On peut croire en la littérature comme on peut croire en Dieu ou pas mais les livres sont là comme les églises, et ça doit vouloir dire quelque chose, non ?
— Je pense qu’être artiste, c’est être hanté. On croit que ça n’arrive qu’aux maisons mais ça arrive aussi aux gens, les gens hantés deviennent des écrivains.
Quand je suis sorti, le sol s’est dérobé sous mes pieds. J’ai tenté de résister à la secousse, comme à bord d’un bateau dans la tempête, Naples et ses sœurs chaloupaient. Ça s’est arrêté un instant et la terre s’affola à nouveau comme un hoquet après un sanglot. Je suis tombé le visage sur les pavés qui ne cessaient d’exulter. Le tremblement de terre de l’Irpinia fut un des plus violents de la région et fit près de trois mille morts autour de la ville. (…)
On est bien peu de chose qu’une main que l’on tend ou celle qui l’attrape. L’accumulation de bibelots ne fait que rajouter aux débris quand la terre tremble et que la vie s’en va. Je n’ai plus rien désiré de matériel après ce jour-là.
Je ne sais jamais si je serai publiée. J’ai déjà sorti un ouvrage mais je ne suis pas un auteur connu, et puis je n’y tiens pas. J’ai demandé à rester anonyme, et ça n’a pas l’air de poser de problème puisque tout le monde se fout de mes romans… J’écris quand même, je n’ai pas le choix. C’est en moi comme je respire. Mais c’est violent. Un livre qui n’est pas lu n’existe pas, il n’est même pas écrit. Il n’est pas un fantôme, il est le néant.
Tu sais comme on s’abstrait de ce qu’on est quand on lit et comme à la fois on est profondément soi-même ? Eh bien c’est cela, le sommeil. Les livres, ce sont les rêves que quelqu’un d’autre nous prête.
Tu sais, il existe une tradition napolitaine qui s’appelle le café de la consolation. Quand on veut réconforter une famille d’un deuil, on lui offre un sachet de grains de café.
Quand on est immigré où qu’on soit, on a abandonné une partie de ce que l’on est et on n’appartient pas complètement à ce que l’on vit. Jamais chez soi, toujours en soi, à chercher si un jour on pourra poser notre sac pour de bon. Je pense qu’en abandonnant son pays, on ne trouve plus jamais la paix.
Je laisse Naples alors que l’aube n’a pas encore vraiment éclairé le ciel. Comme un homme fuit son foyer protégé par la nuit. J’ai le sentiment de ne pas pouvoir lui dire au revoir. Je ne reconnais que les lumières des paquebots immenses qui me faisaient rêver dans ma jeunesse et ils me pétrifient désormais, comme ce retour dans un pays qui sera mon linceul. L’écrivain sans visage avait raison, j’en veux à Mauricio. Il m’a offert le luxe de pouvoir travailler peu, de faire partie d’une famille confortable, de vivre sans obligations réelles. Et je m’aperçois aujourd’hui que j’étais un fonctionnaire au service de ma liberté. Que nous sommes tous en prison quelle que soit celle qu’on se choisit. La peur, l’urgence m’auraient peut-être obligé à devenir l’artiste que j’ai laissé paresser. Que vais-je faire pendant ces quelques années qui me séparent de la mort ? Où vais-je dormir, aimer, manger ?
Je marche dans l’aéroport glacial. Les gens sont masqués et ne se regardent pas. Tous semblent en transit dans un monde étroit, le cou baissé sur un écran qui feint un rapport aux autres. Nous sommes devenus des abstractions sans relief. Alors je suis seul, à nouveau, comme je suis arrivé. Je n’ai plus rien à écrire, plus rien à dessiner que des paupières fermées, des visages cachés pour nous sauver la vie. Mais avec la fin des liens, la mort est entrée dans le monde moderne bien avant le virus. Il ne fait que nous achever. J’avance en ligne, je montre mes papiers, mon test, ma déclaration de santé. Les voyages ont perdu leur romantisme, le monde est une boutique de souvenirs suggérés, de moments qu’on n’a jamais vécus.
Du même auteur sur ce blog :
lundi 27 juin 2022
[Flaten, Isabelle] Triste Boomer
J'ai beaucoup aimé
Titre : Triste Boomer
Auteur : Isabelle FLATEN
Parution : 2022 (Nouvel Attila)
Pages : 200
Présentation de l'éditeur :
Fabien est un petit garçon heureux qui aime, le football, la poésie et ses copains, jusqu’au jour où ses parents rejoignent la Syrie. Ce roman poignant et d’une grande humanité raconte le cauchemar éveillé d’un enfant lucide, courageux et aimant qui va affronter l’horreur.
Le mot de l'éditeur sur l'auteur :
Avis :
Le synopsis est on ne peut plus classique, si ce n’est même basique. Pourtant, Isabelle Flaten nous a concocté une petite perle d’humour et d’originalité qui se déguste avec autant de plaisir que de surprise amusée. Plutôt que de laisser les deux protagonistes principaux conter leurs délicates retrouvailles, elle a confié la narration à l’ordinateur du boomer, témoin de plus en plus amer, mais privilégié, des égarements de son propriétaire, et au portrait d’un ancêtre guindé, scandalisé par la modernité des mœurs qu’il observe depuis les murs de son château désormais ouvert aux visites du public.
C’est ainsi que le récit qui prend de plus en plus allégrement la tournure d’un fantaisiste et moderne conte de fées, autour d’un prince plus très charmant et d’une Cendrillon quinquagénaire qui a sauvé son château grâce aux gains d’un jeu télévisé sur les « people », se révèle une excellente comédie, où l’auteur s’amuse d’aussi bon coeur que ses lecteurs. Pendant que dans leurs très réjouissants monologues, entrecoupés des commérages des pipelettes de voisines, un symbole de la modernité et un représentant du temps jadis commentent de manière décalée les faits et gestes de deux de nos semblables, l’histoire prend une coloration de plus en plus satirique, soulignant avec la plus grande malice nos travers contemporains : jeunisme, féminisme à tout crin et vague woke, engouement pour le développement personnel, le coaching et les thérapies alternatives, greenwashing, numérisation de nos vies…
Un délicieux moment que cette lecture enlevée, drôle et piquante, dont l’original parti pris narratif permet de nous renvoyer un très impertinent reflet de la société d’aujourd’hui. (4/5)
Citations :
Déjà au IIe siècle, Claude Galien de Pergame alertait : « La femelle est plus imparfaite que le mâle pour une première raison capitale, c’est qu’elle est plus froide. » Tous les médecins s’accordent sur ce point : les organes féminins sont fragiles et influent sur le cerveau, pour preuve, il a souvent été nécessaire d’avoir recours à l’hystérectomie pour calmer les dérèglements. Dieu sait si j’évitais feu mon épouse Adélaïde de Mercueil quand elle était sujette à ses menstrues. Pardonnez ma pédanterie si j’en réfère au docteur Murat qui, en 1812, pointe « l’entier empire du viscère (l’utérus) sur les actions et affections de la femme » dans son Dictionnaire des sciences médicales. Propos corroborés dans le Dictionnaire de la médecine pratique de 1914 : « De l’orifice génital suintent en permanence des humeurs douteuses. Pour pallier cette source d’infection, rien ne remplace la semence mâle. » Or je ne m’explique pas – sinon par symptôme de dégénérescence – qu’à l’heure où plus personne n’ignore les faiblesses congénitales du sexe féminin, il leur soit accordé autant de liberté. Il est grand temps de relire Nietzsche : « Elles sont une propriété, un bien qu’il faut mettre sous clé, des êtres faits pour la domesticité et qui n’atteignent leur perfection que dans une situation subalterne. » Ou Émile de Jean-Jacques Rousseau : « Toute l’éducation des femmes doit être relative aux hommes. Leur plaire, leur être utiles, se faire aimer et honorer d’eux, les élever jeunes, les soigner grands, les consoler, leur rendre la vie agréable et douce : voilà les devoirs des femmes dans tous les temps, et ce qu’on doit leur apprendre dès leur enfance. »
Priez, Seigneur, pour que Salomé se reprenne et qu’elle relise ses mails aussi ! C’est bien ainsi que se nomment ces missives électro-véhiculées que l’on écrit en tapant sur les petits carrés de la machine à ordiner, n’est-ce pas ?
L’archiduchesse avait poussé l’expérience jusqu’à bannir toute forme d’autorité sous son toit et s’en remettre à cette notion chimérique de responsabilité individuelle. Faute d’instructions fermes, les domestiques se la coulaient douce, ça gobelottait sec en cuisine et le service s’en ressentait. Un soir au souper, feu son époux l’archiduc Archibald a tapé un poing si rageur sur la table qu’il a envoyé valser le râble de chevreuil sauce infecte puis exigé que son épouse se reprenne et reprenne les commandes du personnel sur-le-champ. Ce qui aussitôt fut fait. Et illustre parfaitement ce que je vous disais en préambule. Quand le maître aboie, son épouse la ferme et le monde tourne rond. Et Freud ne me contredirait pas, lui qui a énoncé dans une conférence – je ne suis plus certain de la source : « Les femmes sont intellectuellement inférieures, elles ont un surmoi plus faible, elles sont peu douées pour la sublimation, elles sont narcissiques, envieuses, rigides. »
Je me suis alors aperçu à quel point le monde marchait sur la tête. Quid de l’avenir d’une femme si elle rechignait à l’enfantement, l’essence même de sa nature, la raison de sa présence sur terre, sa mission première et l’assurance de sa santé avant tout ? Pourquoi faut-il sans cesse en référer à Platon : « Chez les femmes, ce qu’on appelle la matrice ou utérus est […] un animal au-dedans d’elles, qui a l’appétit de faire des enfants ; et lorsque, malgré l’âge propice, il reste un long temps sans fruit, il s’impatiente et supporte mal cet état ; il erre partout dans le corps, obstrue les passages du souffle, interdit la respiration, jette en des angoisses extrêmes et provoque d’autres maladies de toutes sortes. » Ou encore Philippus Theophrastus Aureolus Bombast von Hohenheim, médecin, philosophe et alchimiste plus connu sous le nom de Paracelse : « Le vase qui conçoit et protège l’enfant est communément désigné sous le nom de matrice […] c’est à cause de ce vase que la femme a été constituée, et non pour la nécessité d’aucun autre membre ou partie. »
Parce que tous deux le savent, si l’amour meurt pour mille raisons, par lassitude, essoufflement, négligence, le leur allait mourir par stupidité s’ils continuaient à s’ignorer. Mais qui fera le premier pas ?
Du même auteur sur ce blog :
samedi 25 juin 2022
[Chalandon, Sorj] Enfant de salaud
Coup de coeur 💓
Titre : Enfant de salaud
Auteur : Sorj CHALANDON
Parution : 2021 (Grasset)
Pages : 336
Présentation de l'éditeur :
- Qu’as-tu fait sous l’occupation ?
Mais il n’a jamais osé la poser à son père.
Parce qu’il est imprévisible, ce père. Violent, fantasque. Certains même, le disent fou. Longtemps, il a bercé son fils de ses exploits de Résistant, jusqu’au jour où le grand-père de l’enfant s’est emporté : «Ton père portait l’uniforme allemand. Tu es un enfant de salaud ! »
En mai 1987, alors que s’ouvre à Lyon le procès du criminel nazi Klaus Barbie, le fils apprend que le dossier judiciaire de son père sommeille aux archives départementales du Nord. Trois ans de la vie d’un « collabo », racontée par les procès-verbaux de police, les interrogatoires de justice, son procès et sa condamnation.
Le narrateur croyait tomber sur la piteuse histoire d’un « Lacombe Lucien » mais il se retrouve face à l’épopée d’un Zelig. L’aventure rocambolesque d’un gamin de 18 ans, sans instruction ni conviction, menteur, faussaire et manipulateur, qui a traversé la guerre comme on joue au petit soldat. Un sale gosse, inconscient du danger, qui a porté cinq uniformes en quatre ans. Quatre fois déserteur de quatre armées différentes. Traître un jour, portant le brassard à croix gammée, puis patriote le lendemain, arborant fièrement la croix de Lorraine.
En décembre 1944, recherché par tous les camps, il a continué de berner la terre entière.
Mais aussi son propre fils, devenu journaliste.
Lorsque Klaus Barbie entre dans le box, ce fils est assis dans les rangs de la presse et son père, attentif au milieu du public.
Ce n’est pas un procès qui vient de s’ouvrir, mais deux. Barbie va devoir répondre de ses crimes. Le père va devoir s’expliquer sur ses mensonges.
Ce roman raconte ces guerres en parallèle.
L’une rapportée par le journaliste, l’autre débusquée par l’enfant de salaud.
Le mot de l'éditeur sur l'auteur :
Avis :
Ton père portait l'uniforme allemand. Tu es un enfant de salaud ! C'est ainsi que son grand-père avait assené au narrateur, alors âgé de dix ans, son exaspération d'entendre, une fois de plus, les soi-disant exploits de Résistant de l'intéressé. Jamais depuis, "l'enfant de salaud", devenu journaliste, n'avait osé aborder le sujet de ce passé avec son père, imprévisible et violent. Ce n'est qu'en 1987, lorsqu'il parvient à exhumer des archives le dossier judiciaire paternel, qu'il découvre l'improbable parcours d'un homme menteur et manipulateur, qui ne cessa de changer de camp tout au long de la seconde guerre mondiale. Pendant que le fils interpelle enfin son père sur ses inavouables secrets, il se retrouve aussi dans les rangs de la presse qui couvre le procès criminel de Klaus Barbie.Sans rien changer aux faits, Sorj Chalandon a choisi d’antidater sa découverte des actes de son père – en réalité posthume -, pour la faire coïncider avec la période du procès de Klaus Barbie. Ce sont ainsi deux procès qui entrent en résonance dans ce roman, l’un bien réel, l’autre convoqué dans l’imaginaire de l’auteur. Barbie avait refusé de paraître aux audiences, le père de répondre de ses mensonges à son fils. Dans un cas comme dans l’autre, les coupables sont restés jusqu’au bout dans le déni, rendant encore plus insupportables la souffrance et le questionnement des plaignants. Alors, pour l’auteur, torturé sa vie durant, non seulement par la conscience des crimes, mais aussi par le déni et les mensonges de son père, ce livre est en quelque sorte un procès personnel posthume, la confrontation à laquelle il n’aura jamais pu convoquer cet homme insaisissable.
Sorj Chalandon connaît parfaitement le cas et le procès Klaus Barbie, ses reportages sur le sujet lui ayant même valu à l’époque le prix Albert Londres. Sa narration est précise et significative. Le lecteur revient avec émotion sur les lieux des crimes du Bourreau de Lyon, notamment sur celui de la rafle des 44 enfants juifs d’Izieu. Il se retrouve immergé dans la salle d’audience, sous le choc des faits et de l’indifférence méprisante du criminel nazi. Face à l’évidence d’une telle monstruosité, l’écrivain imagine les réactions de son père. Cet homme dont le parcours reste une énigme, tant il démontre de grotesque inconséquence dans ses multiples et opportunistes revirements, serait-il resté de marbre lui aussi, la conscience imperméable et le mensonge plus fanfaron que jamais ? Lucide, l’écrivain dresse le portrait d’un père barricadé dans sa réalité distordue, incapable de se voir dans sa vérité nue, sous peine de basculer dans une folie définitive. Et si, dans la vie réelle, ce père lui a toujours échappé, il sait sans illusion que, même si elle avait pu avoir lieu, aucune confrontation frontale, fusse-t-elle même celle d’un procès, n’y aurait rien changé.
Sorj Chalandon signe un livre sincère et bouleversant : une tentative, comme il le dit lui-même, de « changer ses larmes en encre ». Coup de coeur. (5/5)
Citations :
— Souviens-toi toujours que la guerre en France, c’était 1 % de collabos, 1 % de Résistants et 98 % de pêcheurs à la ligne. Toi, je t’aime bien parce que tu n’es pas un pêcheur à la ligne.
Deux jours sans l’accusé n’avaient pas été dommageables. La Cour avait pu, hors sa présence, évoquer ses méfaits en Bolivie, après la guerre. Barbie en fuite avait profité des désordres pour devenir officier de l’armée bolivienne. Aidé par des amis SS et des fascistes italiens, il avait créé « Les fiancés de la mort », un groupe paramilitaire qui opérait là où les forces régulières ne se risquaient pas. Il avait aussi aidé à la création de camps de concentration anticommunistes et antisyndicalistes, de centres d’interrogatoire et de torture.
Mais ces fausses confrontations avaient été un naufrage. Il ne fallait plus que Barbie reparaisse. Sa présence transformait ce procès en cirque. Au lieu de témoigner, de raconter, de se souvenir, les victimes pleuraient des mots sans suite. Le regard du nazi abîmait ce que nous avions à entendre. Pour que les martyrs osent parler, il fallait le silence d’un box désert. Jusqu’à ce jour, nombre d’entre eux n’avaient jamais partagé leur calvaire, leur douleur ou leur héroïsme. Des parents, des enfants, des amis entendaient leur histoire ici pour la première fois. Depuis la guerre, ils s’étaient tus. Et toutes ces années plus tard, ni la souffrance ni l’effroi ne pouvaient être partagés devant l’homme qui en souriait. Barbie ne répondrait pas de ses crimes. Il l’avait dit au premier jour de son procès et en resterait là. Alors pourquoi encombrer les débats de son mépris ? La venue de l’homme n’apporterait pas d’élément nouveau aux faits qui lui étaient reprochés. Elle n’aiderait pas à la manifestation de la vérité. Au contraire, elle dépossédait les victimes de leurs dernières forces. Elle leur volait leurs gestes et leurs phrases. Elle transformait leurs témoignages en lamentations inaudibles. La présence de Klaus Barbie portait atteinte à la dignité de son procès.
— Vous vouliez la justice ? a soufflé un avocat de la partie civile.
— La justice ? lui a murmuré l’huissier à l’oreille.
La vieille dame s’est tournée vers sa petite-fille.
— Tu voulais la justice ?
Alors Ita Halaunbrenner s’est ébrouée. Et elle a brandi ses poings vers le ciel en hurlant.
— Justice ! Justice !
C’est fini. La femme de 83 ans a redescendu les marches. Jacob, son mari, un soyeux de Villeurbanne, a été fusillé par la Gestapo de Lyon. Son fils Léon, 14 ans, n’est pas revenu d’Auschwitz. Ses filles, Mina 9 ans et Claudine 5 ans, ont été jetées dans le camion d’Izieu.
Comme je t’avais espéré avec moi dans la Maison d’Izieu, j’aurais aimé que tu écoutes cela aussi. Et que tu entendes les revenants des camps. Auschwitz. Ce qu’était la faim.
— On n’a plus rien à apprendre là-dessus.
C’est ce que tu m’avais dit. Et tu te trompais encore.
Lorsque Isaac Lathermann est venu à la barre, il a pétrifié la salle en quelques mots.
— À hauteur d’homme, il n’y avait plus d’écorce aux arbres, tout avait été mangé. Plus d’herbe non plus. Mangée, elle aussi.
Ou Otto Abramovici, qui parlait, regard baissé.
— Un jour, un homme qui s’était fait une lame avec une boîte de conserve, a découpé des morceaux de fesse d’un mort et les a mangés.
Il a relevé les yeux.
— J’ai vu manger de l’homme, monsieur le Président.
Jeune étudiante en histoire, Résistante, arrêtée, battue, déportée à Ravensbrück, elle a évoqué l’acharnement des nazis à fabriquer des « sous-êtres ». Pas un mot brisé lors de son témoignage, pas une phrase en larmes, pas une plainte, pas un sanglot. Elle a partagé avec nous l’image des nourrissons noyés dans un seau à la naissance. La stérilisation forcée des gamines tsiganes de 8 ans. La nièce du Général nous a raconté à quoi s’amusaient les bandes d’enfants abandonnés qui survivaient derrière les barbelés.
— Ils jouaient au camp, monsieur le Président.
Sa voix douce.
— L’un tenait le rôle du SS, les autres des déportés.
Je l’ai vu comme une bille argentée, frappée par les raquettes d’un billard électrique et se cognant partout. Un papillon désorienté, ivre d’effroi et de lumière, se précipitant contre une vitre grillagée. À mon tour j’ai eu peur, mais je n’y pouvais plus rien. Il était trop tard pour revenir toutes ces années après. J’avais réveillé un somnambule. Dit à un enfant prêt à s’envoler que les fées n’existaient pas. J’avais assassiné la licorne. Tué le Père Noël. Je me suis rendu compte que, depuis toujours, il avait survécu parce que personne ne s’était opposé à ses rêves. Que jamais il n’avait été mis en danger, par un homme, une femme, un n’importe qui brandissant sous ses yeux les preuves de ses impostures. Ces illusions le tenaient debout. Elles étaient son socle, son ossature, sa puissance. À force de temps passé, d’histoires fabriquées répétées en boucle, d’images brodées une à une jusqu’à ce qu’elles deviennent réalité, mon père ne se mentait peut-être même plus. Enfant, puis jeune homme, puis homme, puis père, il s’était forgé une cuirasse fantasque pour se protéger de tous. Une carapace de faux souvenirs vrais.
Du même auteur sur ce blog :
jeudi 23 juin 2022
[Deshaies, Michelle] XieXie
J'ai aimé
Titre : XieXie
Auteur : Michelle DESHAIES
Parution : 2018 (David)
Pages : 174
Présentation de l'éditeur :
Pendant ce temps, la situation politique se dégrade en Chine. Alors que les troupes nationalistes de Tchang Kaïchek et celles, communistes, de Mao Zedong s’affrontent, l’arrivée imminente des Japonais crée la panique à Guilin. Les Occidentaux sont obligés de rentrer dans leur pays. Rose et Raymond ne se résigneront toutefois pas à laisser XieXie derrière eux…
Un roman dépaysant, d’une grande délicatesse, qui nous transporte dans une époque troublante et méconnue de l’occupation coloniale de la Chine.
Le mot de l'éditeur sur l'auteur :
Originaire de Haileybury, dans le nord de l’Ontario, Michelle Deshaies a une formation en journalisme. Elle a fait une grande partie de sa carrière comme rédactrice, traductrice, conseillère en communication et organisatrice d’événements. Depuis quelques années, elle se consacre entièrement à la création littéraire. Elle signe ici son premier roman.Avis :
Après une première partie assez peu convaincante, centrée sur une très angélique romance qui saupoudre de bons sentiments et de sensualité lesbienne un amour ancillaire triangulaire sans doute trop idéalisé pour son contexte colonial, on se laisse plus volontiers emporter par l’accélération du récit, lorsque la réalité et ses contingences viennent dramatiquement rattraper les gentils tourtereaux. Entrecoupée de rappels, brefs mais efficaces, des évènements qui, dès le milieu du XIXe siècle, firent de la Chine une semi-colonie soumise aux puissances occidentales et au Japon, dans un cycle interminable de guerres civiles et d’occupations étrangères, la narration prend alors plus d’ampleur, en même temps qu’une réelle intensité dramatique. Alors qu’approche l’encore invisible, mais implacable marée japonaise précédée par la rumeur de ses exactions, l’on assiste, impuissant, au développement d’une tragédie aux allures de sauve-qui-peut général.
Citations :
À partir de 1931, les deux pays entament une nouvelle étape dans leurs relations et se font une guerre non déclarée autour de Shanghai et Nanjing. De son côté, le Japon envahit inlassablement le nord et l’est de la Chine. Les nains victorieux avancent vers le sud et le port de Guangzhou.
Les nationalistes de Tchang Kaï-chek et les communistes de Mao Zedong unissent donc leurs efforts contre le Japon. Les communistes déclarent enfin officiellement la guerre aux Japonais à Jiangxi alors que les nationalistes reconnaissent leur faiblesse et se refusent à entraîner la Chine dans des hostilités strictement vouées à la défaite. Selon eux, les Japonais, ces nains victorieux, sont une maladie de la peau alors que les communistes sont une maladie du cœur. Tchang Kaï-chek veut donc aller à l’essentiel et l’essentiel n’est pas l’étranger.
En décembre 1937, les Japonais envahissent la ville de Nanjing, alors capitale de la Chine, et commettent des atrocités connues sous la dénomination « viol de Nanjing ». La capitale est transférée à Chongqing. Devant ces circonstances, les Japonais se croient avisés d’offrir des conditions de paix au dirigeant chinois du moment, Jiang Jieshi, chef des nationalistes. Les nains victorieux choisissent de poursuivre leur avancée et d’établir des directions marionnettes dans les régions de la Chine qu’ils maîtrisent. Leur férocité est sans relâche.
Invité par Rose qui aimait entendre parler du pays de sa douce amie, Qipin Charles lui raconta cette période de la grande famine qui sévissait toujours, quand le gouvernement n’arrivait pas à nourrir son peuple. On vendait de tout pour manger. Des villageois vendaient leurs vêtements, leurs meubles, de tout par nécessité. Le marché noir s’était généralisé et les enfants étaient devenus une commodité. On offrait trois yuans pour un enfant de neuf ans, parfois un bol de riz et deux kilos d’arachides, et même pour si peu, plusieurs ne trouvaient pas preneur pour leur progéniture. Entre 1957 et 1960, le parti communiste a pillé son peuple par une série de mesures tout aussi désastreuses qu’inefficaces les unes que les autres. L’argenterie de tout genre et la porcelaine ont été ramassées soit pour être envoyées dans des fonderies ou pour être amalgamées à d’autres matériaux de construction. On a procédé de même pour les chaudrons de fonte et les ustensiles de fer. Les porcs et les matériaux de construction de porcheries géantes ont été saisis. En 1959, les économies des banques d’état ont été gelées pour financer les grands projets d’irrigation. Ce même été, le parti persécuta un demi-million d’étudiants et d’intellectuels et les déporta dans des endroits isolés pour les contraindre au travail. Devant ce pillage de biens et de personnes et cette déstructuration complète, le peuple a réagi avec ses propres stratégies. Ils ont été des milliers à faire preuve d’inertie naturelle au travail, à voler les cantines, à s’approprier les récoltes pour les manger ou les vendre, et à faire gonfler les grains dans l’eau pour en doubler la quantité et leur revenu.
Tout le monde, de haut en bas de la société chinoise, volait pendant cette période. Ce n’était pas un moyen de résister à l’État et tous en souffraient. Quand on cachait le riz, les travailleurs crevaient de faim. C’était la seule façon d’avoir une ration de plus. Avec le Grand Bond en avant, la société chinoise est devenue une horde de petits et de grands voleurs.
mardi 21 juin 2022
[Van der Plaetsen, Jean-René] Le Métier de mourir
J'ai beaucoup aimé
Titre : Le Métier de mourir
Auteur : Jean-René VAN DER PLAETSEN
Parution : 2020 (Grasset)
Pages : 272
Présentation de l'éditeur :
Inspiré de la vie d’un personnage ayant réellement existé, Le Métier de mourir est un beau et grand roman métaphysique, marqué par un romantisme échevelé, où s’entremêlent, autour d’un individu hors du commun, des histoires d’hommes et d’amour, dans des paysages de commencement du monde, au rythme des balles qui sifflent et des Saintes Écritures.
Le mot de l'éditeur sur l'auteur :
Avis :
Sur ce bout de territoire chauffé à blanc par le soleil, entre poussière du désert et éclat aveuglant de la mer, le temps s’écoule au ralenti d’une interminable attente, passée en alerte permanente. Chaque fois qu’il prend son tour de garde à la barrière du check-point, chacun de ces combattants sait que le pire peut arriver, caché sous les apparences les plus banales. C’est donc avec au ventre la peur de l’imprévisible et la hantise de l’imparable, que l’on se laisse enfermer dans le huis-clos d’un drame annoncé, sous la menace d’un ennemi d’autant plus terrifiant qu’invisible et impalpable.
Dans cette fournaise qui ne demande qu’à exploser, les esprits gambergent. Favrier, un jeune engagé français fasciné par l’imposante aura de Belleface, s’attire la sympathie du vieux guerrier qui se plaît bientôt à projeter en lui le fils qu’il n’a jamais eu. Peu à peu se révèle le parcours douloureux et secret de ce personnage taciturne, inspiré de l’histoire vraie racontée à l’auteur par son grand-père, lui-même militaire de carrière. Cet homme, demeuré anonyme, prend au fil du récit la dimension d’un héros digne et courageux, incroyable trompe-la-mort désespérément condamné à la solitude par son exceptionnelle longévité dans le « métier de mourir », mais aussi sage et fataliste témoin de l’éternelle et folle faiblesse humaine, tragiquement soulignée par la litanie de ses références bibliques, extraites de l’Ecclésiaste.
La narration, puissante et sobre, exsude l’amour profond de l’auteur pour le Liban et témoigne de sa connaissance fine du contexte du pays. Casque bleu dans cette zone en 1985, il a lui-même assisté à cette guerre d’usure silencieuse, qui, à force d’attaques sporadiques et terriblement meurtrières, très souvent sous la forme d’attentats à la voiture piégée, a fini par permettre au Hezbollah de récupérer le terrain abandonné par les forces armées israéliennes. Et, alors qu’il est issu d’une famille de militaires, son livre est aussi une réflexion sur les valeurs qui motivent des hommes à s’engager dans le métier de soldat, par vocation et par idéal, parce qu’à leurs yeux leur vie vaut d’être donnée pour la cause qu’ils défendent.
En mêlant les accents antiques d’une tragédie grecque aux sonorités modernes d’une guerre contemporaine, ce livre bâti tout en tension et profondeur, comme un fatidique compte à rebours vers ce que l’on devine d’emblée une dramatique explosion finale, fait résonner avec beaucoup de tristesse l’apparente infinitude des conflits qui embrasent le Proche-Orient, épicentre de nos civilisations, de nos religions, mais aussi d’une violence dont les vagues n’ont pas fini d’ébranler le monde. (4/5)
Citations :
Car El-Khoury ne pouvait ignorer que son billet pour Beyrouth était sans retour. Quels étaient donc les ressorts et les motifs de l’amour inconditionnel qu’il vouait à son pays ? El-Khoury avait souvent dit à Favrier que la Terre sainte des chrétiens s’étendait jusqu’à Tyr et Sidon, et que cela était déjà, en soi, une raison suffisante pour la défendre. Mais ce n’étaient là que des mots, un discours bien rodé par des heures de discussions avec ses camarades kataëbs, et Favrier avait perçu qu’il entrait autre chose, quelque chose de bien plus profond, dans l’amour sans limites que son ami portait à la terre de ses ancêtres. Le Liban, pour El-Khoury, était une idée, celle d’une démocratie permettant aux trois religions révélées de cohabiter en paix, à défaut de pouvoir vivre dans une improbable harmonie. Mais c’était surtout un lieu, avec des paysages, des couleurs de ciel et des odeurs, dans lequel vivaient et mouraient des êtres de chair et de sang.
Favrier se souvint alors de la visite qu’il avait faite, quelques semaines plus tôt, à Jérusalem, à la faveur d’une permission. Lorsqu’il était arrivé sur l’esplanade des Mosquées, qui surplombe le Mur des Lamentations, et qu’il s’était trouvé face au Dôme du Rocher, sous le grand soleil de midi, il s’était dit que toute cette région puait l’idée de Dieu. Se reprochant quelques instants plus tard ce verbe employé d’instinct, il s’était plongé dans une profonde méditation et avait conclu, après réflexion, qu’il n’y avait pas d’autre terme pour décrire ce qu’il ressentait.
(…) cette terre était bien la terre originelle, la matrice des hommes et des trois grandes religions, terre sainte, terre de combat et terre promise à la fois, celle d’où tout part et où tout revient toujours.
Depuis qu’il était arrivé à Ras-el-Bayada, il avait découvert avec une immense surprise combien les guérillas modernes ressemblaient peu à l’idée que l’on pouvait se faire de la guerre classique. La chaleur omniprésente, l’indolence de l’Orient, une routine émolliente, le sens du danger qui s’émousse et puis, soudain, une attaque qui claque comme un coup de foudre. En général, les dégâts matériels s’avéraient importants et il fallait hélas toujours déplorer des morts de chaque côté. « Dans les états-majors d’aujourd’hui, on appelle ça les conflits d’intensité basse ou moyenne », lui avait dit un jour Belleface, qui avait ajouté : « Et ça dit bien ce que ça veut dire : un conflit d’intensité moyenne, c’est-à-dire une guerre sans artillerie ni aviation, et donc sans vraie bataille, avec seulement des gus pour tenir le terrain et des snipers pour les dégommer, c’est une guerre qui ne dit pas vraiment son nom. Une guerre hypocrite, en somme. »
Il ne savait pas encore, à la différence des grands peintres, que le décor ordonne le maintien et l’existence des êtres qui y évoluent.
Les armes les plus sophistiquées du monde ne peuvent rien contre une multitude d’hommes qui n’ont pas peur de la mort. Cela s’est toujours vérifié dans le passé. Je dirais même que c’est le ressort de toutes les grandes invasions. Et dans notre cas, la situation est encore pire car on a affaire à des fanatiques qui désirent la mort parce qu’ils croient au paradis des combattants et à toutes ces conneries de vierges réservées aux martyrs.
— Tu crois à tout ce que tu me dis ?
— Bien sûr ! Je crois qu’ils combattent pour leur Dieu et que cela leur donne des ailes. Toi qui es catholique, tu vas comprendre ce que je veux dire : ils se voient comme des anges, mais des anges de la mort. Ils sont imperméables au doute et insensibles à la douleur. Et nous, en face, on combat pour la démocratie et les droits de l’homme ? Excuse-moi, Favrier, mais j’éclate de rire ! Comment veux-tu qu’on gagne une telle guerre ? Nous ne sommes pas au même niveau qu’eux.
Dans le schéma mental d’un jeune Français de sa génération, né au début des années 1960, il était acquis que, à l’exception des libres penseurs ou de ceux qui se réclamaient de l’athéisme, chacun avait hérité de ses parents une religion, qu’il était libre de pratiquer ou non. Tel avait été jusque-là le point de vue de Favrier, que sa rencontre pourtant si marquante avec El-Khoury n’avait guère modifié. Dans le même ordre d’idées, il ne s’était jamais inquiété dans sa jeunesse de savoir quelle pouvait être la confession de tel ou tel de ses amis. Être juif, musulman ou bouddhiste n’était pas plus exotique à ses yeux que d’être catholique. C’était une donnée comme une autre, une donnée objective, qui n’appelait aucun commentaire et n’avait guère plus de signification que d’avoir été doté par la nature d’yeux clairs ou sombres, de cheveux bruns ou blonds, d’une grande ou d’une petite taille.
À l’inverse, depuis qu’il était arrivé au Liban, il avait le sentiment que tout tournait et s’ordonnait autour de Dieu, et que les conséquences s’en ressentaient sur l’existence de chacun autant que sur la vie collective quotidienne d’un pays entier. Tout se passait comme si chaque homme ou femme adaptait son comportement aux commandements, aux préceptes et aux rites de sa religion. C’était rarement le cas en France, où, lorsque quelqu’un y vivait sa foi, il le faisait dans la discrétion. Au Liban, les marques de respect que chacun adressait à son Dieu étaient ostensibles – pour ne pas dire ostentatoires, voire emphatiques. La plupart des chrétiens, hommes ou femmes, arboraient autour du cou une croix dont la représentation stylisée variait selon le rite et, à maintes reprises, Favrier avait croisé des combattants des Forces libanaises tenant un chapelet dans une main et une kalachnikov dans l’autre. Lorsque se présentait un véhicule devant la barrière du check-point, la sentinelle discernait sans mal derrière le pare-brise une petite croix de bois, une main de Fatma dorée ou une épée d’Ali pendant au bout d’une chaînette accrochée au rétroviseur. Et tous les soldats de Tsahal portaient sous la veste de leur treillis une étoile de David. Favrier se disait alors que Dieu était chez lui au Moyen-Orient.
Lorsque je dois nommer un personnage dans un de mes romans, expliquait-il au cours du dîner, dans le brouhaha de la conversation et le cliquetis des couverts sur les assiettes, je commence par consulter de vieilles correspondances du xviiie siècle, des faits divers dans les journaux du xixe siècle ou des annuaires du xxe siècle. Et puis je finis par choisir un patronyme éteint ou oublié de tous. Parce que, concluait-il avec autant d’éclat que de fierté manifeste, j’ai observé que le nom d’un personnage de fiction ne paraît véridique, et donc crédible, que s’il a été réellement porté par quelqu’un dans la vraie vie.
Cela avait commencé avec la montée du nazisme. Plusieurs générations des siens avaient été victimes de la folie meurtrière d’un homme qui projetait leur anéantissement. On aurait pu penser que ses contemporains en tireraient les leçons, mais la chute d’Hitler n’avait pas mis un terme aux manifestations d’hostilité envers les juifs : celles-ci s’étaient simplement déplacées en un autre lieu géographique. Au point que, depuis la création de l’État d’Israël, chaque génération du peuple hébreu avait eu son conflit armé.
Au fond, se disait-il à présent, la vie était à l’image d’un manège de chevaux de bois. Au début, on tourne sans s’arrêter, et l’on croit que la ronde ne s’interrompra jamais, parce que la musique de fête foraine est douce comme l’enfance et qu’elle vous enivre, et l’on s’enhardit alors, et l’on commence à y croire, certain que l’on est de pouvoir dominer le mécanisme du manège, ce manège qui est un autre mot pour désigner la destinée, et l’on s’efforce d’attraper les anneaux à l’aide d’un bâton que l’on tient avec fierté au bout du bras tendu, à la manière d’un chevalier qui charge au cours d’un tournoi avec sa lance portée en avant, et tout cela sans imaginer qu’il faudra bien finir un jour par descendre de son destrier de bois, car vient un moment où l’on en tombe, par fatigue, par inadvertance ou du fait d’un événement extérieur, et la musique expire alors comme dans un dernier souffle. Trois petits tours et puis s’en vont, dit la chanson.
C’était cela, leur lot commun à tous sur cette terre : disparaître. Et elle était là, dans la mort qui frappait tous les hommes, l’égalité parfaite que les révolutionnaires de tous lieux et de toutes époques cherchaient depuis l’origine des temps à imposer aux autres. Était-ce la raison pour laquelle les hommes se faisaient la guerre ? Cherchaient-ils ainsi l’égalité totale et absolue ?
Belleface était convaincu que les hommes continueraient éternellement de reprocher aux juifs d’exister au seul motif que les juifs sont juifs. Le seul moyen de survivre était de se préparer aux pires épreuves, et de suivre un perpétuel entraînement au combat – ce qu’il n’avait cessé de faire au long de son existence. Un homme devait-il prendre la responsabilité de donner vie à un enfant en sachant que ce dernier n’aurait pour destin que d’apprendre à survivre ? Non, il ne voulait pas de tout cela. Et il savait, en pensant cela, qu’il touchait à l’une de ses convictions les plus intimes. « Alors je félicite les morts qui sont déjà morts plutôt que les vivants qui sont encore vivants. Et plus heureux que tous les deux est celui qui ne vit pas encore et ne voit pas l’iniquité qui se commet sous le soleil », dit L’Ecclésiaste.
Survivre à la Shoah, se disait-il maintenant, c’était non seulement apprendre à vivre avec la colère, mais aussi accepter l’obligation de prendre une revanche sur la vie. C’était un devoir dont il était redevable envers les siens, envers tous ceux qui avaient péri dans le camp de Treblinka. Dans son cas, la revanche sur la vie passait par la vengeance. Et cette vengeance s’appelait réparation : elle était un préalable à toute forme de reconstruction. Nul ne le convaincrait jamais du contraire.