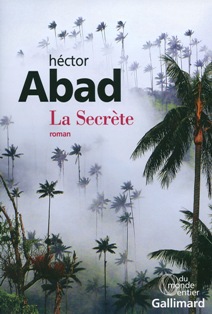J'ai beaucoup aimé
Titre : Cow-boy
Auteur : Jean-Michel ESPITALLIER
Parution : 2020
Editeur : Inculte
Pages : 144
Présentation de l'éditeur :
De cet aïeul propre à susciter des légendes, on ne sait presque rien. Son histoire est comme un trou de mémoire dans la mythologie familiale.
Tour à tour enquête, western, histoire de l’univers en accéléré, peinture de la vie quotidienne des cow-boys californiens, voyage fantastique à travers le continent américain, méditation sur la mémoire, ce récit reconstitue le parcours de ce personnage inconnu. Jusqu’à la belle histoire d’amour qui l’unit à la grand-mère de l’auteur.
D’une grande diversité de cadences et de styles, ce livre joue de toute la puissance de la littérature pour redonner vie à nos fantômes et reconstituer les choses disparues. Surtout celles que l’on n’a pas vues.
Le mot de l'éditeur sur l'auteur :
Avis :
Construire un livre sur du vide était une gageure, que Jean-Michel Espitallier a brillamment réussie. Car, du parcours de cet aventureux grand-père, il ne reste que le regret chez son petit-fils de n’en rien savoir du tout. Butant indéfiniment sur un silence familial rendu irrévocable par le décès de son père, par ailleurs étonnamment indifférent au sujet, l’auteur a transmué sa frustration en un ouvrage atypique, original dans sa forme, où la reconstitution historique teintée d’ironie grinçante devient, par défaut, la seule réponse possible aux questions d’une imagination condamnée à tourner dans le vide.
Retraçant le parcours des candidats européens à l’immigration américaine jusqu’à leur entrée, puis leur installation, sur le nouveau continent, le texte nous entraîne dans une traversée de l’histoire et des vastes étendues qui mènent au Far West, au fil d’une restitution documentée et réaliste qui semble toujours se défendre d’un trop grand sérieux. Non content de nous faire sourire par l’impertinente causticité et par l’audace sans fard de son franc-parler, l’auteur s’amuse aussi à casser les codes de l’écriture classique, dans une série d’exercices de style originaux et surprenants, souvent à double tranchant. A mes yeux tantôt amusants, tantôt irritants, ils m’ont parfois lassée, comme certaines de ces listes à n’en plus finir ou ces juxtapositions poétiques de mots, mais ils s’assortissent indéniablement d’une grande maîtrise de style et d’une plume d’une remarquable beauté.
Toute cette ironie incisive et sans concession ne parvient jamais à masquer la justesse et la sensibilité d’un texte qui exhale un sentiment doux-amer de mélancolie. S’y laisse deviner un destin aux ailes coupées, celui d’un homme peut-être resté emprisonné dans un carcan familial et social, où sentiments et aspirations personnelles n’avaient guère droit de cité. Au point de disparaître quasiment sans trace dans l’oubli, enfouis dans un néant devant lequel, un siècle plus tard, l’auteur est, bien à regret, obligé de s'incliner. (4/5)
Citations :
À la fin des années 1860, on donne la terre pour peu que l’agent du cadastre qui vient allouer les lopins s’assure qu’une maison comportant au moins une fenêtre vitrée et une porte a bien été construite. Née de rien, la propriété privée a métastasé au gré d’un trafic de portes et de fenêtres démontées et passées au voisin sitôt l’agent du cadastre parti. Là-dessus, un type a inventé le fil de fer barbelé pour que chacun chez soi et les bêtes seront bien gardées.
Il faut dire qu’en Amérique tout va toujours très vite. Cent cinquante-six ans séparent l’arrivée du Mayflower au Cape Cod de la Déclaration d’indépendance. Cinquante-sept mille jours, cinq petits milliards de secondes. Il en fallut huit fois plus, chez nous, pour passer du baptême de Clovis à la Ire République. Et vu que c’est l’Américain qui tient la plume pour raconter l’Amérique, l’histoire n’existe pas avant le Mayflower. Pas d’Antiquité américaine (des Indiens), pas de Moyen Âge américain (des Indiens), pas de féodalité américaine (des Indiens), pas de Renaissance américaine (des Indiens), pas de rois américains (des Indiens). L’Américain passe du vide (indien) au plein (américain) en moins de six générations.
Et donc, l’Américain a brûlé les étapes. Il reste un gros bébé capricieux, débrouillard, brutal et pas très bien élevé. Collé au puritanisme originel mais hors-la-loi dans le sang. Obsédé par la reproduction – de l’espèce, des langues, des choses, des images – et les grands espaces à conquérir, ce qui développe évidemment une énergie considérable et un vif instinct de survie, c’est-à-dire de ruse, lesquels, ajoutés au rigorisme protestant, donneront au sens des affaires un sérieux coup d’accélérateur.
Le miracle américain est une marche en avant, au pas de course. La Manifest Destiny, ce ressort tendu depuis la côte est en direction des contrées sauvages de l’Ouest, doit répandre la démocratie et la prospérité au-delà des Rocheuses, au besoin à coups de winchester. Glory ! Glory ! Hallelujah ! L’Amérique est un corps en expansion qui semble sans frein, sans frontière, sans répit. Une grosse paire de poumons qui gonfle et aspire tout ce qui passe à sa portée. Une fringale d’espaces vierges et une hystérie de conquêtes. Pour un peu, on croirait qu’un jour l’Américain va vouloir grimper sur la Lune.
Le malin ne s’encombre pas de principes. En plus, là-bas, il est majoritairement protestant, ce qui favorise les comptabilités bien ordonnées et libère des corsets catholiques, tous ces baratins de vœux de pauvreté, modestie expiatoire, j’en passe.
Le rêveur prend quant à lui le rêve au pied de la lettre. Il croit tellement au Père Noël qu’un beau jour, à New York, il se dégote un petit malin qui finit par le lui inventer en vrai.
The winner is ? Celui qui tire le premier, parce que sinon il est le premier à être tiré. Celui qui tire le premier est toujours celui qui va s’en tirer.
Eugène est un peu paumé parce qu’il sent qu’il est loin, très loin, et pour de bon. Loin d’où, ça il ne sait plus très bien. Loin de lui-même peut-être. De ce lui-même qu’il est en train d’abandonner dans cette mue géographique, comme si les kilomètres parcourus l’avaient tranquillement épluché.
Dans ces familles des montagnes, pieuses par instinct de soumission, dures à la tâche, dévouées au travail élevé au rang de valeur morale à condition qu’il soit pénible, on ne dit pas l’amour, on ne prononce pas la grande déclaration qui vibre et fait vibrer, c’est trop difficile à sortir, trop gênant à entendre, trop compliqué à porter. Et ça ne se fait pas. Eugène sent bien quelque chose qui le chatouille subitement au niveau du plexus solaire chaque fois qu’il revoit Marie-Rose, remonte en vagues d’enchantements jusqu’au cerveau, lui procure des ondes chaudes dans tout le corps et lui fait voir le moindre bout de chose comme des bouts de merveilleux, comme des bouts de choses merveilleuses. Mais quand ça arrive à la bouche, il pince les lèvres sans y penser, ça vient tout seul, ce bouchon naturel de mots. Et ça ne sort pas. Bouche bouchée. Ces choses-là ne se disent pas. De toute façon, quand bien même forcerait-il la sortie des mots qui enchantent qu’il ne saurait pas trop comment s’en dépatouiller. Et par où commencer. Et comment dire. Non, on ne parle pas d’amour, le sentiment est superflu, son expression ferait comme un chahut dans le conformisme bigot et les vieilles aliénations, il n’est qu’un motif à peu près nécessaire, et encore pas toujours. On considère les bénéfices et les inconvénients, on soupèse les conséquences, notamment économiques, on évalue les aboutissements pour des projets plus intéressants. Dans un accord parfait avec ce qu’il convient de faire et que tout le monde fait. Alors on passe directement aux choses sérieuses : « Veux-tu m’épouser ? » et puis voilà. Cela fait déclaration. Cela fait preuve. Tout le reste, gnagnasseries ! Valse de balivernes ! Ça lui passera avant que ça nous reprenne ! Il faut renoncer aux sentiments pour rien. Les étouffer sitôt senties les palpitations drôles. Sinon, on se perd en palabres inutiles qui font dévier la vie, les plans de vie, et donnent des énergies qui ne produisent que des tracas. L’amour est juste la mise à feu d’une façon de transformer une situation en choses pratiques, un destin qui n’en est pas un, administratif et catholique, tout le monde à l’église, c’est comme ça, et c’est comme ça pour tout le monde, pour tout le monde pareil, terre à terre, la magie c’est une stabilisation, voilà, parfois quelques hectares de pâture de gagnés, et plus souvent encore l’idiote satisfaction de répondre aux convenances, aux attentes communautaires qui ne veulent ni dérangements ni choses qui partent de travers. La vie, rien de spécial, en somme.