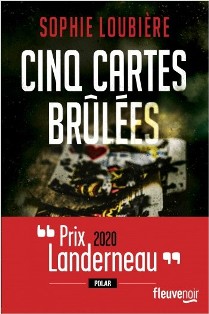J'ai beaucoup aimé
Titre : Ravage
Auteur : Ian MANOOK
Parution : 2023 (Paulsen)
Pages : 352
Présentation de l'éditeur :
Red Arctic, hiver 1931. Une meute d’une trentaine d’hommes armés,
équipés de traîneaux, d’une centaine de chiens et d’un avion de
reconnaissance pourchasse un homme. Un seul. Tout seul. C’est la plus
grande traque jamais organisée dans le Grand Nord canadien. Pendant six
semaines, à travers blizzards et tempêtes, ces hommes assoiffés de
vengeance se lancent sur la piste d’un fugitif qui les fascine. Cette
course-poursuite va mettre certains d’eux face à leur propre destin. Car
tout prédateur devient un jour la proie de quelqu’un d’autre…
Le mot de l'éditeur sur l'auteur :
Ian Manook a sillonné le monde pour son plaisir, puis en qualité de
journaliste avant de se consacrer à l’écriture. Il se fait remarquer en
2013 avec le roman policier
Yeruldelgger (Albin Michel).
L’ancien routard s’est ensuite consacré à une trilogie de thrillers
islandais, pays dont les légendes et croyances l’ont séduit et inspiré
pour ce nouveau roman imprégné de culture insulaire et maritime.
À Islande ! a reçu le Prix Compagnie des Pêches de Saint-Malo lors du festival Étonnants Voyageurs (juin 2022).
Avis :
Spécialisées en littérature de voyage et d’exploration, les éditions Paulsen accueillent pour la seconde fois l’écrivain bourlingueur Ian Manook, qui, après une série de thrillers consacrés aux rudes terres d’Islande, nous embarque dans une traque échevelée à travers le Grand Nord canadien, d’après un fait divers survenu au tout début des années 1930.
Qui était-il et d’où venait-il ? Nul n’a jamais su précisément, mais surnommé le « Trappeur Fou de la Rat river », il est entré dans la légende de la région d’Aklavik, un village des Territoires du Nord-Ouest Canadien, en zone arctique. L’histoire débute en plein hiver 1931, par les moins quarante degrés habituels, lorsque des Loucheux – ainsi nomme-t-on les Indiens locaux – viennent porter plainte contre un nouveau venu, un colosse au farouche tempérament, apparu sans tambour ni trompette et désormais installé avec ses lignes de trappe, sans en demander l’autorisation, à quelque cent trente kilomètres du village. Une équipe de la Gendarmerie royale est diligentée sur place pour une mission de contrôle qui tourne au drame. Des coups de feu sont échangés, un policier est blessé et il faut dynamiter sa cabane pour en extraire le forcené. L’homme ayant réussi à prendre la fuite, commence une traque dantesque, à travers blizzards et tempêtes, qui durera six semaines, engagera des forces a priori disproportionnées – trente hommes armés, soixante-dix chiens de traîneaux, un avion de reconnaissance – et, après avoir laissé se développer le sentiment d’une invincibilité quasi surnaturelle du fugitif, s’achèvera dans le sang d’un hallali sauvage et vengeur.
Raconté du point de vue des poursuivants, eux aussi des individus au physique et au mental hors du commun, le roman oscille entre l’état d’esprit plus pondéré des représentants des forces de l’ordre et la soif de vengeance des trappeurs déchaînés auxquels ils ont fait appel pour les aider à courser le fugitif. Si tous sont impressionnés par les incroyables capacités du fuyard, en telle osmose avec leur infernal environnement que sa résistance et ses ruses semblent les narguer à les en rendre fous, ils savent aussi, depuis que l’un, puis deux des leurs se sont retrouvés au tapis, le premier blessé, l’autre tué, qu’il n’y aura pas de pitié ni de justice autre que celle de ces espaces sauvages et glacés, torturés par le blizzard, asphyxiés par les brouillards, égarés dans le grand blanc. Et tant pis si cet homme qui n’avait jamais que prétendu à une vie solitaire, loin des hommes et de leurs lois, n’a toujours agi qu’en légitime défense. On n’échappe pas ainsi au monde, qui entend contrôler jusqu’au dernier lambeau de territoire sauvage et qui règle parfois ses comptes sans autre forme de procès, avec le pire acharnement.
Entre les dangereuses somptuosités d’une nature blanche et glacée et le tragique aveuglement de la vindicte humaine, ce polar noir mené tambour battant sur la trame de faits réels est aussi un superbe roman d’aventure que l’on n’a aucun mal à imaginer projeté sur un autre écran blanc, cinématographique cette fois. (4/5)
Citations :
En meute, les hommes ne sont pas des loups. Ils ne respectent pas les consignes et la stratégie de l’alpha. Être en bande leur donne un courage malsain. Ce n’est pas une force organisée, mais un assemblage de violences individuelles.
Le soleil ne se couche pas. Il ne s’est pas montré de la journée. La clarté du jour se noie juste dans la nuit qui se glisse entre les ombres. La nuit ne tombe pas, c’est un mensonge, elle monte de la terre, sournoise, et surprend les hommes qui la cherchent encore dans le ciel.
La ville est enterrée sous une épaisse croûte de neige, les maisons arc-boutées contre les assauts d’un vent hystérique. Chaque bourrasque est un assommoir. Dans les rues désertes, des rubans de neige s’agitent au ras du sol comme des serpents haineux, puis se redressent en lanières de fouet et leur cinglent le visage. Le vent frise les toits de lambrequin d’un givre abrasif qui poudroie dans les rares éclairages ouatés par la neige.
Ils décollent sans difficulté deux heures plus tard, mais le ciel change aussitôt. Wright n’avait pas piloté dans des conditions aussi épouvantables depuis son mercy flight vers Fort Vermilion. Une tempête de neige haute et dense comme l’Everest. Un tourbillon de flocons que des bourrasques fantasques tordent en brusques tornades de cristaux de glace, jusqu’à trois cents mètres au-dessus du sol. Dans la seconde, plus aucune visibilité, ni du sol ni du ciel. Wright navigue aux instruments, les yeux rivés sur sa boussole et son altimètre. Il pense que le vent du nord, fusant depuis la banquise de la mer de Beaufort et canalisé par la chaîne des monts Mackenzie, est un vent rasant. Qu’il devrait suffire, pour s’en protéger, de monter à mille deux cents mètres dans les nuages, mais il n’a jamais été confronté à ce cas de figure. Là-haut, ce sont des vents d’ouragan. Des vents haineux de poudrin qui poncent la carlingue. Déchaînés, violents, rageurs. L’avion est malmené, le bruit du grésil sur le cockpit assourdissant. C’est une force surnaturelle, démesurée, obstinée, appliquée à les détruire. Plusieurs fois, le vent de face tabasse si fort que les trois hommes sont projetés vers l’avant, comme dans une collision, le corps meurtri par leur ceinture. Wright a beau donner toute la puissance du moteur, le carburateur ouvert au maximum, les vents contraires condamnent le Bellanca à faire du sur-place. Des tourbillons de neige enveloppent l’avion, et la ronde hystérique des flocons leur donne plusieurs fois l’illusion terrifiante qu’ils volent à reculons.
Jones ne se laissera jamais prendre vivant.
— Comment pouvez-vous en être si sûr ?
— Parce que c’est un coureur de bois. Empêchez-le de courir et il préférera mourir. Il n’est plus du même monde que nous, Wright, il est passé de l’autre côté. Du côté des lagopèdes, des bœufs musqués, des caribous et des loups. Un animal, ça ne se rend pas. Ça se fait abattre par surprise, ça fuit ou ça fait face jusqu’à la mort.
Ce brave Bauwen appartient désormais à ce que les Indiens appellent « le temps long ». Celui des morts, des esprits, des éternités promises…
— Le temps long de ceux qui restent, aussi, lance Wright. Du vide, de l’attente, des souvenirs… Je plains sa femme.
Ils gardent le silence pendant le reste du vol. Mais, quand ils survolent Aklavik sous un ciel dégagé pour la première fois, Wright ne peut s’empêcher de penser que ce bourg reculé ne demande qu’à s’abandonner au temps long. Les gens qui vivent ici sont moitié perdus, moitié condamnés. Loin du temps fou des grandes villes.
— Alors pourquoi avoir accepté cette mission contraire à vos principes ?
— Je vous l’ai dit, Walker, je suis un témoin privilégié de l’époque. À voir les choses de haut, on devient lâche. J’apporte mon aide, mais je continue à vendre mes services de pilote pour conserver mon confort de vie. C’est le confort qui mènera ce monde à sa perte, Walker, en étouffant nos indignations, nos révoltes, nos colères pour un aspirateur ou un autoradio dernier cri. C’est pour ça que vous n’aurez pas Jones vivant.
— Je ne vois pas le rapport.
— Jones n’a plus rien à perdre. Sa mort ne le privera de rien.
— De sa vie, quand même, excusez du peu.
— Quelle vie, Walker ?
Comment peut-on traquer un homme depuis cinq semaines déjà pour le mettre à mort sans rien savoir de lui ? Rien. Pas même son nom. Quelle mécanique absurde s’est enclenchée pour condamner un inconnu ? Pas de nom, pas d’adresse, pas de passé, pas d’histoire. C’est pourtant le principe même de la justice. Chercher à connaître l’homme pour comprendre le geste. D’après ce que Wright a recueilli des uns et des autres, Jones trappait depuis six mois sur la Rat River sans que personne ait eu à se plaindre de lui. Il avait fait exactement ce qu’il avait annoncé lorsque Bauwen l’avait interrogé sur ses intentions : se retirer pour trapper et se faire oublier. Et il avait suffi de la dénonciation d’un Loucheux pour tout faire basculer. Quelques mots. Même pas consignés. Sans preuve. Bien sûr, le système est ainsi fait qu’il s’auto-justifie. C’est précisément pour aller chercher des preuves que Bauwen aura envoyé Billy et Barnhard jusqu’à la cabane. C’est pour son silence obstiné que Walker aura envoyé quatre hommes armés avec un mandat de perquisition. C’est parce que l’attitude du trappeur aura été considérée comme un outrage à la Gendarmerie royale que l’usage de la force sera légitimé. Et même s’il s’est avéré depuis que le fougueux Billy a menti et qu’il a bien fait feu le premier, le tir de Jones sera considéré comme une tentative d’homicide. Volontaire, même. D’ailleurs, Jones finira par tuer Bauwen – preuve s’il en est qu’il était bien, dès le départ, l’assassin qu’on fera de lui. Ainsi va et se perpétue le système…
— Ce Jones n’est pas fait en mousse de nombril, murmure Wright.
— Il doit être d’une force incroyable, répond le médecin, mais ce n’est pas l’essentiel. Ce qu’il faut vraiment pour endurer tout ça, c’est une volonté d’acier, une force de caractère hors du commun.
— Ou c’est un obstiné, un têtu, corrige Wright, un type déjà mort qui n’a plus rien à perdre. Parfois, j’ai l’impression d’avoir affaire à un animal.
— Il est plus nuancé que l’animal. L’animal connaît deux modes : proie, il prend la fuite, prédateur, il attaque. Quelques animaux sont capables des deux. J’ai entendu dire que les léopards qui se sentent traqués décrivent un large cercle pour rattraper et prendre à revers ceux qui suivent leur piste. Mais pas pour jouer. Pour attaquer. Notre horde est à ses trousses depuis des semaines, pourtant Jones ne fuit pas vraiment et n’attaque jamais. Il adopte une sorte de stratégie défensive.
— Pour quelle raison, d’après vous ? Söderlund réfléchit et Wright le regarde d’un autre œil. Cette façon qu’il a d’être à l’aise dans la tourmente. Un homme qui sait marcher avec des raquettes au fin fond d’une forêt canadienne en hiver. Un homme qui en a vu d’autres. Étonnamment solide pour son âge.
— Peut-être parce qu’on s’acharne à l’empêcher de vivre comme il le veut.
C’est un lendemain de la veille, comme on dit, un matin de gueule de bois. Les hommes émergent des tentes, rasés avec une biscotte et coiffés en pétard, la tête bourrée d’étoupe, pour constater que le monde n’est plus. Un vide compact. Dense et vaporeux à la fois. Il commence si près de l’ouverture des tentes qu’ils n’osent poser une main en dehors, de peur de tomber dans un vide sidéral. Ils s’appellent sans se voir, leurs réponses étouffées par le brouillard. Plus rien n’existe au monde que la tente de chacun.
— Comment Hattaway peut-il savoir qu’il va neiger ?
— Il le sait. Il a des instruments et des livres, il fait des calculs, déclare fièrement Huapikun. Il a dit deux jours de neige et de brouillard.
— Comment peut-il neiger dans le brouillard ? s’étonne Claudel, le nez dans son bol de soupe.
— Mon homme dit que ce brouillard-là est une sorte de neige en suspension. Quand l’humidité aura saturé le nuage, les flocons vont se former et se mettre à tomber. C’est ce qu’il a dit.
— Ce Jones est quand même un mystère. Et dire qu’on ne sait toujours pas qui c’est…
— On ne sait pas qui il a été, mais on sait très bien qui il est. Un homme malin, courageux, endurant, intuitif, dur au mal, résolu. Un type qui vit selon ses convictions, même si elles sont contraires aux nôtres, et qui pense ne faire que se défendre. Un type qui n’a peur ni de nous, ni du blizzard, ni du grand froid, ni de la montagne, ni même de la mort, mais qui fuit les hommes…
— Attention, inspecteur, à vous entendre, on pourrait bien croire que vous l’admirez, ce Jones, se moque Hattaway.
— Oui, on pourrait le croire. C’est vrai qu’à défaut d’admirer l’homme, ce qu’il endure force l’admiration.
Du même auteur sur ce blog :