Coup de coeur 💓
Titre : Artifices
Auteur : Claire BEREST
Parution : 2021 (Stock)
Pages : 308
Présentation de l'éditeur :
Abel
Bac, flic solitaire et bourru, évolue dans une atmosphère étrange
depuis qu’il a été suspendu. Son identité déjà incertaine semble se
dissoudre entre cauchemars et déambulations nocturnes dans Paris. Reclus
dans son appartement, il n’a plus qu’une préoccupation : sa collection
d’orchidées, dont il prend soin chaque jour. C’est cette errance que vient interrompre Elsa, sa voisine, lorsqu’elle atterrit ivre morte un soir devant sa porte. C’est cette bulle que vient percer Camille Pierrat, sa collègue, inquiète de son absence inexpliquée. C’est
son fragile équilibre que viennent mettre en péril des événements
étranges qui se produisent dans les musées parisiens et qui semblent
tous avoir un lien avec Abel.
Pourquoi Abel a-t-il été mis à pied ? Qui a fait rentrer par effraction un cheval à Beaubourg ? Qui dépose des exemplaires du Parisien où figure ce même cheval sur le palier d’Abel ? À quel passé tragique ces étranges coïncidences le renvoient-elles ? Cette série de perturbations va le mener inexorablement vers Mila. Artiste internationale mystérieuse et anonyme qui enflamme les foules et le milieu de l’art contemporain à coups de performances choc. Pris dans l’œil du cyclone, le policier déchu mène l’enquête à tâtons, aidé, qu’il le veuille ou non de Camille et d’Elsa.
Le nouveau roman de Claire Berest est une danse éperdue, où les personnages se croisent, se perdent et se retrouvent, dans une enquête haletante qui voit sa résolution comme une gifle.
Pourquoi Abel a-t-il été mis à pied ? Qui a fait rentrer par effraction un cheval à Beaubourg ? Qui dépose des exemplaires du Parisien où figure ce même cheval sur le palier d’Abel ? À quel passé tragique ces étranges coïncidences le renvoient-elles ? Cette série de perturbations va le mener inexorablement vers Mila. Artiste internationale mystérieuse et anonyme qui enflamme les foules et le milieu de l’art contemporain à coups de performances choc. Pris dans l’œil du cyclone, le policier déchu mène l’enquête à tâtons, aidé, qu’il le veuille ou non de Camille et d’Elsa.
Le nouveau roman de Claire Berest est une danse éperdue, où les personnages se croisent, se perdent et se retrouvent, dans une enquête haletante qui voit sa résolution comme une gifle.
Le mot de l'éditeur sur l'auteur :
Après une maîtrise de Lettres à la Sorbonne, Claire Berest publie son premier roman, Mikado, à 27 ans. Suivront deux autres romans, L’orchestre vide et Bellevue (Stock, 2016) et deux essais, La lutte des classes, pourquoi j’ai démissionné de l’Éducation nationale, et Enfants perdus, enquête à la brigade des mineurs. En 2017, elle écrit Gabriële avec Anne Berest. En 2019 sort Rien n’est noir, pour lequel elle reçoit le Grand Prix des lectrices de ELLE.
Syndrome de stress post-traumatique : jamais Abel, jusqu’à ces derniers jours totalement investi dans la routine absorbante de son métier de flic, n’aurait pensé que cela lui tomberait dessus, après tant d’années d’un équilibre en apparence à peu près stable. Le premier gros coup de canif à sa tranquillité est bien sûr sa suspension, pour l’instant inexpliquée, qui fait soudain tomber le paravent qui faisait écran entre son quotidien actif et les blessures anciennes auxquelles il pensait pouvoir tourner le dos. Soudain aussi vulnérable qu’un bernard-l’hermite expulsé de la coquille où il avait cru s’abriter, exposé sans défense à la résurgence de souvenirs torturants, le voilà de surcroît en butte à une série de troublantes coïncidences, qui, comme autant d’insidieuses allusions, ou alors de signes du vacillement de sa raison, ne cessent de pointer de plus en plus nettement vers ce passé terrible que rien ne semble plus pouvoir contenir.
Combien de temps Abel pourra-t-il tenir, entre les intrusions de cauchemars récurrents, qu’il rente d’oublier en déambulant dans Paris la nuit et en soignant sa collection d’orchidées le jour, reclus dans son appartement, et celles d’un monde extérieur bien décidé, semble-t-il, à lui arracher ses derniers lambeaux de santé mentale ? Elles sont trois à l’empêcher de refermer totalement les écoutilles : son envahissante nouvelle voisine Elsa, sa collègue Camille Pierrat qui s’inquiète de son silence, et surtout, de manière de plus en plus évidente, une dénommée Mila, déconcertante artiste anonyme devenue mondialement célèbre pour ses impressionnantes performances, à l’avant-garde de l’art contemporain.
Toute la tension de la narration provient de ce mystérieux drame, survenu deux décennies plus tôt, qui va peu à peu se dévoiler à la connaissance du lecteur, et de ses bizarres correspondances avec les spectaculaires et transgressives performances d’une artiste dont personne, si ce n’est son avocat et agent, ne connaît le visage. C’est donc dans un climat étrange et mystérieux, en compagnie de personnages de plus en plus manifestement les proies d’une grande et ancienne souffrance perturbant leur équilibre psychique, que l’on avance dans une intrigue puissamment construite qui tient le lecteur en haleine de bout en bout.
La souffrance peut rendre fou, mais avant d’éclater au grand jour, dans un paroxysme parfois aussi soudain que violent, la folie mûrit parfois lentement, hibernant longuement pour mieux frapper ensuite, ou demeurant plus ou moins discrètement tenue en laisse grâce à des dérivatifs capables de la canaliser. L’expression artistique devient ici exutoire et sublimation, dans un débordement d’émotions et de sensations, ici volontairement provocant, que le spectateur perçoit sans toujours le comprendre. L’oeuvre est un ressassement infini, une déclinaison travaillée de production en production, où reviennent en filigrane les mêmes obsessions, celles qui cristallisent les blessures de l’âme de l’artiste. Que serait devenue Mila sans cet antidote à sa colère ? Tout comme Abel, sans ses orchidées ?
Hommage à Marina Abramovic et à son art unique et éphémère de la performance, ce fascinant roman est tout autant l’occasion de découvrir cet angle extrême, souvent très dérangeant, de l’art contemporain, que de se plonger dans un récit addictif qui nous fait quitter subrepticement les rivages incertains de la santé mentale. Un livre original et fort, et un nouveau coup de coeur pour cet auteur. (5/5)
Avis :
Combien de temps Abel pourra-t-il tenir, entre les intrusions de cauchemars récurrents, qu’il rente d’oublier en déambulant dans Paris la nuit et en soignant sa collection d’orchidées le jour, reclus dans son appartement, et celles d’un monde extérieur bien décidé, semble-t-il, à lui arracher ses derniers lambeaux de santé mentale ? Elles sont trois à l’empêcher de refermer totalement les écoutilles : son envahissante nouvelle voisine Elsa, sa collègue Camille Pierrat qui s’inquiète de son silence, et surtout, de manière de plus en plus évidente, une dénommée Mila, déconcertante artiste anonyme devenue mondialement célèbre pour ses impressionnantes performances, à l’avant-garde de l’art contemporain.
Toute la tension de la narration provient de ce mystérieux drame, survenu deux décennies plus tôt, qui va peu à peu se dévoiler à la connaissance du lecteur, et de ses bizarres correspondances avec les spectaculaires et transgressives performances d’une artiste dont personne, si ce n’est son avocat et agent, ne connaît le visage. C’est donc dans un climat étrange et mystérieux, en compagnie de personnages de plus en plus manifestement les proies d’une grande et ancienne souffrance perturbant leur équilibre psychique, que l’on avance dans une intrigue puissamment construite qui tient le lecteur en haleine de bout en bout.
La souffrance peut rendre fou, mais avant d’éclater au grand jour, dans un paroxysme parfois aussi soudain que violent, la folie mûrit parfois lentement, hibernant longuement pour mieux frapper ensuite, ou demeurant plus ou moins discrètement tenue en laisse grâce à des dérivatifs capables de la canaliser. L’expression artistique devient ici exutoire et sublimation, dans un débordement d’émotions et de sensations, ici volontairement provocant, que le spectateur perçoit sans toujours le comprendre. L’oeuvre est un ressassement infini, une déclinaison travaillée de production en production, où reviennent en filigrane les mêmes obsessions, celles qui cristallisent les blessures de l’âme de l’artiste. Que serait devenue Mila sans cet antidote à sa colère ? Tout comme Abel, sans ses orchidées ?
Hommage à Marina Abramovic et à son art unique et éphémère de la performance, ce fascinant roman est tout autant l’occasion de découvrir cet angle extrême, souvent très dérangeant, de l’art contemporain, que de se plonger dans un récit addictif qui nous fait quitter subrepticement les rivages incertains de la santé mentale. Un livre original et fort, et un nouveau coup de coeur pour cet auteur. (5/5)
Citations :
Oui, il était fasciné par ce que les gens révélaient d’eux-mêmes en permanence comme en hurlant avec un mégaphone. Fasciné par les réseaux sociaux, les longs tunnels de phrases et de clichés clinquants comme des réverbères dans une boîte noire ; images de soi partout comme des miroirs pendus en place des feuilles des arbres, il était subjugué par les selfies, qui forçaient à se regarder soi, qui rendaient chacun spectateur agissant de sa personne imparfaite, selfies qui obligeaient à la douceur, au pardon de soi, selfies qui disaient l’absence, la fission du noyau. Combien avait-il pu, Abel, en décortiquer dans les procédures ? Les selfies des autres, les téléphones pleins comme des œufs rances et doux, de secrets et de petits arrangements, de suspicion et d’impudeur.
Il aurait tant aimé faire cela, se prendre en photo à bout de bras, plonger ses yeux, à travers la lentille morte, dans les yeux d’un autre qui aurait envie de le regarder, qui serait intéressé par son geste, quelqu’un qui regarderait sa photographie.
Il aurait tant aimé faire cela, se prendre en photo à bout de bras, plonger ses yeux, à travers la lentille morte, dans les yeux d’un autre qui aurait envie de le regarder, qui serait intéressé par son geste, quelqu’un qui regarderait sa photographie.
Elle se dit qu’ils devraient se parler vraiment. Sans jeu, sans évitement. Et elle pense à cette phrase idiomatique : Il faut qu’on se parle vraiment. Ce cliché langagier des couples ou des familles en crise qui, en disant cela, désirent provoquer un chambardement, un changement de décor ou d’atmosphère. Comme si d’habitude on se parlait faussement. Comme si se parler en prenant des pincettes, en mesurant la susceptibilité de l’autre, en calculant les pièges des aveuglements et des failles narcissiques, c’était se parler avec fausseté.
C’était quelque chose qu’elle s’était dit, Mila : sur trente-six mille communes en France, pourquoi avait-il fallu qu’ils choisissent celle-là, ses parents ? La ville où aurait lieu l’une des rarissimes tueries de masse commises par un seul individu que le pays, voire l’Europe, aient connu au vingtième siècle. Ça l’a toujours laissée songeuse, ces multiples choix arbitraires que nous faisons en permanence, telle une armée de morceaux biscornus d’un puzzle sauvage. L’essence même de l’absurde implacabilité du fait divers. (…)
La contingence, la possibilité qu’une chose arrive ou n’arrive pas, qu’un être existe ou n’existe pas.
Les musées faisaient d’excellents squares où baguenauder pour s’aérer les idées. Il faudrait que les musées soient ouverts comme des parcs, des lieux de circulation libre où l’on irait boire un café avec un collègue, ou faire sa pause sandwich en lisant un livre. Et s’allonger par terre pour une petite sieste.
Une des frustrations qu’ils partageaient était de ne jamais savoir la suite des appels qu’ils avaient reçus. Est-ce que ça s’était bien fini ? Est-ce que la personne avait été prise en charge ? Est-ce que la situation était sous contrôle ? Omar trouvait ce sentiment terrible. Il avait dit à Julie une fois : « C’est comme si on t’obligeait à lire un livre, en sachant que tu ne pourras jamais le terminer. » Les appels demandant une intervention n’étaient pas les plus nombreux. Sept ou huit appels sur dix pouvaient être superficiels : des gens qui cherchaient une info ou faisaient une blague, mais aussi des paumés, des personnes âgées, des gens seuls, en crise, en manque, beaucoup d’appels de personnes qui ne supportaient plus le bruit que faisaient leurs voisins, quelques appels de délation aussi, des propos racistes qui fusaient, des gens au bout du rouleau, sous médocs… Il fallait faire le tri très vite : situation d’urgence ou non, besoin d’intervention ou non. Puis, éventuellement, diriger l’interlocuteur vers un autre numéro d’aide.
Mais ce qui est fascinant dans les faits divers, et ça ne loupe jamais, c’est que si tu les mettais dans un roman, les gens n’y croiraient pas. Le réel est insoutenable.
C’est quelque chose qu’il avait érodé de sa mémoire, mais on peut évider tant qu’on veut, on ne fait que ranger sur des étagères que l’on croit hors de portée. À tort.
Le musée d’Orsay a été une gare. Quand on se tient dans son hall, on peut encore imaginer la foule qui devait s’y agglutiner, attendant les trains. Les familles et les solitaires pris dans la si curieuse tension d’être immobiles et au bord du mouvement, caractéristique du voyageur sur le point de partir. Certains lieux sont plus propices aux empreintes du passé, Orsay est tout à fait habité. Une croix sur une carte mentale, lieu où l’on arrive et d’où l’on s’éloigne, carrefour, c’était intelligent de le transformer en musée, passage ambigu de la mémoire. Un bâtiment dont on transforme la finalité doit s’inventer, il s’oblige à faire preuve d’astuces. Ce qui est beau à Orsay, c’est que le visiteur pénètre par le haut, l’ancienne gare s’ouvre à lui sous ses pieds, il n’est pas en position d’être écrasé mais dans celle de pouvoir cueillir. Il peut embrasser le champ entier d’un seul regard, descendre par l’escalier de droite ou celui de gauche, il n’est pas contraint. C’est une aventure.
Il la regarda ce jour-là, à Paris, comme une étrangère. Ou plutôt comme une amante avec qui l’on a vécu jusqu’au détachement et que l’on revoit soudain après des années de séparation. Et la séduction de l’autre éclate, douloureusement, car elle avait fini par nous échapper, diluée dans le temps. On ne se voit plus, quand on se jouxte.
Épier, quand du grabuge se fait entendre, est une action bancale qui oscille entre le voyeurisme et le courage. La curiosité malsaine (ça se passe mal quelque part, j’ai envie d’en savoir plus) pouvant se transformer parfois en sauvetage (ça se passe très mal, il faudrait que j’intervienne). Abel Bac et Camille Pierrat auraient pu ensemble parler longuement de ce sujet tant ils avaient eu à auditionner de témoins ayant été confrontés à ce dilemme. Les témoins pouvaient se montrer actifs ou passifs (tout l’écheveau qu’il y avait à démêler dans sa tête en une seconde quand le choix se posait entre : il faudrait que j’intervienne, il faut que j’intervienne, j’interviens). Certains témoins se payant pour une vie la culpabilité de n’être pas intervenu. Camille n’était pas toujours tendre quand ils débriefaient après coup : « Ce connard entend une gonzesse qui se fait casser la tête dans l’appart d’à côté et ce gros con augmente le son de sa télé ! » Abel, lui, ne jugeait jamais. Comment savoir qui on est tant que ça ne nous est pas arrivé ? répondait-il à Camille, en substance. Car ce n’était jamais si clair dans la bouche de Bac, qui n’était pas un orateur. Et Elsa, qui était devenue Mila, aurait dit aux deux autres si elle avait participé à leur conversation : c’est le kairos. Elle aurait expliqué quelque chose comme : Kairos c’est le dieu grec de l’action opportune. Avant c’est trop tôt, après c’est trop tard. Il faut saisir ou agir à l’instant T. Sinon on peut traîner l’hésitation ou le manquement toute sa vie. Camille Pierrat aurait alors fait remarquer que Kairos c’était aussi le nom du portail Internet de Pôle Emploi et que l’administration française avait un putain de drôle de sens de l’humour.
Du même auteur sur ce blog :
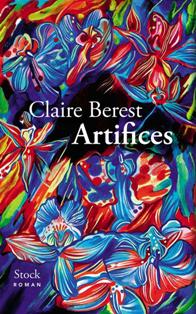

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire