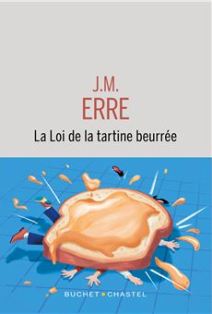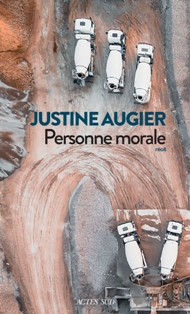J'ai beaucoup aimé
Titre : Si petite
Auteur : François BOYER
Parution : 2024 (Gallimard)
Pages : 128
Présentation de l'éditeur :
« Depuis toujours je n’ai pu oublier ce que j’avais appris de la petite cette année-là. Les souffrances inimaginables infligées par ses parents. J’ai voulu entendre ce que cela avait touché en moi. Raconter ce que cela dénonçait de notre désir d’histoires, et de notre rapport au mal. »
Le mot de l'éditeur sur l'auteur :
Avis :
Le récit commence sur l’hippodrome d’Ecommoy, dans la Sarthe, à l’été 2009. Un cheval tombe, foudroyé en plein galop, sans même que cette mort n’arrête la course ni n’entame la frénésie des turfistes tout entiers à leurs paris. Cette scène inaugurale, Frédéric Boyer en fait la préfiguration symbolique d’un autre drame, survenu les jours suivants dans la même commune, et à propos duquel il se refuse pour de bon à jouer les spectateurs indifférents : après ce que l’on découvrit d’années de maltraitance, une fillette de huit ans y mourait, tuée par des parents qui, s’étant débarrassés du corps, signalaient ensuite la disparition en singeant l’inquiétude.
Cette affaire terrible s’il en est, l’écrivain l’évoque sans jamais de noms et par bribes éparses dans la narration, y revenant comme à une parabole sur le mal et y ancrant une réflexion nourrie de lectures de la Bible et de Saint Paul, de Dostoïevski et de Simone Weil, ou encore des vers de Jodelle. Et puisque le mal est une aporie, que, comme le rabbi de la vieille histoire hassidique citée dans ces pages, l’on ne peut lui opposer au final qu’un silence compassionnel, l’auteur de conclure avec mélancolie dans son face-à-face avec lui-même : « qu’imagines-tu ainsi pouvoir réparer ? Rien. Mais j’ai pensé souffrir avec ce que je ne peux réparer, c’est la signification la plus haute de la compassion. Cela n’éclaire en rien l’âme de celle qui a souffert et qui n’est plus. Mais cela, ai-je dit, nous aide à soutenir la faible humanité que nous sommes sous le poids du mal commis. »
Mêlant inextricablement les registres, tantôt plus personnels, psychologiques et moraux, tantôt davantage métaphysiques, philosophiques et théologiques, une lecture très exigeante qui, pour risquer d’en perdre parfois son lecteur, ne le rattrape que mieux par l’évidence de sa profonde humanité. (4/5)
Citations :
Je disais, à toi qui es moi, avec orgueil et soulagement je n’y participerais pas, jamais, jamais. Sans comprendre que nous participons au mal de différentes et parfois d’invisibles façons. Et parfois même (et surtout ?) en ne faisant rien, en ne bougeant pas, en refusant d’accepter ou d’entériner la franchise terrifiante de l’acte. Et aussi en n’y pensant pas, jamais. Par oubli et par omission. Par peur. Par ignorance aussi. Je me suis dit ça se joue parfois à des détails si minuscules. Je me demandais à partir de quand ou de quoi devient-on complice. Et si être complice était aussi grave que de commettre l’acte lui-même, sur une échelle de jugement que je ne pouvais établir. Sans doute avais-je besoin de me rassurer quant à ma proximité avec le mal. Mais toi en moi, tu savais bien que ça ne marchait pas comme ça.
À l’époque, je vivais à Paris. J’avais déjà trois filles. Ma vie était devenue tendue comme un arc. J’ai le sentiment aujourd’hui de m’être rebellé contre un sort imaginaire. Je venais de divorcer de la mère de mes filles. J’avais pris la décision de la séparation, mais je ne savais pas encore le mal que je faisais. Ni ce que dans l’amour je cherchais à fuir et à réinventer. Ou je ne voulais pas le savoir. C’est le problème avec le mal que nous nous faisons les uns les autres, et le mal que nous infligeons aux autres : nous ne voulons pas y croire.
Me servir des mots pour démasquer non le mal lui-même (je crois que cela est, sinon impossible, toujours défaillant) mais démasquer l’imposture de notre situation face au mal. (…) Et surtout ce que j’ai voulu nommer et désigner, c’est ma propre faiblesse face au mal.
Quand l’étonnement d’être maltraité ne trouve aucune réponse on se sent mystérieusement fait pour les mauvais traitements.
Il n’est pas impossible que certains criminels puissent oublier le mal qu’ils ont commis. Ils ont beau errer dans le château hanté de leur mémoire, l’aveu de leur crime n’est plus qu’un souvenir fantôme.
Pour chacune des dix-neuf cicatrices relevées par le médecin qui l’avait examinée, alerté par l’école maternelle de Parennes, la petite, vêtue d’une blouse rose et d’une jupe blanche, a donné calmement aux gendarmes une explication raisonnable et rassurante. Là, un coup reçu dans la cour de récréation, ou une chute par mégarde. Ici, une griffure dans les arbres ou la morsure d’un chien, ou le jet brûlant de la douche, et souvent les murs du dehors. Elle leur a dit dans un sourire de presque complicité : « C’est parce que je tombe tout le temps dehors. Je me cogne dans tous les murs. » Une vraie casse-cou, a répondu en souriant le gendarme. C’est une forme étrange de mensonge infaillible par lequel la plus innocente créature accuse les murs et l’extérieur comme pour cacher l’abîme de l’intérieur et l’absence de toute protection. Pour dissimuler l’absence du moindre rempart et du moindre mur à l’intérieur. « Personne ne te fait du mal alors ? » a demandé le gendarme. Elle a répondu cette phrase d’une maladresse implacable : « Non sauf mon papa sauf ma maman. Mon papa tape pas. Ma maman aussi. »
Tu m’as demandé te souviens-tu de cette phrase de Philip K. Dick dans un entretien : « Reality is that which, when you stop believing in it, doesn’t go away » ? Le réel c’est ce qui, quand tu arrêtes d’y croire, ne s’en va pas. Je ne veux pas y croire, dit-on. Mais c’est là, ça ne passe pas, et le réel se nourrit en quelque sorte de notre impuissance ou de notre refus d’y croire.
Et sur une échelle de vraisemblance pas nécessairement plus terrible qu’une autre, nous tentons de situer ce moment du récit où on pourrait accepter de croire que certains puissent faire disparaître des enfants. Et nous découvrons alors avec lassitude un vice logé dans notre désir de fiction. Croire le pire ne serait donc pas si naturel ni si facile. Croire le pire serait une forme absolue du courage et que peut-être toute fiction tente avec dignité de nous rendre. C’est le réel qui nous perd quand la fiction n’est plus pour nous qu’un refuge où nous serions dispensés de l’acte de croire alors même que la fiction s’efforce de nous faire entendre la parole inaudible du réel à laquelle, il me semble, nous préférons sagement ou cyniquement refuser notre confiance. C’est vrai aussi de tous les abus sexuels, intimes, mais aussi économiques, sociaux.
J’ai repris les carnets de Simone Weil : « Souffrir autant c’est impossible. Ce sentiment d’impossibilité c’est le sentiment du vide. L’imagination s’arrête. D’où ce sentiment d’irréalité dans le malheur. Ce n’est pas vrai. Ce n’est pas possible. Ce n’est pas possible parce qu’il ne m’est pas possible de le supporter. » Ce qui n’est pas possible alors, ce n’est pas la souffrance elle-même, mais d’imaginer la souffrance subie et endurée par autrui.
Et tu m’as interrogé ainsi : Pour quelle raison devrions-nous imaginer ou croire que les enfants échapperaient aux souffrances que l’on inflige à tous ? Pour quelle raison devrions-nous espérer qu’ils n’aient pas à souffrir eux aussi ? Je t’ai répondu par cette question de saint Augustin à saint Jérôme, dans une lettre de 415 : « Pour quel juste motif les enfants sont condamnés à souffrir ? » La réponse de Jérôme s’est perdue dans les siècles. On ne l’aura pas retrouvée, ou je préfère croire qu’il n’aura jamais répondu. Parce que ce n’était pas la bonne question, ai-je dit, il n’y a pas de juste motif. La seule, l’unique question qui se pose à nous tous et à chacun personnellement serait : pourquoi les laissons-nous souffrir ? Et pourquoi notre lâcheté théologique voudrait à tout prix, et en vain, trouver un juste motif à leurs souffrances ?