Coup de coeur 💓💓
Titre : Si ce livre pouvait me rapprocher
de toi
Auteur : Jean-Paul DUBOIS
Parution : 1999 (Editions de l'Olivier)
Pages : 216
Présentation de l'éditeur :
« C'est à ce moment-là, je crois, que je décidai de partir pour un
voyage dont j'ignorais la destination et la durée. J'étais désargenté,
désenchanté. Mais je voulais me replonger dans le courant de la vie, me
battre pour ou contre quelque chose, retrouver l'envie du bonheur et le
goût de la peur, lutter contre la force des vents, éprouver la chaleur,
le froid, casser des cailloux et, s'il le fallait, creuser les flancs de
la terre. »
Paul Peremülter est écrivain. À la fin de son treizième livre, déçu par son travail et toute une vie d'homme assis, il entreprend un périple qu'il voudrait simplement excentrique. Mais ce voyage va le conduire au plus profond de lui-même, dans la forêt obscure de ses origines. C'est dans ce monde magique et étouffant qu'il découvrira ce qu'on lui avait toujours caché, ce qu'il n'aurait jamais dû savoir.
Avec ce roman qui s'achève dans les forêts du Québec, Jean-Paul Dubois s'aventure dans de nouveaux territoires littéraires.
Paul Peremülter est écrivain. À la fin de son treizième livre, déçu par son travail et toute une vie d'homme assis, il entreprend un périple qu'il voudrait simplement excentrique. Mais ce voyage va le conduire au plus profond de lui-même, dans la forêt obscure de ses origines. C'est dans ce monde magique et étouffant qu'il découvrira ce qu'on lui avait toujours caché, ce qu'il n'aurait jamais dû savoir.
Avec ce roman qui s'achève dans les forêts du Québec, Jean-Paul Dubois s'aventure dans de nouveaux territoires littéraires.
Le mot de l'éditeur sur l'auteur :
Jean-Paul Dubois est né en 1950 à Toulouse où il vit actuellement.
Journaliste, il commence par écrire des chroniques sportives dans Sud-Ouest. Après la justice et le cinéma au Matin de Paris, il devient grand reporter en 1984 pour Le Nouvel Observateur. Il examine au scalpel les États-Unis et livre des chroniques qui seront publiées en deux volumes aux Éditions de l'Olivier : L'Amérique m'inquiète (1996) et Jusque-là tout allait bien en Amérique (2002). Écrivain, Jean-Paul Dubois a publié de nombreux romans (Je pense à autre chose, Si ce livre pouvait me rapprocher de toi). Il a obtenu le prix France Télévisions pour Kennedy et moi (Le Seuil, 1996), le prix Femina et le prix du roman Fnac pour Une vie française (Éditions de l'Olivier, 2004), le prix Goncourt pour Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon (Editions de l'Olivier, 2019).
Avis :
Le narrateur et écrivain Paul Permülter est au bord de la dépression. Fraîchement divorcé et sans enfant, il dresse à cinquante ans le bilan d’une vie creuse et stérile, qu’il résume avec morosité aux quelques décimètres cubes de papier où loge toute son œuvre. Il décide de secouer ce quotidien qui ne le satisfait plus, en partant à l’aventure outre-Atlantique. Après plusieurs petits boulots aux Etats-Unis, il atterrit au Canada, dans la région des lacs où son père s’est noyé il y a bien longtemps. Son parcours ne tardera pas à l’emporter bien au-delà des traces paternelles, par ailleurs pleines de surprises…
Il aura fallu l’âge mûr, et tout le poids de ses désillusions et de sa solitude, pour que Paul en arrive à affronter ses peurs et ses démons, passage obligé pour enfin devenir lui-même et trouver la sérénité. Loin de son ancienne vie bourgeoise et au gré des imprévus d’une bourlingue sans but précis, son voyage va s’avérer un parcours aussi bien intérieur et personnel qu’intercontinental. Au fil de multiples rebondissements et de rencontres marquantes, Paul nous embarque ainsi dans un récit d’aventures qui, le confrontant d’abord à ses semblables, puis à la nature grandiose du Canada, et enfin à lui-même, monte peu à peu en puissance pour s’achever dans une apothéose haletante.
Captivé à ne plus pouvoir lâcher le livre, le lecteur s’attache à ce personnage en perdition, qui devra d’abord régler ses vieux comptes avec son père pour trouver ensuite le courage de vaincre ses propres ténèbres. Le charme du récit doit beaucoup au talent narratif de l’auteur et à son style. L’écriture de Jean-Paul Dubois est toujours un régal de perfection et de dérision, qui vous envoûte et vous fait regretter de déjà tourner la dernière page. Du coup de foudre de mon premier titre « duboisien » à mes coups de coeur successifs dans ma découverte de ses autres romans, cet écrivain n’est pas prêt de quitter le panthéon de mes auteurs favoris. (5/5)
Il aura fallu l’âge mûr, et tout le poids de ses désillusions et de sa solitude, pour que Paul en arrive à affronter ses peurs et ses démons, passage obligé pour enfin devenir lui-même et trouver la sérénité. Loin de son ancienne vie bourgeoise et au gré des imprévus d’une bourlingue sans but précis, son voyage va s’avérer un parcours aussi bien intérieur et personnel qu’intercontinental. Au fil de multiples rebondissements et de rencontres marquantes, Paul nous embarque ainsi dans un récit d’aventures qui, le confrontant d’abord à ses semblables, puis à la nature grandiose du Canada, et enfin à lui-même, monte peu à peu en puissance pour s’achever dans une apothéose haletante.
Captivé à ne plus pouvoir lâcher le livre, le lecteur s’attache à ce personnage en perdition, qui devra d’abord régler ses vieux comptes avec son père pour trouver ensuite le courage de vaincre ses propres ténèbres. Le charme du récit doit beaucoup au talent narratif de l’auteur et à son style. L’écriture de Jean-Paul Dubois est toujours un régal de perfection et de dérision, qui vous envoûte et vous fait regretter de déjà tourner la dernière page. Du coup de foudre de mon premier titre « duboisien » à mes coups de coeur successifs dans ma découverte de ses autres romans, cet écrivain n’est pas prêt de quitter le panthéon de mes auteurs favoris. (5/5)
Citations :
J’en tire aujourd’hui ce simple enseignement personnel : un livre n’a jamais rendu meilleur. Ni celui qui l’écrit, ni celui qui le lit. Et cet autre, plus général : nous nous épuisons à tenir des rôles à contre-emploi, à vivre dans des maisons trop grandes, à nous accommoder de sentiments minuscules, à aimer par la force des choses, et si nos dents crissent dans le noir, c’est qu’elles ragent de voir ce que nous sommes devenus, ce à quoi nous avons peu à peu renoncé, au point de nous contenter d’écrire ce que jamais nous ne serons.
De la route goudronnée émanait une odeur acre et hostile. Le bitume restituait la chaleur qu’il avait emmagasinée durant la journée, l’air était étouffant, l’atmosphère orageuse. À l’horizon, des éclairs de chaleur, pareils à de faibles néons capricieux, découpaient les formes obtuses des grosses masses nuageuses et les modestes contours de vagues collines.
— Vous voulez dire que je ne pourrai jamais avoir d’enfants ?
— Pas par une voie naturelle.
Quelque chose alors s’éteignit en moi. Je ne saurais dire quoi exactement. Mais j’éprouvai un vague sentiment de tristesse et de solitude. Je n’étais porteur d’aucune vie, pareil à un homme sans issue. Tous ceux qui s’étaient démenés avant moi pour me léguer un patrimoine génétique avaient œuvré pour rien.
La nuit, fumant des cigarettes sur la véranda, il m’arrivait souvent de réfléchir à l’héritage, à ces biens inestimables que les pères sont empêchés de léguer à leurs fils, ces fortunes à jamais perdues et enterrées. Je pensais à tous ces trésors de l’esprit, ces savoirs accumulés, cette expérience, cet usage du monde, cette mémoire du temps et des saisons, cette connaissance d’une langue étrangère, des fièvres de la joie et du poids de la peine, je pensais à tout ce patrimoine précieux à jamais muré et enseveli dans la tête des morts. Les notaires n’avaient à connaître que le partage de la ferraille, mais où passaient tous les biens de l’esprit, à qui profitaient-ils ? Si les enfants pouvaient hériter de l’acquis de leurs pères, posséder seulement ce capital ontologique, vivre serait un jeu d’enfant, et le monde infiniment riche.
De la route goudronnée émanait une odeur acre et hostile. Le bitume restituait la chaleur qu’il avait emmagasinée durant la journée, l’air était étouffant, l’atmosphère orageuse. À l’horizon, des éclairs de chaleur, pareils à de faibles néons capricieux, découpaient les formes obtuses des grosses masses nuageuses et les modestes contours de vagues collines.
— Vous voulez dire que je ne pourrai jamais avoir d’enfants ?
— Pas par une voie naturelle.
Quelque chose alors s’éteignit en moi. Je ne saurais dire quoi exactement. Mais j’éprouvai un vague sentiment de tristesse et de solitude. Je n’étais porteur d’aucune vie, pareil à un homme sans issue. Tous ceux qui s’étaient démenés avant moi pour me léguer un patrimoine génétique avaient œuvré pour rien.
La nuit, fumant des cigarettes sur la véranda, il m’arrivait souvent de réfléchir à l’héritage, à ces biens inestimables que les pères sont empêchés de léguer à leurs fils, ces fortunes à jamais perdues et enterrées. Je pensais à tous ces trésors de l’esprit, ces savoirs accumulés, cette expérience, cet usage du monde, cette mémoire du temps et des saisons, cette connaissance d’une langue étrangère, des fièvres de la joie et du poids de la peine, je pensais à tout ce patrimoine précieux à jamais muré et enseveli dans la tête des morts. Les notaires n’avaient à connaître que le partage de la ferraille, mais où passaient tous les biens de l’esprit, à qui profitaient-ils ? Si les enfants pouvaient hériter de l’acquis de leurs pères, posséder seulement ce capital ontologique, vivre serait un jeu d’enfant, et le monde infiniment riche.
Et j’ai découvert que le courage dont on fait preuve pour écrire est celui-là même qui nous fait défaut dans l’existence. J’ai découvert que décliner ainsi sa vie ne la rend pas moins misérable, qu’une existence présentable n’a pas besoin d’être mise en scène, que les phrases ne sont jamais qu’une suite de mots complaisants. J’ai découvert que, croyant chaque fois écrire pour quelqu’un, c’est en réalité contre moi que je plaidais.
Faire un livre est une chose très simple. Il suffit de ne pas vivre. De s’arrêter, d’attendre que les morts sortent de terre, les sentiments de l’oubli, et les vers de la vase. Il suffit de décomposer les images du bonheur pour entendre, derrière le bruit des bouches qui s’embrassent, résonner le murmure des indicibles questions que chacun porte en soi.
La foi est sans doute la dernière disgrâce qui puisse toucher un homme. Elle est la forme la plus primitive de l’esclavage, le bâillon de la raison. Sinon comment expliquer qu’un condamné puisse à ce point vénérer son bourreau, lui rendre grâce, le prier à genoux ? Fort heureusement, je crois, voyez-vous, que le malheur est un puissant antidote. Le mien m’a en tout cas libéré de cette tentation. Vous savez en quoi je place aujourd’hui ma foi ? Dans cette merde qui grouille sous mes pieds, cette vase tiède qui a tout son temps et qui nous attend.
En deux mois de voyage, j’avais vu davantage de paysages et de visages, ressenti plus d’émotions, côtoyé plus d’êtres humains que durant les treize années passées à écrire ou à me torturer l’esprit. C’était un enseignement primordial que je ne devrais jamais oublier.
… l’espace d’un moment, nous nous regardâmes, le médecin qui croyait aux livres et l’écrivain qui n’y croyait pas, le généraliste déçu par les particuliers, le patient diminué par son état général, chacun assis de part et d’autre de la table, immobiles comme des planètes hostiles.
Les livres ne sont qu’un tout petit miroir du monde où se mirent les hommes et l’état de leur âme, mais qui jamais n’englobe la stature des arbres, l’infini des marais, l’immensité des mers. Si beau que soit le texte, si attentif le lecteur de Melville, il manquera toujours à ce dernier l’émotion fondatrice, l’indispensable synapse avec le réel, ce bref instant où surgit la baleine et où vous comprenez qu’elle vient vous chercher. Une chose est de lire la peur, une autre de l’affronter.
Faire un livre est une chose très simple. Il suffit de ne pas vivre. De s’arrêter, d’attendre que les morts sortent de terre, les sentiments de l’oubli, et les vers de la vase. Il suffit de décomposer les images du bonheur pour entendre, derrière le bruit des bouches qui s’embrassent, résonner le murmure des indicibles questions que chacun porte en soi.
La foi est sans doute la dernière disgrâce qui puisse toucher un homme. Elle est la forme la plus primitive de l’esclavage, le bâillon de la raison. Sinon comment expliquer qu’un condamné puisse à ce point vénérer son bourreau, lui rendre grâce, le prier à genoux ? Fort heureusement, je crois, voyez-vous, que le malheur est un puissant antidote. Le mien m’a en tout cas libéré de cette tentation. Vous savez en quoi je place aujourd’hui ma foi ? Dans cette merde qui grouille sous mes pieds, cette vase tiède qui a tout son temps et qui nous attend.
En deux mois de voyage, j’avais vu davantage de paysages et de visages, ressenti plus d’émotions, côtoyé plus d’êtres humains que durant les treize années passées à écrire ou à me torturer l’esprit. C’était un enseignement primordial que je ne devrais jamais oublier.
… l’espace d’un moment, nous nous regardâmes, le médecin qui croyait aux livres et l’écrivain qui n’y croyait pas, le généraliste déçu par les particuliers, le patient diminué par son état général, chacun assis de part et d’autre de la table, immobiles comme des planètes hostiles.
Les livres ne sont qu’un tout petit miroir du monde où se mirent les hommes et l’état de leur âme, mais qui jamais n’englobe la stature des arbres, l’infini des marais, l’immensité des mers. Si beau que soit le texte, si attentif le lecteur de Melville, il manquera toujours à ce dernier l’émotion fondatrice, l’indispensable synapse avec le réel, ce bref instant où surgit la baleine et où vous comprenez qu’elle vient vous chercher. Une chose est de lire la peur, une autre de l’affronter.
Comme les alliages de métaux qui reprennent leur forme après un choc, la vie possède elle aussi cette mémoire de carrossage qui lui permet, en peu de temps, de débosseler les impacts les plus violents, d’éliminer les traces du chaos pour imposer son ordre immémorial, ses normes et le lissé de ses formes. C’est pour cela que nous survivons à la disparition de ceux que nous aimons. Parce que l’existence est un tôlier d’exception, et non, comme nous avons trop tendance à le croire, en raison de notre courage.
Mais après tout, n'avons-nous pas tous en nous quelque chose qui nous pousse à fouiller le cœur des lacs et des forêts pour y retrouver cette insouciance de la jeunesse, la douceur d’une époque où, pour savoir qui l’on était, il suffisait de regarder la mère et d’écouter le père ? Passé un certain âge, lorsque l’on n’a plus la moindre foi, ni la force de se raccrocher à sa médiocrité, il ne reste qu’à croire, très fort, à ce que l’on a été.
« Tu te promènes en forêt. Et tu te perds. Tu sais comment on fait, nous, au Canada, pour se repérer ? On s’arrête sur place et on attend sans bouger. Le temps qu’il faut. Un mois, deux mois, six mois. Et puis, un jour, on remarque qu’on a de la mousse qui a poussé sur une jambe. Et voilà. Maintenant on sait de quel côté se trouve le nord. »
Le bonheur, c’est d’être auprès de quelqu’un à qui l’on tient, dans un endroit où l’on est bien, dont on n’a pas envie de partir. Trouver sa place sur cette terre et y rester en vie. Être présent, simplement. Offrir du réconfort et savoir que l’on peut en espérer. Aimer l’autre pour sa chaleur, son corps, son odeur. Et, bon Dieu, ne pas voir le jour se lever en se disant qu’on voudrait être ailleurs.
Mais après tout, n'avons-nous pas tous en nous quelque chose qui nous pousse à fouiller le cœur des lacs et des forêts pour y retrouver cette insouciance de la jeunesse, la douceur d’une époque où, pour savoir qui l’on était, il suffisait de regarder la mère et d’écouter le père ? Passé un certain âge, lorsque l’on n’a plus la moindre foi, ni la force de se raccrocher à sa médiocrité, il ne reste qu’à croire, très fort, à ce que l’on a été.
« Tu te promènes en forêt. Et tu te perds. Tu sais comment on fait, nous, au Canada, pour se repérer ? On s’arrête sur place et on attend sans bouger. Le temps qu’il faut. Un mois, deux mois, six mois. Et puis, un jour, on remarque qu’on a de la mousse qui a poussé sur une jambe. Et voilà. Maintenant on sait de quel côté se trouve le nord. »
Le bonheur, c’est d’être auprès de quelqu’un à qui l’on tient, dans un endroit où l’on est bien, dont on n’a pas envie de partir. Trouver sa place sur cette terre et y rester en vie. Être présent, simplement. Offrir du réconfort et savoir que l’on peut en espérer. Aimer l’autre pour sa chaleur, son corps, son odeur. Et, bon Dieu, ne pas voir le jour se lever en se disant qu’on voudrait être ailleurs.
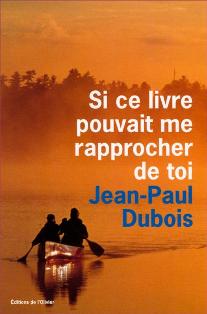


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire