J'ai beaucoup aimé
Titre : Sous le sol de coton noir
Auteur : Paul DUKE
Parution : 2022 (Editions du Rocher)
Pages : 296
Présentation de l'éditeur :
Après une mission au
Soudan du Sud qui tourne mal, le narrateur, ex-salarié d'une ONG humanitaire,
se terre en Normandie, traumatisé. Jusqu'au jour où il retrouve le téléphone
d'Arthur, un photographe qui l'avait accompagné à Malakal, tué dans des
circonstances mystérieuses. Il se replonge alors dans ce passé trouble qu'il
voulait oublier… lorsqu'il était au coeur des bombardements, dans une base des
Nations Unies, près d'un camp de population shilluk. Trente mille personnes y
vivaient dans la peur, la misère, mourant de faim, quand elles n'étaient pas massacrées
par les troupes gouvernementales du SPLA (Sudan People's Liberation Army),
occupées à extraire le pétrole de ce sol de coton noir.
Dans ce contexte brûlant de nettoyage ethnique, de tensions et de manipulations politiques, le narrateur parviendra-t-il à connaître la vérité sur la mort d'Arthur ?
Le mot de l'éditeur sur l'auteur :
Engagé dans des
organisations non gouvernementales comme Médecins Sans Frontières, Paul Duke
effectue, depuis une quinzaine d'années, des missions dans le monde entier
auprès des populations les plus vulnérables (Afghanistan, Irak, Mali, Soudan du
Sud, RDC…). Sous le sol de coton noir est son premier roman.
Avis :
Cela fait un an que, traumatisé par une mission au Soudan du Sud qui a viré au drame, le narrateur a démissionné de l’ONG humanitaire qui l’employait. Déterminé à comprendre enfin la vérité sur ce qu’on avait alors fait passer pour un accident, il entreprend de réexaminer à la loupe le déroulement des événements qui ont conduit à la mort, dans de troubles circonstances, du photographe de presse qui travaillait là-bas à ses côtés.
Après un demi-siècle de guerre civile quasi continue depuis l’indépendance du pays en 1956, le Soudan se divisait en deux états en 2011, coupant le Nord et ses raffineries, de l’essentiel des réserves pétrolières localisées dans le Sud sécessionniste. Aux dissensions ethniques s’ajoutait ainsi une déchirure économique, impactant drastiquement les revenus du Nord et de son ethnie majoritaire des Dinkas : autant d’huile jetée sur un brasier qui ne demandait qu’à repartir, pendant qu'au Sud, Président et Vice-président commençaient à s’empoigner par coup d’État interposé.… Les combats reprenaient dès 2013, l’armée sud-soudanaise bien décidée à sécuriser les champs de pétrole contre les forces rebelles, au passage prétexte tout trouvé, ni vu ni connu, pour une épuration ethnique. Rapidement dénoncés par les observateurs de l’ONU, des massacres de civils touchaient particulièrement la ville stratégique de Malakal et l’ethnie des Shilluk. C’est là que l’on retrouve notre narrateur, envoyé au secours d’un camp de réfugiés encadré par différentes ONG. Ce camp n’est que l’un de ceux où s’entassent aujourd’hui un total de plusieurs centaines de milliers de déplacés sud-soudanais, plus de deux millions d’entre eux ayant dû fuir la guerre civile et ce qui a été qualifié de crimes contre l’humanité.
Fort de ses dix ans d’expérience sur le terrain de l’humanitaire au service de différentes ONG, notamment au Soudan du Sud, l’auteur sait de quoi il parle. Ses personnages se retrouvent confrontés, tout comme lui l’a manifestement été, à une situation catastrophique dont ils essaient de pallier comme ils peuvent les conséquences : peur, misère, famine et épidémies, mais aussi bombardements, continuent à décimer des réfugiés entassés dans les pires conditions, matérialisées de manière frappante par la poussière et la boue, spectaculairement noires et envahissantes, évoquées par le titre. Mais l’insupportable ne se limite pas pour eux au terrible drame humain auquel leurs équipes tentent tant bien que mal d’apporter quelque soulagement. Pour travailler, les organisations humanitaires ne peuvent se passer de la caution des gouvernements locaux, responsables ou pas des exactions commises. Les compromis nécessaires les amènent ainsi à collaborer d’une main, pour pouvoir secourir de l’autre. Tenues, sous peine d’expulsion, à une certaine discrétion et donc à une forme de complicité pouvant inclure divers arrangements, notamment financiers, elles se retrouvent à panser les effets sans pouvoir traiter les causes, louvoyant en haut lieu dans de troubles eaux politiques pour mieux s’incruster sur le terrain opérationnel. Vues de leur fenêtre, la presse et les flambées médiatiques, suscitées par quelques images choc, ne font le plus souvent que les placer en porte-à-faux…
C’est avec une sombre lucidité que l’auteur nous expose ce qui fait le véritable propos de ce roman : la schizophrénie des ONG humanitaires, prisonnières d’une ambiguïté qui touche d’ailleurs jusqu’à leur raison d’être. Car, si pour elles, dénoncer comporte le risque de se faire éjecter du terrain, résoudre signifie aussi, à l’extrême limite, perdre à terme toute finalité. La réflexion amèrement menée par le narrateur lui fait prendre conscience de maints conflits d’intérêts, potentiellement à l’origine du drame qui l’a tant touché. D’abord envahi par la colère et la révolte, il évolue peu à peu vers une compréhension désabusée d’enjeux rien moins que simples.
Aussi sombre que la boue noire où s’engluent ses personnages, ce récit aux allures de thriller est, au travers de la situation méconnue du Soudan du Sud, une occasion particulièrement éclairante de découvrir, avec acuité et nuances, les dessous et les enjeux, bien plus complexes qu’ils n’en ont l’air, des organisations humanitaires. Une lecture mémorable et un premier roman très réussi. (4/5)
Après un demi-siècle de guerre civile quasi continue depuis l’indépendance du pays en 1956, le Soudan se divisait en deux états en 2011, coupant le Nord et ses raffineries, de l’essentiel des réserves pétrolières localisées dans le Sud sécessionniste. Aux dissensions ethniques s’ajoutait ainsi une déchirure économique, impactant drastiquement les revenus du Nord et de son ethnie majoritaire des Dinkas : autant d’huile jetée sur un brasier qui ne demandait qu’à repartir, pendant qu'au Sud, Président et Vice-président commençaient à s’empoigner par coup d’État interposé.… Les combats reprenaient dès 2013, l’armée sud-soudanaise bien décidée à sécuriser les champs de pétrole contre les forces rebelles, au passage prétexte tout trouvé, ni vu ni connu, pour une épuration ethnique. Rapidement dénoncés par les observateurs de l’ONU, des massacres de civils touchaient particulièrement la ville stratégique de Malakal et l’ethnie des Shilluk. C’est là que l’on retrouve notre narrateur, envoyé au secours d’un camp de réfugiés encadré par différentes ONG. Ce camp n’est que l’un de ceux où s’entassent aujourd’hui un total de plusieurs centaines de milliers de déplacés sud-soudanais, plus de deux millions d’entre eux ayant dû fuir la guerre civile et ce qui a été qualifié de crimes contre l’humanité.
Fort de ses dix ans d’expérience sur le terrain de l’humanitaire au service de différentes ONG, notamment au Soudan du Sud, l’auteur sait de quoi il parle. Ses personnages se retrouvent confrontés, tout comme lui l’a manifestement été, à une situation catastrophique dont ils essaient de pallier comme ils peuvent les conséquences : peur, misère, famine et épidémies, mais aussi bombardements, continuent à décimer des réfugiés entassés dans les pires conditions, matérialisées de manière frappante par la poussière et la boue, spectaculairement noires et envahissantes, évoquées par le titre. Mais l’insupportable ne se limite pas pour eux au terrible drame humain auquel leurs équipes tentent tant bien que mal d’apporter quelque soulagement. Pour travailler, les organisations humanitaires ne peuvent se passer de la caution des gouvernements locaux, responsables ou pas des exactions commises. Les compromis nécessaires les amènent ainsi à collaborer d’une main, pour pouvoir secourir de l’autre. Tenues, sous peine d’expulsion, à une certaine discrétion et donc à une forme de complicité pouvant inclure divers arrangements, notamment financiers, elles se retrouvent à panser les effets sans pouvoir traiter les causes, louvoyant en haut lieu dans de troubles eaux politiques pour mieux s’incruster sur le terrain opérationnel. Vues de leur fenêtre, la presse et les flambées médiatiques, suscitées par quelques images choc, ne font le plus souvent que les placer en porte-à-faux…
C’est avec une sombre lucidité que l’auteur nous expose ce qui fait le véritable propos de ce roman : la schizophrénie des ONG humanitaires, prisonnières d’une ambiguïté qui touche d’ailleurs jusqu’à leur raison d’être. Car, si pour elles, dénoncer comporte le risque de se faire éjecter du terrain, résoudre signifie aussi, à l’extrême limite, perdre à terme toute finalité. La réflexion amèrement menée par le narrateur lui fait prendre conscience de maints conflits d’intérêts, potentiellement à l’origine du drame qui l’a tant touché. D’abord envahi par la colère et la révolte, il évolue peu à peu vers une compréhension désabusée d’enjeux rien moins que simples.
Aussi sombre que la boue noire où s’engluent ses personnages, ce récit aux allures de thriller est, au travers de la situation méconnue du Soudan du Sud, une occasion particulièrement éclairante de découvrir, avec acuité et nuances, les dessous et les enjeux, bien plus complexes qu’ils n’en ont l’air, des organisations humanitaires. Une lecture mémorable et un premier roman très réussi. (4/5)
Citations :
À l’est : le « POC » pour Protection of civilians. Cet immense espace barricadé entre les murs de la base de l’UNMISS abritait trente mille personnes alors que sa capacité maximale était officiellement de dix mille. Trois fois plus de déplacés devaient se partager les rations alimentaires, l’eau potable, les tentes, les toilettes. Ils avaient échappé à la mort et se retrouvaient désormais dans des conditions tellement inhumaines qu’ils avaient forcément dû se demander si l’alternative n’aurait pas été plus clémente. En plus de trois ans d’existence, ce camp connaissait un taux de suicides incroyable. L’un des premiers témoignages que j’avais recueillis était celui de Joseph, un homme d’une trentaine d’années, qui se demandait combien de temps il allait tenir. Dans la culture des Shilluks, s’ôter la vie était plus honorable que voler le pain de son voisin.
À l’intérieur du POC, le seul signe d’une quelconque vie était le marché. La rue principale, qui séparait les ethnies shilluk et nuer, était le lieu d’échange. Parfait exemple de l’humour humanitaire, nous avions surnommé cette rue les Champs-Élysées. Seules les femmes pouvaient sortir du camp pour aller faire un peu de commerce en ville, car elles ne seraient pas accusées de rébellion. Les soldats postés en dehors se réservaient également le droit de les violer quand elles empruntaient le chemin d’un kilomètre à travers la brousse, entre le camp et la ville. Tout ce qui se trouvait sur le marché était ce que ces femmes avaient pu rapporter. Sur une photo, on en voyait une, triste et cadavérique, derrière son étal pitoyable de paquets de cigarettes locales, de gâteaux secs et rassis importés du Soudan, ainsi que quelques oignons qu’elle avait réussi à faire pousser. Habillée d’un drap bleu noué sur une épaule, elle contemplait les passants tout en essayant de surveiller son étal d’un œil vigilant. C’était son seul gagne-pain, ou son « moyen d’existence », comme disaient les humanitaires. La tristesse de ce terme ne m’affectait pas autant à l’époque. C’était le jargon. On encourageait des gens partout dans le monde à développer leurs « moyens d’existence ». Pour cette femme sur la photo, avec son maigre étal, je ne donnais pas cher de son existence. L’autre particularité frappante de cette photo était la couleur. La terre argileuse de cette région du monde, nommée Black Cotton Soil, ou sol de coton noir, était d’un gris anthracite qui accentuait l’atmosphère glauque. En saison des pluies, ce sol devenait un bain de boue qui rendait toute circulation, même à pied, extrêmement difficile. En arrière-plan, des tentes blanches, mais couvertes de cette boue grise à cause des précipitations. Entre la femme drapée de bleu, les abris et les passants, on avait affaire à une multitude de couleurs, mais contaminées par la terre. Dans ce camp, ces nuances de tons n’étaient qu’une illusion parmi d’autres. La faible saturation de la photo réduisait les couleurs au silence, tout comme les personnes qui les arboraient.
À l’intérieur du POC, le seul signe d’une quelconque vie était le marché. La rue principale, qui séparait les ethnies shilluk et nuer, était le lieu d’échange. Parfait exemple de l’humour humanitaire, nous avions surnommé cette rue les Champs-Élysées. Seules les femmes pouvaient sortir du camp pour aller faire un peu de commerce en ville, car elles ne seraient pas accusées de rébellion. Les soldats postés en dehors se réservaient également le droit de les violer quand elles empruntaient le chemin d’un kilomètre à travers la brousse, entre le camp et la ville. Tout ce qui se trouvait sur le marché était ce que ces femmes avaient pu rapporter. Sur une photo, on en voyait une, triste et cadavérique, derrière son étal pitoyable de paquets de cigarettes locales, de gâteaux secs et rassis importés du Soudan, ainsi que quelques oignons qu’elle avait réussi à faire pousser. Habillée d’un drap bleu noué sur une épaule, elle contemplait les passants tout en essayant de surveiller son étal d’un œil vigilant. C’était son seul gagne-pain, ou son « moyen d’existence », comme disaient les humanitaires. La tristesse de ce terme ne m’affectait pas autant à l’époque. C’était le jargon. On encourageait des gens partout dans le monde à développer leurs « moyens d’existence ». Pour cette femme sur la photo, avec son maigre étal, je ne donnais pas cher de son existence. L’autre particularité frappante de cette photo était la couleur. La terre argileuse de cette région du monde, nommée Black Cotton Soil, ou sol de coton noir, était d’un gris anthracite qui accentuait l’atmosphère glauque. En saison des pluies, ce sol devenait un bain de boue qui rendait toute circulation, même à pied, extrêmement difficile. En arrière-plan, des tentes blanches, mais couvertes de cette boue grise à cause des précipitations. Entre la femme drapée de bleu, les abris et les passants, on avait affaire à une multitude de couleurs, mais contaminées par la terre. Dans ce camp, ces nuances de tons n’étaient qu’une illusion parmi d’autres. La faible saturation de la photo réduisait les couleurs au silence, tout comme les personnes qui les arboraient.
Le SPLA utilisait le prétexte de la guerre civile pour « réorganiser » le pays. L’armée poussait les ethnies autres que dinka, celle du président, en dehors des zones urbaines. Ceux qui ne voulaient pas partir se faisaient tuer. Les villes étaient repeuplées de Dinkas, qui leur feraient gagner les futures élections. Un pur exercice de nettoyage ethnique.
Le spectre du génocide rwandais planant au-dessus de ce contexte, les Nations unies étaient intervenues avec leur impuissance habituelle. Les organisations humanitaires, dans la zone depuis des décennies, continuaient à assurer quelques services de base aux populations opprimées. Indépendant depuis seulement cinq ans, le pays constituait désormais une des pires catastrophes humaines du xxie siècle. Le Soudan du Sud « concurrençait » les guerres en Syrie, en République centrafricaine, au Yémen ou en Afghanistan pour remporter la palme de l’horreur et donc la part du lion des financements de l’aide. Quel rôle jouait le gouvernement en semant le trouble pour faire affluer cette aide afin de la détourner ? L’histoire ne le dit pas.
Al Mafraq. Pays de Bédouins qui depuis des millénaires traversaient la frontière comme pour aller boire le thé chez les voisins, qui échangeaient par caravanes interposées. Maintenant, c’est le foyer d’un camp qui abrite 80 000 réfugiés syriens. Comme si la ville de La Rochelle venait s’implanter là, au milieu de nulle part.
On parle tous les jours de réfugiés, mais le monde occidental refuse d’imaginer une telle vie : devoir tout quitter du jour au lendemain, marcher pendant des jours et des jours, jusqu’à un grand terrain vague dans un endroit inconnu. Ce terrain devient un camp, et ce camp devient ton nouveau chez-toi. D’un seul coup, pour te loger, te nourrir, éduquer tes enfants, t’es complètement livré à toi-même. Et c’est le cas pour des dizaines de milliers de personnes autour de toi. En France, on peut éventuellement se reposer sur quelques institutions, mais là, c’est ton propre pays qui te chasse. Soit parce que la guerre détruit ta maison, soit parce qu’on n’aime pas ta gueule ! T’as pas la bonne ethnie, la bonne religion, le bon bord politique… Tu dégages !
Et ce phénomène existe partout. À croire que c’est davantage la norme par rapport à la vie stable qu’on connaît en France, bien au chaud avec la Sécu, les allocs, le RSA (bon, c’est peut-être pas une référence !).
En tout cas, je pense qu’on a beaucoup de choses à dire, sur le déplacement en général. Avec 65 millions de personnes concernées dans le monde, on n’a jamais vu de chiffres de déplacements de populations aussi gros depuis la Seconde Guerre mondiale ! On parle beaucoup de la « crise des migrants ». Migrants, réfugiés… Quel que soit le terme, ce sont avant tout des gens, putain !
Le spectre du génocide rwandais planant au-dessus de ce contexte, les Nations unies étaient intervenues avec leur impuissance habituelle. Les organisations humanitaires, dans la zone depuis des décennies, continuaient à assurer quelques services de base aux populations opprimées. Indépendant depuis seulement cinq ans, le pays constituait désormais une des pires catastrophes humaines du xxie siècle. Le Soudan du Sud « concurrençait » les guerres en Syrie, en République centrafricaine, au Yémen ou en Afghanistan pour remporter la palme de l’horreur et donc la part du lion des financements de l’aide. Quel rôle jouait le gouvernement en semant le trouble pour faire affluer cette aide afin de la détourner ? L’histoire ne le dit pas.
Al Mafraq. Pays de Bédouins qui depuis des millénaires traversaient la frontière comme pour aller boire le thé chez les voisins, qui échangeaient par caravanes interposées. Maintenant, c’est le foyer d’un camp qui abrite 80 000 réfugiés syriens. Comme si la ville de La Rochelle venait s’implanter là, au milieu de nulle part.
On parle tous les jours de réfugiés, mais le monde occidental refuse d’imaginer une telle vie : devoir tout quitter du jour au lendemain, marcher pendant des jours et des jours, jusqu’à un grand terrain vague dans un endroit inconnu. Ce terrain devient un camp, et ce camp devient ton nouveau chez-toi. D’un seul coup, pour te loger, te nourrir, éduquer tes enfants, t’es complètement livré à toi-même. Et c’est le cas pour des dizaines de milliers de personnes autour de toi. En France, on peut éventuellement se reposer sur quelques institutions, mais là, c’est ton propre pays qui te chasse. Soit parce que la guerre détruit ta maison, soit parce qu’on n’aime pas ta gueule ! T’as pas la bonne ethnie, la bonne religion, le bon bord politique… Tu dégages !
Et ce phénomène existe partout. À croire que c’est davantage la norme par rapport à la vie stable qu’on connaît en France, bien au chaud avec la Sécu, les allocs, le RSA (bon, c’est peut-être pas une référence !).
En tout cas, je pense qu’on a beaucoup de choses à dire, sur le déplacement en général. Avec 65 millions de personnes concernées dans le monde, on n’a jamais vu de chiffres de déplacements de populations aussi gros depuis la Seconde Guerre mondiale ! On parle beaucoup de la « crise des migrants ». Migrants, réfugiés… Quel que soit le terme, ce sont avant tout des gens, putain !
Le devoir de neutralité nous empêche, nous humanitaires, de dénoncer haut et fort les fautifs. Nous ne traitons pas les causes des crises, mais leurs conséquences. Nous ne pouvons pas mettre en péril nos opérations d’aide aux populations en disant que les autorités qui nous accueillent sont les mêmes qui commettent les exactions sur leur propre peuple. Les gouvernements que nous sommes censés aider instrumentalisent les humanitaires, qui ne deviennent alors que de vulgaires pansements sur des jambes de bois. Ils nous voient comme un outil politique en tolérant notre présence. En revanche, en faisant appel à des journalistes, nous marchons sur des œufs, mais parvenons tout de même à faire savoir au monde que le gouvernement est en train de massacrer son propre peuple. Les ONG apportent une réponse concrète aux maux de populations vulnérables, mais changent moins les choses que les journalistes, qui lèvent le voile sur les crimes commis.
— Synergies ?
— Ouais, c’est un événement petits-fours qui rassemble la crème du privé, du public et de l’associatif pour ce que j’appelle la Françafrique 2.0 : créer des projets qui ne font que grossir les intérêts français à l’étranger. Le public étend son influence, le privé s’en met plein les fouilles aux dépens de boîtes du sud, et les ONG développent encore des projets garantissant leur survie même si les populations n’en ont pas besoin. Stéphane va prendre la parole à une conférence, c’est la semaine prochaine au palais Brongniart.
— En tant que spécialistes en eau, hygiène et assainissement, nous nous chargeons de l’identification des cas de choléra. Quand on suspecte un cas, nous amenons le patient ici, le temps des tests au laboratoire. Si c’est une simple diarrhée, on renvoie la personne chez elle avec de quoi s’hydrater. Si c’est le choléra, elle reste ici jusqu’à sa guérison. Enfin, si elle est prise en charge à temps… On ne compte aucun cas en ce moment, mais vous verriez cet hôpital en saison des pluies…
— Bondé ? demande Arthur.
— Oui… Dans un centre de choléra à plein régime, tu vois des gens allongés partout, qui se vident par tous les orifices. Je te laisse imaginer l’odeur. Le personnel médical est débordé, c’est la panique. Un malade du choléra peut mourir en trois heures. Surtout dans un contexte propice à la famine comme ici, les gens sont faibles.
— Je suppose que la mousson, ce n’est pas de la petite pluie…
— C’est le déluge. Le sol de coton noir transforme le camp en un immense marécage, et ses fossés en torrents. Je vous conseille de ne pas tomber dedans. Les fosses septiques des latrines débordent, la merde se répand partout. Les conditions sont optimales pour faire proliférer les maladies !
— Synergies ?
— Ouais, c’est un événement petits-fours qui rassemble la crème du privé, du public et de l’associatif pour ce que j’appelle la Françafrique 2.0 : créer des projets qui ne font que grossir les intérêts français à l’étranger. Le public étend son influence, le privé s’en met plein les fouilles aux dépens de boîtes du sud, et les ONG développent encore des projets garantissant leur survie même si les populations n’en ont pas besoin. Stéphane va prendre la parole à une conférence, c’est la semaine prochaine au palais Brongniart.
— En tant que spécialistes en eau, hygiène et assainissement, nous nous chargeons de l’identification des cas de choléra. Quand on suspecte un cas, nous amenons le patient ici, le temps des tests au laboratoire. Si c’est une simple diarrhée, on renvoie la personne chez elle avec de quoi s’hydrater. Si c’est le choléra, elle reste ici jusqu’à sa guérison. Enfin, si elle est prise en charge à temps… On ne compte aucun cas en ce moment, mais vous verriez cet hôpital en saison des pluies…
— Bondé ? demande Arthur.
— Oui… Dans un centre de choléra à plein régime, tu vois des gens allongés partout, qui se vident par tous les orifices. Je te laisse imaginer l’odeur. Le personnel médical est débordé, c’est la panique. Un malade du choléra peut mourir en trois heures. Surtout dans un contexte propice à la famine comme ici, les gens sont faibles.
— Je suppose que la mousson, ce n’est pas de la petite pluie…
— C’est le déluge. Le sol de coton noir transforme le camp en un immense marécage, et ses fossés en torrents. Je vous conseille de ne pas tomber dedans. Les fosses septiques des latrines débordent, la merde se répand partout. Les conditions sont optimales pour faire proliférer les maladies !
L’impact de l’aide humanitaire ne se jouait pas sur le terrain, dans les villages de pays en développement, mais en réalité dans des salons luxueux comme ceux du palais Brongniart, place de la Bourse, à Paris. Les pontes du milieu avaient troqué le gilet de pêcheur et le baggy à poches pour le costume. Les ONG clamaient haut et fort leur indépendance afin de conserver une image qui inspire confiance auprès de leurs donateurs actuels et potentiels. En réalité, si elles percevaient les fonds des États, elles ne s’insurgeaient plus contre leurs actions plus ou moins discutables et se laissaient instrumentaliser par ces mêmes États à des fins politiques. Les guerres se répercutaient inévitablement sur les populations et leurs besoins essentiels, mais tant que les intérêts de l’État et de ses entreprises chéries étaient saufs, ce n’était pas si grave. La France pouvait agir pour mettre un terme au conflit au Yémen. Pour ce faire, elle vendait des armes à l’Arabie Saoudite, dont le bilan en matière de Droits de l’homme donnait peu cher de sa peau. De grandes fondations saoudiennes se vantaient ensuite de financer la reconstruction du pays et les ONG européennes, comme Action Internationale, se bousculaient au portillon pour essayer de grappiller une miette du gâteau. Ce n’était qu’un exemple de ce qui se tramait dans les conférences comme Synergies.
Dans un souci d’impartialité, notre ONG fournit des services d’assainissement aux déplacés, mais également aux habitants de la ville, principalement d’ethnie dinka depuis la purge. Une bonne moitié d’entre eux sont des soldats du SPLA. Les compromis auxquels doivent se soumettre les ONG peuvent les contraindre à fournir des services aux belligérants, à l’origine des exactions, voire de la crise qui les fait intervenir. Le serpent se mord la queue une fois de plus. Si l’État nous tolère, c’est à la fois parce que nous apportons des services à leurs soldats, mais aussi pour donner au monde l’image d’un gouvernement qui veut aider son peuple. En réalité, tout le monde sait que ce sont eux qui tuent une partie de leur population.
Je suis bien arrivé à Calais. (…)
Les conditions de vie des gens ici sont scandaleuses, pires que dans un « vrai » camp de réfugiés dans un pays en guerre, si tu veux mon avis. Ce qu’on appelle la « New Jungle », c’est un terrain vague. Une ancienne décharge, pour être précis. Les autorités locales ont posé des toilettes chimiques à l’arrache. Pas vidangées et sans eau, ces chiottes de chantier sont prises d’assaut, vite salies et carrément inutilisables pour certaines. Les ONG sur place me parlent de maladies qui n’existaient plus en France, comme la gale. D’ailleurs, je ne compte aucun service qui ne soit pas fourni par une association. Ce sont ces initiatives citoyennes qui permettent aux gens de manger, de se loger, d’être soignés… L’État ne fout rien.
Dans un souci d’impartialité, notre ONG fournit des services d’assainissement aux déplacés, mais également aux habitants de la ville, principalement d’ethnie dinka depuis la purge. Une bonne moitié d’entre eux sont des soldats du SPLA. Les compromis auxquels doivent se soumettre les ONG peuvent les contraindre à fournir des services aux belligérants, à l’origine des exactions, voire de la crise qui les fait intervenir. Le serpent se mord la queue une fois de plus. Si l’État nous tolère, c’est à la fois parce que nous apportons des services à leurs soldats, mais aussi pour donner au monde l’image d’un gouvernement qui veut aider son peuple. En réalité, tout le monde sait que ce sont eux qui tuent une partie de leur population.
Je suis bien arrivé à Calais. (…)
Les conditions de vie des gens ici sont scandaleuses, pires que dans un « vrai » camp de réfugiés dans un pays en guerre, si tu veux mon avis. Ce qu’on appelle la « New Jungle », c’est un terrain vague. Une ancienne décharge, pour être précis. Les autorités locales ont posé des toilettes chimiques à l’arrache. Pas vidangées et sans eau, ces chiottes de chantier sont prises d’assaut, vite salies et carrément inutilisables pour certaines. Les ONG sur place me parlent de maladies qui n’existaient plus en France, comme la gale. D’ailleurs, je ne compte aucun service qui ne soit pas fourni par une association. Ce sont ces initiatives citoyennes qui permettent aux gens de manger, de se loger, d’être soignés… L’État ne fout rien.
Quand t’y penses, les Afghans n’ont jamais connu autre chose que la guerre et la misère, donc ils cherchent à vivre une vie normale malgré la tristesse de leur sort. L’un d’entre eux m’a dit cette phrase : « Notre passé est tellement inexistant que nous ne pouvons pas imaginer le moindre avenir. »
Arthur avait écrit également à des ONG de droits de l’homme et des centres de conseil légal pour migrants. En Grèce, dans les Balkans, sur les nombreuses étapes de la route migratoire européenne. Lampedusa, Vintimille, Guevgueliya, Idoméni, Athènes, Lesbos… Visiblement, il n’avait encore rien organisé de concret. Parmi les réponses qu’il recevait, je sentis une différence dans le niveau d’engagement envers les migrants, selon les centres. Certains n’en avaient clairement rien à foutre, d’autres voulaient vraiment aider Arthur à dévoiler au monde entier les conditions dans lesquelles ces réfugiés politiques prenaient la route. J’appris que des escrocs vendaient aux familles des sandwichs à cinquante euros sur les frontières. La cupidité humaine n’avait pas de limites. Certains migrants se retrouvaient à camper dans le no man’s land entre deux pays et ne relevaient donc de la responsabilité d’aucun d’entre eux. Les gouvernements faisaient preuve d’énormément de créativité dans l’art de se laver les mains des problèmes humains, voire de profiter de la misère. La Turquie se vantait d’accueillir le plus grand nombre de réfugiés syriens alors qu’elle prenait part au conflit. Facile, quand on percevait d’énormes subventions de l’Union européenne pour empêcher les réfugiés du Moyen-Orient de passer la frontière. Ce gouvernement ne valait pas mieux que celui du Soudan du Sud, qui massacrait son propre peuple. Le nettoyage ethnique pouvait prendre de nombreuses formes. Le déguiser en un conflit civil ou en une lutte contre une rébellion n’était qu’une tactique parmi d’autres. Ces efforts débordaient parfois en violences gratuites, en viols, en enlèvements, en persécutions, en mutilations, en infanticides… À croire que les auteurs de ces violences y prenaient du plaisir, qu’ils avaient oublié l’objectif premier de remporter la bataille et qu’ils s’acharnaient à infliger le maximum de souffrances à leurs victimes.
— Je vous remercie tous d’être venus, commença Ezekiel dans un anglais approximatif. Vous avez été témoins hier soir de nombreux échanges de tirs, très violents, entre les troupes de l’Armée de libération du peuple du Soudan, le SPLA, et le groupe rebelle local Aguelek. Ce groupuscule fait partie du mouvement illégal d’opposition IO créé par le traître nuer, M. Riek Machar.
Son discours pue la propagande. Nous sommes une quinzaine de représentants des ONG dans la pièce, entourés d’une vingtaine de personnels gouvernementaux sud-soudanais, tous plus ou moins membres du SPLA. Tout le monde sait que c’est l’armée qui dirige le pays, mais nous préservons tous le mensonge, car le démentir créerait un incident diplomatique. Pour les humanitaires, aller à l’encontre de la volonté des autorités reviendrait à devoir quitter le pays. Nous sommes donc tous assis là, sur des chaises en plastique en mauvais état, dans cette petite maison en torchis au centre de Malakal qui constitue le bureau d’Ezekiel.
Arthur avait écrit également à des ONG de droits de l’homme et des centres de conseil légal pour migrants. En Grèce, dans les Balkans, sur les nombreuses étapes de la route migratoire européenne. Lampedusa, Vintimille, Guevgueliya, Idoméni, Athènes, Lesbos… Visiblement, il n’avait encore rien organisé de concret. Parmi les réponses qu’il recevait, je sentis une différence dans le niveau d’engagement envers les migrants, selon les centres. Certains n’en avaient clairement rien à foutre, d’autres voulaient vraiment aider Arthur à dévoiler au monde entier les conditions dans lesquelles ces réfugiés politiques prenaient la route. J’appris que des escrocs vendaient aux familles des sandwichs à cinquante euros sur les frontières. La cupidité humaine n’avait pas de limites. Certains migrants se retrouvaient à camper dans le no man’s land entre deux pays et ne relevaient donc de la responsabilité d’aucun d’entre eux. Les gouvernements faisaient preuve d’énormément de créativité dans l’art de se laver les mains des problèmes humains, voire de profiter de la misère. La Turquie se vantait d’accueillir le plus grand nombre de réfugiés syriens alors qu’elle prenait part au conflit. Facile, quand on percevait d’énormes subventions de l’Union européenne pour empêcher les réfugiés du Moyen-Orient de passer la frontière. Ce gouvernement ne valait pas mieux que celui du Soudan du Sud, qui massacrait son propre peuple. Le nettoyage ethnique pouvait prendre de nombreuses formes. Le déguiser en un conflit civil ou en une lutte contre une rébellion n’était qu’une tactique parmi d’autres. Ces efforts débordaient parfois en violences gratuites, en viols, en enlèvements, en persécutions, en mutilations, en infanticides… À croire que les auteurs de ces violences y prenaient du plaisir, qu’ils avaient oublié l’objectif premier de remporter la bataille et qu’ils s’acharnaient à infliger le maximum de souffrances à leurs victimes.
— Je vous remercie tous d’être venus, commença Ezekiel dans un anglais approximatif. Vous avez été témoins hier soir de nombreux échanges de tirs, très violents, entre les troupes de l’Armée de libération du peuple du Soudan, le SPLA, et le groupe rebelle local Aguelek. Ce groupuscule fait partie du mouvement illégal d’opposition IO créé par le traître nuer, M. Riek Machar.
Son discours pue la propagande. Nous sommes une quinzaine de représentants des ONG dans la pièce, entourés d’une vingtaine de personnels gouvernementaux sud-soudanais, tous plus ou moins membres du SPLA. Tout le monde sait que c’est l’armée qui dirige le pays, mais nous préservons tous le mensonge, car le démentir créerait un incident diplomatique. Pour les humanitaires, aller à l’encontre de la volonté des autorités reviendrait à devoir quitter le pays. Nous sommes donc tous assis là, sur des chaises en plastique en mauvais état, dans cette petite maison en torchis au centre de Malakal qui constitue le bureau d’Ezekiel.
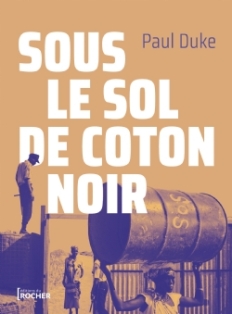
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire