Coup de coeur 💓
Titre : Les huit montagnes
(Le otto montagne)
Auteur : Paolo COGNETTI
Traductrice : Anita ROCHEDY
Parution : 2016 en italien (Einaudi)
2017 en français (Stock)
Pages : 304
Présentation de l'éditeur :
« Quel que soit notre destin, il habite les montagnes au-dessus de nos têtes. »
Pietro est un garçon de la ville, Bruno un enfant des montagnes. Ils ont 11 ans et tout les sépare. Dès leur rencontre à Grana, au coeur du val d’Aoste, Bruno initie Pietro aux secrets de la montagne. Ensemble, ils parcourent alpages, forêts et glaciers, puisant dans cette nature sauvage les prémices de leur amitié.
Vingt ans plus tard, c’est dans ces mêmes montagnes et auprès de ce même ami que Pietro tentera de se réconcilier avec son passé – et son avenir.
Dans une langue pure et poétique, Paolo Cognetti mêle l’intime à l’universel et signe un grand roman d’apprentissage et de filiation.
Pietro est un garçon de la ville, Bruno un enfant des montagnes. Ils ont 11 ans et tout les sépare. Dès leur rencontre à Grana, au coeur du val d’Aoste, Bruno initie Pietro aux secrets de la montagne. Ensemble, ils parcourent alpages, forêts et glaciers, puisant dans cette nature sauvage les prémices de leur amitié.
Vingt ans plus tard, c’est dans ces mêmes montagnes et auprès de ce même ami que Pietro tentera de se réconcilier avec son passé – et son avenir.
Dans une langue pure et poétique, Paolo Cognetti mêle l’intime à l’universel et signe un grand roman d’apprentissage et de filiation.
Le mot de l'éditeur sur l'auteur :
Paolo Cognetti, né à Milan en 1978, est l’auteur de plusieurs recueils
de nouvelles – dont Sofia s’habille toujours en noir (Liana Levi, 2013)
–, d’un guide littéraire de New York et d’un carnet de montagne Le
Garçon sauvage (Éditions Zoé, 2016). Les Huit Montagnes (Stock, 2017),
son premier roman, a reçu le prix Médicis étranger, le prix François
Sommer, le prix Strega et a été traduit dans 39 pays.
Avis :
Revenant chaque été dans le même hameau perdu des montagnes du Val d’Aoste, un petit citadin se lie d’amitié avec un gamin du cru et découvre à son contact la rudesse et les beautés de la nature alpine. Parvenu à l’âge adulte et cherchant sa voie après la disparition d’un père qu’il n’a jamais vraiment compris, Pietro finira par retourner auprès de son ami, toujours resté sur le même pan d’alpage où il tente obstinément de maintenir un mode de vie d’un autre siècle.
Il est impossible de ne pas voir de larges traits autobiographiques dans la narration de Pietro, tant cette histoire exprime d’intime ressenti et revêt des accents d’authenticité jusque dans ses plus infimes détails. L’intrigue, très simple, tire son épaisseur de ses personnages, dont on découvre peu à peu les multiples nuances, restituées avec une sensibilité toute de finesse et de pudeur. Chez Paolo Cognetti, l’émotion ressemble à ce petit torrent de montagne qui, dans son livre, court sous-terre avant d’émerger plus en aval : on la ressent plus qu’on ne la lit, elle sourd au travers des lignes et se laisse deviner plus qu’elle ne s’exprime. Et elle s’enterre parfois au tréfonds d’une génération pour rejaillir à la suivante, dans de curieuses répétitions des mêmes destins.
La couleur de ce livre est d’abord celle d’une indéfectible amitié, entre deux garçons, puis deux adultes, que tout sépare : Pietro se cherche de par le monde, Bruno s’accroche à la montagne qu’il n’a jamais quittée, mais, chacun à leur façon, ils vivent les mêmes apprentissages et les mêmes blessures, tentant de se construire un avenir en se réconciliant avec leur passé et leur héritage filial.
Aux prises avec leurs tâtonnements et leurs drames, tous deux tirent leur force de leur seul vrai point d’ancrage : la montagne et l’amour viscéral qu’elle leur inspire. Omniprésente, elle est leur refuge, leur lieu de repli, leur cachette face à un monde oublieux des vrais essentiels. Elle leur offre la liberté et la solitude au sein de grandioses espaces de nature préservée, une vie rude et spartiate au rythme des saisons, le calme et l’apaisement au contact d’une simple authenticité, la souffrance et le plaisir de l’effort physique.
Une grande tristesse et une vraie sincérité émanent de ce livre que l’on quitte le coeur serré et les larmes aux yeux, mais les jambes musclées, les poumons oxygénés et les yeux tournés vers les cimes de l’avenir. Coup de coeur. (5/5)
Peut-être ma mère avait-elle raison, chacun en montagne a une altitude de prédilection, un paysage qui lui ressemble et dans lequel il se sent bien. La sienne était décidément la forêt des mille cinq cents mètres, celle des sapins et des mélèzes, à l’ombre desquels poussent les buissons de myrtilles, les genévriers et les rhododendrons, et se cachent les chevreuils. Moi, j’étais plus attiré par la montagne qui venait après : prairie alpine, torrents, tourbières, herbes de haute altitude, bêtes en pâture. Plus haut encore la végétation disparaît, la neige recouvre tout jusqu’à l’été et la couleur dominante reste le gris de la roche, veiné de quartz et tissé du jaune des lichens. C’est là que commençait le monde de mon père. Au bout de trois heures de marche, prés et bois cédaient la place aux pierrailles, aux petits lacs cachés dans les combes à neige, aux couloirs creusés par les avalanches, aux ruisseaux d’eau glacée. La montagne se transformait alors en un lieu plus âpre, plus inhospitalier et pur : là-haut, mon père arrivait à être heureux.
« Il faut pas croire qu’on l’appelle Rose parce qu’il est rose, disait-il. Ça vient d’un mot ancien qui signifie glace. La montagne de glace. »
(…) et il faisait les comptes à voix haute pour lui prouver qu’avec les prix et les normes absurdes qu’on imposait désormais aux éleveurs, son travail n’avait plus aucun sens, et s’il le faisait c’était uniquement par passion.
Il dit : « Quand je serai mort, là-haut, je ne donne pas dix ans à la forêt pour reprendre ses droits. Ils auront la paix, comme ça.
– Vos fils n’aiment pas le métier ? demanda mon père.
– C’est surtout se faire enculer que mes fils n’aiment pas. »
Plus que le vocabulaire utilisé, c’est sa prophétie qui me frappa. Je n’avais jamais pensé qu’un pré avait pu un jour être une forêt, ni qu’il pourrait le redevenir. Je regardai les vaches éparpillées au-dessus de l’alpage et tentai tant bien que mal d’imaginer les premiers arbustes coloniser ces prés, puis grandir, effaçant chaque signe de ce qu’il y avait avant. Les canaux, les murets, les sentiers et même les maisons.
« On appelle ça l’altitude des neiges éternelles , expliqua-t-il : c’est la hauteur à laquelle il ne fait pas assez chaud l’été pour faire fondre toute la neige qui est tombée l’hiver. Une partie résiste jusqu’à l’automne et finit ensevelie sous la couche de neige de l’hiver suivant. À ce stade, elle ne craint plus rien. Petit à petit, elle se transforme en glace, s’ajoute aux autres couches du glacier qui s’entassent, exactement comme les anneaux des arbres, et il suffit de les compter pour connaître son âge. Mais un glacier ne reste jamais au sommet de la montagne. Il bouge. Toute sa vie, il ne fait que glisser.
– Pourquoi ? demandai-je.
– Pourquoi, d’après toi ?
– Parce qu’il est lourd, dit Bruno.
– Parfaitement, dit mon père. Le glacier est lourd, et la roche sur laquelle il est posé, très lisse. Du coup, il descend. Lentement, mais sûrement. Il glisse jusqu’à ce qu’il ne supporte plus la chaleur. C’est l’altitude de la fusion . Vous la voyez, là-bas ? »
Nous marchions sur une moraine qui semblait faite de sable. Une langue de glace et d’éboulis s’avançait en contrebas, bien plus bas que le sentier. Elle était zébrée d’infimes ruisseaux qui se rejoignaient en un petit lac opaque, métallique, glaçant rien qu’à le regarder.
« Cette eau-là, dit mon père, il faut pas croire que c’est la neige de l’hiver dernier. C’est une neige que la montagne a conservée pendant des années et des années : l’eau qu’on voit a peut-être même cent hivers derrière elle.
L’hiver, la montagne n’était pas faite pour les hommes et il fallait la laisser en paix. Dans la philosophie qui était la sienne, qui consistait à monter et descendre, ou plutôt à fuir en haut tout ce qui lui empoisonnait la vie en bas, après la saison de la légèreté venait forcément celle de la gravité : c’était le temps du travail, de la vie en plaine et de l’humeur noire.
Un lieu que l’on a aimé enfant peut paraître complètement différent à des yeux d’adulte et se révéler une déception, à moins qu’il ne nous rappelle celui que l’on n’est plus, et nous colle une profonde tristesse.
Le lac en contrebas ressemblait à de la soie noire, avec le vent qui la dentelait. Ou qui, au contraire, faisait tout sauf de la dentelle : il posait une main glacée qui effaçait les plis.
J’observais l’alpage et l’étrange contraste entre la désolation des choses humaines et la vigueur du printemps : les trois baite dépérissaient, leurs murs se voûtaient comme le dos des vieillards, les toits cédaient sous le poids des hivers ; et tout autour, les herbes et les fleurs sourdaient.
Je commençais à comprendre ce qui arrive à quelqu’un qui s’en va : les autres continuent de vivre sans lui.
Le sapin, il faut éviter, parce que c’est un bois mou. Le mélèze est plus dur. (…) Le fait est que le sapin pousse à l’ombre et le mélèze au soleil : le soleil rend le bois dur, alors que l’ombre et l’eau le ramollissent, c’est pour ça que le sapin ne fait pas de bonnes poutres.
Si je vais vivre dans les bois, personne ne me dira rien. Si une femme le fait, on la traitera de sorcière. Si je me taisais, quel problème ça ferait ? Je ne serais qu’un homme qui ne parle pas. Une femme qui ne parle plus est forcément à moitié folle.
« Nous disons qu’au centre du monde, il y en a un autre, beaucoup plus haut : le Sumeru. Et autour du Sumeru, il y a huit montagnes et huit mers. C’est le monde pour nous. » (…) « Et nous disons : lequel des deux aura le plus appris ? Celui qui aura fait le tour des huit montagnes, ou celui qui sera arrivé au sommet du mont Sumeru ? »
Et il disait : c’est bien un mot de la ville, ça, la nature . Vous en avez une idée si abstraite que même son nom l’est. Nous, ici, on parle de bois , de pré , de torrent , de roche. Autant de choses qu’on peut montrer du doigt. Qu’on peut utiliser. Les choses qu’on ne peut pas utiliser, nous, on ne s’embête pas à leur chercher un nom, parce qu’elles ne servent à rien.
La caillette, c’est un petit morceau de l’estomac du veau, m’expliqua-t-il. Imagine-toi : ce que le veau a dans son estomac pour mieux digérer le lait, nous, on le prend et on s’en sert pour faire du fromage. C’est logique, non ? N’empêche, c’est quand même fou, sans ce bout d’estomac, le fromage ne prend pas.
Il est impossible de ne pas voir de larges traits autobiographiques dans la narration de Pietro, tant cette histoire exprime d’intime ressenti et revêt des accents d’authenticité jusque dans ses plus infimes détails. L’intrigue, très simple, tire son épaisseur de ses personnages, dont on découvre peu à peu les multiples nuances, restituées avec une sensibilité toute de finesse et de pudeur. Chez Paolo Cognetti, l’émotion ressemble à ce petit torrent de montagne qui, dans son livre, court sous-terre avant d’émerger plus en aval : on la ressent plus qu’on ne la lit, elle sourd au travers des lignes et se laisse deviner plus qu’elle ne s’exprime. Et elle s’enterre parfois au tréfonds d’une génération pour rejaillir à la suivante, dans de curieuses répétitions des mêmes destins.
La couleur de ce livre est d’abord celle d’une indéfectible amitié, entre deux garçons, puis deux adultes, que tout sépare : Pietro se cherche de par le monde, Bruno s’accroche à la montagne qu’il n’a jamais quittée, mais, chacun à leur façon, ils vivent les mêmes apprentissages et les mêmes blessures, tentant de se construire un avenir en se réconciliant avec leur passé et leur héritage filial.
Aux prises avec leurs tâtonnements et leurs drames, tous deux tirent leur force de leur seul vrai point d’ancrage : la montagne et l’amour viscéral qu’elle leur inspire. Omniprésente, elle est leur refuge, leur lieu de repli, leur cachette face à un monde oublieux des vrais essentiels. Elle leur offre la liberté et la solitude au sein de grandioses espaces de nature préservée, une vie rude et spartiate au rythme des saisons, le calme et l’apaisement au contact d’une simple authenticité, la souffrance et le plaisir de l’effort physique.
Une grande tristesse et une vraie sincérité émanent de ce livre que l’on quitte le coeur serré et les larmes aux yeux, mais les jambes musclées, les poumons oxygénés et les yeux tournés vers les cimes de l’avenir. Coup de coeur. (5/5)
Citations :
Je commençai alors à comprendre que tout, pour un poisson d’eau douce, vient de l’amont : insectes, branches, feuilles, n’importe quoi. C’est ce qui le pousse à regarder vers le haut : il attend de voir ce qui doit arriver. Si l’endroit où tu te baignes dans un fleuve correspond au présent, pensai-je, dans ce cas l’eau qui t’a dépassé, qui continue plus bas et va là où il n’y a plus rien pour toi, c’est le passé. L’avenir, c’est l’eau qui vient d’en haut, avec son lot de dangers et de découvertes. Le passé est en aval, l’avenir en amont. Voilà ce que j’aurais dû répondre à mon père. Quel que soit notre destin, il habite les montagnes au-dessus de nos têtes.
Peut-être ma mère avait-elle raison, chacun en montagne a une altitude de prédilection, un paysage qui lui ressemble et dans lequel il se sent bien. La sienne était décidément la forêt des mille cinq cents mètres, celle des sapins et des mélèzes, à l’ombre desquels poussent les buissons de myrtilles, les genévriers et les rhododendrons, et se cachent les chevreuils. Moi, j’étais plus attiré par la montagne qui venait après : prairie alpine, torrents, tourbières, herbes de haute altitude, bêtes en pâture. Plus haut encore la végétation disparaît, la neige recouvre tout jusqu’à l’été et la couleur dominante reste le gris de la roche, veiné de quartz et tissé du jaune des lichens. C’est là que commençait le monde de mon père. Au bout de trois heures de marche, prés et bois cédaient la place aux pierrailles, aux petits lacs cachés dans les combes à neige, aux couloirs creusés par les avalanches, aux ruisseaux d’eau glacée. La montagne se transformait alors en un lieu plus âpre, plus inhospitalier et pur : là-haut, mon père arrivait à être heureux.
« Il faut pas croire qu’on l’appelle Rose parce qu’il est rose, disait-il. Ça vient d’un mot ancien qui signifie glace. La montagne de glace. »
(…) et il faisait les comptes à voix haute pour lui prouver qu’avec les prix et les normes absurdes qu’on imposait désormais aux éleveurs, son travail n’avait plus aucun sens, et s’il le faisait c’était uniquement par passion.
Il dit : « Quand je serai mort, là-haut, je ne donne pas dix ans à la forêt pour reprendre ses droits. Ils auront la paix, comme ça.
– Vos fils n’aiment pas le métier ? demanda mon père.
– C’est surtout se faire enculer que mes fils n’aiment pas. »
Plus que le vocabulaire utilisé, c’est sa prophétie qui me frappa. Je n’avais jamais pensé qu’un pré avait pu un jour être une forêt, ni qu’il pourrait le redevenir. Je regardai les vaches éparpillées au-dessus de l’alpage et tentai tant bien que mal d’imaginer les premiers arbustes coloniser ces prés, puis grandir, effaçant chaque signe de ce qu’il y avait avant. Les canaux, les murets, les sentiers et même les maisons.
« On appelle ça l’altitude des neiges éternelles , expliqua-t-il : c’est la hauteur à laquelle il ne fait pas assez chaud l’été pour faire fondre toute la neige qui est tombée l’hiver. Une partie résiste jusqu’à l’automne et finit ensevelie sous la couche de neige de l’hiver suivant. À ce stade, elle ne craint plus rien. Petit à petit, elle se transforme en glace, s’ajoute aux autres couches du glacier qui s’entassent, exactement comme les anneaux des arbres, et il suffit de les compter pour connaître son âge. Mais un glacier ne reste jamais au sommet de la montagne. Il bouge. Toute sa vie, il ne fait que glisser.
– Pourquoi ? demandai-je.
– Pourquoi, d’après toi ?
– Parce qu’il est lourd, dit Bruno.
– Parfaitement, dit mon père. Le glacier est lourd, et la roche sur laquelle il est posé, très lisse. Du coup, il descend. Lentement, mais sûrement. Il glisse jusqu’à ce qu’il ne supporte plus la chaleur. C’est l’altitude de la fusion . Vous la voyez, là-bas ? »
Nous marchions sur une moraine qui semblait faite de sable. Une langue de glace et d’éboulis s’avançait en contrebas, bien plus bas que le sentier. Elle était zébrée d’infimes ruisseaux qui se rejoignaient en un petit lac opaque, métallique, glaçant rien qu’à le regarder.
« Cette eau-là, dit mon père, il faut pas croire que c’est la neige de l’hiver dernier. C’est une neige que la montagne a conservée pendant des années et des années : l’eau qu’on voit a peut-être même cent hivers derrière elle.
L’hiver, la montagne n’était pas faite pour les hommes et il fallait la laisser en paix. Dans la philosophie qui était la sienne, qui consistait à monter et descendre, ou plutôt à fuir en haut tout ce qui lui empoisonnait la vie en bas, après la saison de la légèreté venait forcément celle de la gravité : c’était le temps du travail, de la vie en plaine et de l’humeur noire.
Un lieu que l’on a aimé enfant peut paraître complètement différent à des yeux d’adulte et se révéler une déception, à moins qu’il ne nous rappelle celui que l’on n’est plus, et nous colle une profonde tristesse.
Le lac en contrebas ressemblait à de la soie noire, avec le vent qui la dentelait. Ou qui, au contraire, faisait tout sauf de la dentelle : il posait une main glacée qui effaçait les plis.
J’observais l’alpage et l’étrange contraste entre la désolation des choses humaines et la vigueur du printemps : les trois baite dépérissaient, leurs murs se voûtaient comme le dos des vieillards, les toits cédaient sous le poids des hivers ; et tout autour, les herbes et les fleurs sourdaient.
Je commençais à comprendre ce qui arrive à quelqu’un qui s’en va : les autres continuent de vivre sans lui.
Le sapin, il faut éviter, parce que c’est un bois mou. Le mélèze est plus dur. (…) Le fait est que le sapin pousse à l’ombre et le mélèze au soleil : le soleil rend le bois dur, alors que l’ombre et l’eau le ramollissent, c’est pour ça que le sapin ne fait pas de bonnes poutres.
Si je vais vivre dans les bois, personne ne me dira rien. Si une femme le fait, on la traitera de sorcière. Si je me taisais, quel problème ça ferait ? Je ne serais qu’un homme qui ne parle pas. Une femme qui ne parle plus est forcément à moitié folle.
« Nous disons qu’au centre du monde, il y en a un autre, beaucoup plus haut : le Sumeru. Et autour du Sumeru, il y a huit montagnes et huit mers. C’est le monde pour nous. » (…) « Et nous disons : lequel des deux aura le plus appris ? Celui qui aura fait le tour des huit montagnes, ou celui qui sera arrivé au sommet du mont Sumeru ? »
Et il disait : c’est bien un mot de la ville, ça, la nature . Vous en avez une idée si abstraite que même son nom l’est. Nous, ici, on parle de bois , de pré , de torrent , de roche. Autant de choses qu’on peut montrer du doigt. Qu’on peut utiliser. Les choses qu’on ne peut pas utiliser, nous, on ne s’embête pas à leur chercher un nom, parce qu’elles ne servent à rien.
La caillette, c’est un petit morceau de l’estomac du veau, m’expliqua-t-il. Imagine-toi : ce que le veau a dans son estomac pour mieux digérer le lait, nous, on le prend et on s’en sert pour faire du fromage. C’est logique, non ? N’empêche, c’est quand même fou, sans ce bout d’estomac, le fromage ne prend pas.
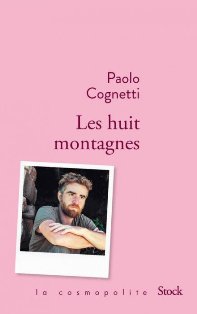

Bonsoir cannelle, un livre qui m'avait plu avec des personnages que l'on regrette de quitter. Je n'ai pas vu l'adaptation filmique. Bonne fin d'après-midi.
RépondreSupprimerBonjour Dasola, Je n'ai pas vu le film. Une lacune à réparer. Bonne journée.
Supprimer