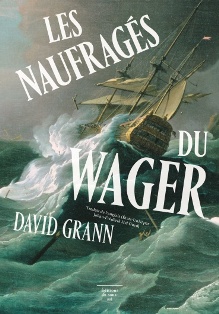Coup de coeur 💓
Titre : Perspective(s)
Auteur : Laurent BINET
Parution : 2023 (Grasset)
Pages : 304
Présentation de l'éditeur :
Florence, 1557. Le peintre Pontormo est retrouvé assassiné au pied des
fresques auxquelles il travaillait depuis onze ans. Un tableau a été
maquillé. Un crime de lèse-majesté a été commis. Vasari, l’homme à tout
faire du duc de Florence, est chargé de l’enquête. Pour l’assister à
distance, il se tourne vers le vieux Michel-Ange exilé à Rome.
La
situation exige discrétion, loyauté, sensibilité artistique et sens
politique. L’Europe est une poudrière. Cosimo de Médicis doit faire face
aux convoitises de sa cousine Catherine, reine de France, alliée à son
vieil ennemi, le républicain Piero Strozzi. Les couvents de la ville
pullulent de nostalgiques de Savonarole tandis qu'à Rome, le pape
condamne les nudités de le chapelle Sixtine.
Perspective(s) est
un polar historique épistolaire. Du broyeur de couleurs à la reine de
France en passant par les meilleurs peintres, sculpteurs et architectes,
chacun des correspondants joue sa carte. Tout le monde est suspect.
Le mot de l'éditeur sur l'auteur :
Laurent Binet a été professeur de lettres pendant dix ans en Seine-Saint-Denis. Il est l’auteur de
HHhH (2010, prix Goncourt du premier roman),
La septième fonction du langage (2015, prix Interallié),
Civilizations (2019, Grand prix du roman de l’Académie française).
Avis :
La censure de la nudité artistique n’est pas une nouveauté, preuve en est ce tout dernier roman de Lauret Binet, un polar historique épistolaire qui nous projette de plain-pied dans la Florence de la Renaissance, en une Italie dont l’effervescence artistique côtoie les déchirements politiques.
En 1557, tandis que la onzième guerre d’Italie place plus que jamais la péninsule au coeur de l’affrontement entre la France et l’Espagne, le pape Paul IV à Rome et le duc Cosimo de Médicis à Florence ont fort à faire pour espérer tirer leur épingle des luttes politiques en cours. Dans ce contexte de crise mais aussi de brassage d’idées – artistiques avec la récente découverte de la perspective en peinture, ou idéologiques avec notamment l’émergence de concepts républicains mais aussi la trace laissée par les prédications de Savonarole –, tout se fait enjeu de pouvoir et objet de sombres manipulations. Surfant sur la polémique née des exigences papales d’habiller de voiles les nus « impies et obscènes » de Michel-Ange, voilà qu’on a osé peintre un nu lascif affublé du visage de Marie de Médicis, le fille du duc de Florence. Au même moment, l’infamant tableau étant déjà devenu l’enjeu d’un combat politique, Pontormo, qu’on savait déjà torturé par la prévisible condamnation des fresques très dénudées, qu’après onze ans d’un travail titanesque, il s’apprêtait à achever, est retrouvé mort au pied de son grand œuvre, un poinçon en plein coeur. Soucieux d’identifier le meurtrier et, peut-être plus encore, de récupérer l’odieux et vexant tableau, Cosimo de Médicis charge Giorgio Vasari, peintre lui aussi en même temps qu’homme de confiance, de mener une double enquête.
Sur la toile de fond solidement tissée de leur contexte historique, Laurent Binet s’empare des points d’interrogation de l’Histoire pour camper, sous un format original, un récit réjouissant et addictif. Des fresques dont Pontormo avait revêtu la chapelle San Lorenzo à Florence ne nous sont parvenus que leurs cartons préparatoires. De la mort du peintre, l’on ne sait rien, même pas précisément la date. Quant à Marie, la fille aînée de Cosimo de Médicis, sa disparition à dix-sept ans est restée l’objet de diverses légendes peu vérifiables. Il n’en faut pas plus à l’écrivain pour nourrir une fiction aussi récréative qu’édifiante, truffée de clins d’oeil, tant à la littérature lorsque sa Catherine de Médicis se prend des airs de Madame de Merteuil, qu’à un certain monde contemporain criant à la pornographie devant le David de Michel-Ange. Rétrospectivement heureux de savoir les fresques de la chapelle Sixtine sauves, l’on en vient à s’affliger de la disparition de celles de Pontormo, peut-être en effet aussi sublimes. Surtout, l’on se régale de cette intrigue pleine de rebondissements et de suspense qui se laisse découvrir au long des pointillés chronologiques laissés par un paquet de 176 lettres échangées, avec toutes les tournures de l’époque, par une vingtaine de protagonistes. Le seul, contrairement aux auteurs des missives, à avoir accès à toutes, le lecteur, dans sa position ex machina, se retrouve en situation de rire – ou de frémir – des tâtonnements, erreurs et quiproquos dans lesquels, avec une malice jubilatoire, l’écrivain s’amuse à égarer les personnages.
Erudite, bien écrite, drôle, cette gourmandise historique s’assortit d’autant d’intelligence que de fantaisie, pour la défense des peintres et des artistes, à commencer par ceux de la Renaissance, contre la censure de tout poil.
« La perspective nous a donné la profondeur. Et la profondeur nous a ouvert les portes de l’infini » « Nous sommes les fenêtres de Dieu. » « C’est pourquoi nous ne devons pas mésestimer nos œuvres mais au contraire les respecter, en prendre soin et les défendre contre quiconque. Les nôtres et celles des autres, quand elles en valent la peine. » Coup de coeur. (5/5)
Citations :
Sans les avoir vues, je suis certain que les fresques de Pontormo doivent être préservées à tout prix, car elles défendent une idée de l’art et du divin que je nous sais partager. L’idée, mon cher Bronzino ! Vous et moi savons qu’il n’y a rien de plus haut. C’est pourquoi je ne doute pas que vous saurez, mieux que personne et aussi bien que moi-même, être fidèle à celle de votre maître, en achevant son œuvre dans l’esprit qui était le sien. Cela faisant, vous prendrez part à la bataille que nous livrons contre des puissances bien obscures, et vous exposerez à de terribles dangers, car nos ennemis grimpent vers nous comme des araignées. À Rome, je crains chaque jour pour ma Sixtine et j’en viens à me demander si je ne dois pas laisser le pauvre Volterra voiler mes nus, comme un moindre mal, pour ne pas risquer la destruction du tout. En réalité, j’en suis même à souhaiter ma propre mort, pour ne pas voir ce qu’il adviendra de mon œuvre, car je n’ai plus guère de doute sur le fait qu’elle ne me survivra pas longtemps.
Un mot encore : je suis passé voir Bronzino sur le chantier de San Lorenzo. Vous savez comme il est rare que j’émette une objection à vos jugements, que je tiens pour les plus assurés du monde, et combien nos goûts et nos avis, à vous et moi, sont presque toujours accordés. Mais j’ai vu les fresques : elles ne sont pas ce que vous dites. Ces corps entassés sont la chose la plus terrible qu’il m’ait été donné de voir, mais c’est là ce qui fait toute leur valeur, et en fait de mesquinerie, c’est le spectacle de l’humanité, dans toute sa grandeur et sa misère, que Pontormo nous a offert. Si Bronzino s’acquitte correctement de sa tâche, comme je l’en crois capable, le chœur de San Lorenzo rivalisera avec la Sixtine. Vous savez bien que ce ne sont pas tant les hommes qui changent leurs goûts que la politique qui change les hommes. Ce qui choque aujourd’hui dans ces peintures, outre la nudité des corps qui n’est plus de mise, c’est l’absence des saints (à l’exception de saint Laurent, bien sûr), des anges, des papes et des évêques, pour rappeler la prééminence de Jésus sur eux tous, ce pourquoi le peintre a poussé l’audace jusqu’à le représenter au-dessus de son propre père, parce que Riccio et Pontormo ont voulu promouvoir la relation directe des hommes à leur Sauveur, sans intermédiation superflue, et vous savez aussi qu’il n’en faut pas davantage, désormais que Rome voit des protestants derrière chaque porte, pour que tout cela sente le fagot.
L’honneur repose uniquement sur l’estime du monde, et c’est pourquoi une femme doit user de tout son talent pour empêcher qu’on débite des histoires sur son compte : l’honneur, en effet, ne consiste pas à faire ou ne pas faire mais à donner de soi une idée avantageuse ou non. Péchez si vous ne pouvez résister, mais que la bonne réputation vous reste.
Or, dans le triste monde où nous vivons, neuf cents sur mille vivent comme des moutons, la tête penchée vers la terre, pleins de folie et de mauvaises pensées, pendant qu’une poignée achète le Ciel en profitant du travail des autres. Si vous observez la conduite des hommes, vous verrez que tous les plus riches et les plus puissants n’ont réussi que par la fraude ou par la force ; vous verrez qu’ils cachent ensuite la turpitude de leur conquête sous le nom de gain, légitimant ce qu’ils ont usurpé par la tromperie ou la violence. Ceux qui, par manque de prudence ou par excès de sottise, se refusent à ces méthodes s’enlisent dans l’asservissement et l’indigence. Les serviteurs fidèles restent des serviteurs et les hommes bons des miséreux.
J’en entends certains qui crient à la République. Mais pour quoi faire, la République, si le pouvoir est aux mains de quelques-uns, au détriment de tous les autres ? Voulez-vous à nouveau jouer la comédie de la Seigneurie, avec ses prieurs et ses fèves tirées au sort dans des bourses d’où sortaient toujours les mêmes noms ? Croyez-vous que les Strozzi, s’ils revenaient, vous défendraient ? Peu nous chaut d’être gouvernés par un seul ou par plusieurs. Ce que nous voulons n’est pas la République mais la justice, qui est l’autre nom de la République pour tous.
Certains encore, parmi les plus résignés, aspirent au royaume de Dieu, plaçant leur espérance dans leur vie céleste pour se consoler de leur misère terrestre. Mais ce que nous voulons n’est pas le paradis pour après notre mort. Nous voulons le royaume de Dieu sur terre, ici et maintenant, à Florence, en l’an de grâce 1557.
Vous devez comprendre, vous qui ne reculez pas devant les plus grandes commandes et qui, en conséquence, savez de quelles souffrances et angoisses se paient nos ambitions, l’état d’épuisement qui est le mien depuis dix ans que j’ai accepté ce chantier de Saint-Pierre. Plus je m’acharne sur cette coupole qui m’aura donné tant de tracas, plus je tends à vous donner raison sur ce qui fut la révélation de votre mésaventure chez l’infortuné Bacchiacca : Brunelleschi est le plus grand génie que l’Italie ait jamais enfanté, que l’Europe ait jamais connu. Ma coupole à double coque a seize pans intérieurs et seize pans extérieurs, qu’en dites-vous ! Voilà qui n’est pas une mince affaire, n’est-ce pas ? Sans doute est-elle plus solide que la sienne, mais sans la sienne, la mienne n’aurait jamais existé, même pas dans mes rêves. (…)
Brunelleschi découvrant les lois de la perspective, c’est Prométhée volant le feu à Dieu pour le donner aux hommes. Grâce à lui, nous avons pu, non pas seulement enluminer des murs comme jadis Giotto avec ses doigts d’or, mais reproduire le monde tel qu’il est, à l’identique. Et c’est ainsi que le peintre a pu se croire l’égal de Dieu : désormais, nous pouvions, nous aussi, créer le réel. Et c’est ensuite que nous avons tenté, pauvres pécheurs que nous sommes, de surpasser notre Seigneur. Nous pouvions copier le monde aussi fidèlement que si nous l’avions façonné nous-mêmes, mais cela ne suffisait pas à étancher notre soif de création, car notre ambition d’artistes, enivrés de ce nouveau pouvoir, ne connaissait plus de limite. Nous avons voulu peindre le monde à notre manière. Nous n’avons pas seulement voulu rivaliser avec Dieu, mais nous avons voulu modifier son œuvre, en redessinant le monde à notre convenance. Nous avons tordu la perspective, nous l’avons délaissée, nous avons effacé les sols à damier de nos prédécesseurs pour faire flotter nos personnages dans l’éther, nous avons joué avec elle comme un chien avec sa balle ou comme un chat agace le cadavre d’un petit moineau qu’il a tué lui-même. Nous nous en sommes détournés. Nous l’avons méprisée. Mais nous ne l’avons jamais oubliée.
Comment aurions-nous pu ? La perspective nous a donné la profondeur. Et la profondeur nous a ouvert les portes de l’infini. Spectacle terrible. Je ne me rappelle jamais sans trembler la première fois que je vis les fresques de Masaccio à la chapelle Brancacci. Quelle connaissance merveilleuse des raccourcis ! L’homme d’aplomb, enfin à sa taille, ayant trouvé sa place dans l’espace, pesant son poids, chassé du paradis mais debout sur ses pieds, dans toute sa vérité mortelle. L’image de l’infini sur terre, voilà ce que, bien loin d’avoir corseté l’imagination des artistes, la perspective artificielle nous a accordé. L’image, seulement, oui bien sûr… en réalité, nous ne pouvions prétendre égaler le Dieu créateur, mais nous pouvions, mieux que les prêtres, porter sa parole au travers d’images muettes ou de statues de pierre. Peintres, sculpteurs, architectes : l’artiste est un prophète parce que, plus que les autres, il a l’idée de Dieu, qui est précisément l’infini, cette chose impensable, inconcevable. Et pourtant… Impensable, oui, mais pas irreprésentable. C’est la perspective qui permet de voir l’infini, de le comprendre, de le sentir. La profondeur sur un plan coupant perpendiculairement l’axe du cône visuel, c’est l’infini qu’on peut toucher du doigt. La perspective, c’est l’infini à la portée de tout ce qui a des yeux. La perception sensible ne connaissait et ne pouvait connaître la notion d’infini, croyait-on. Eh bien, grâce aux peintres qui maîtrisent les effets d’optique, ce prodige a été rendu possible : on peut voir au-delà. Permettre à l’œil de transpercer les murs. Cette voûte en demi-cintre à Santa Maria Novella, tracée en perspective, divisée en caissons ornés de rosaces, qui vont en diminuant, en sorte qu’on dirait que la voûte s’enfonce dans le mur : trompe-l’œil, illusion sans doute, mais quelle merveille ! Nul n’entre ici s’il n’est géomètre ? Eh bien soit, mais plus encore ! Un tableau n’est pas seulement, comme le pensait Alberti, une fenêtre à travers laquelle nous regardons une section du monde visible. Ou bien peut-être n’est-il que cela, en effet, mais alors, n’a-t-on pas déjà là un miracle suffisant pour attester son essence divine ? Nous sommes les fenêtres de Dieu. Voilà ce que nous sommes. Certes, celui qui outrepasse le rôle qui lui a été dévolu ici-bas commet un péché, mais celui qui esquive sa tâche et se défausse ou prend la chose à la légère ne pèche pas moins, et c’est pourquoi nous ne devons pas mésestimer nos œuvres mais au contraire les respecter, en prendre soin et les défendre contre quiconque. Les nôtres et celles des autres, quand elles en valent la peine.
En vérité, l’insulte devient légitime quand elle répond à l’iniquité. La satire n’est-elle pas l’arme des faibles pour ridiculiser les grands ?
Ainsi, comme Léonard et comme vous dans la salle du Conseil, je laisserai mes fresques inachevées, qui connaîtront le même destin. La peinture est un coton gratté de l’enfer qui dure peu. Qu’importe ! C’est ainsi. Je n’ai plus qu’un seul désir avant de mourir : que le divin Michel-Ange pose les yeux sur elles. Vous seul, entre tous, comprenez absolument de quoi il retourne : surpasser la nature en voulant donner de l’esprit à une figure et la faire paraître vivante en la faisant plate.
Après tout, il n’y a qu’une seule chose noble ici-bas, et c’est le dessin. L’homme, lui, n’est qu’une tache qui pâlit sur un mur.







.jpg)