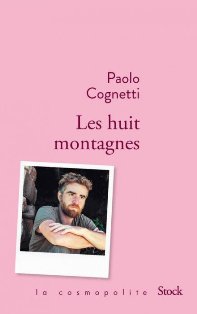J'ai aimé
Titre : Le dernier thriller norvégien
Auteur : Luc CHOMARAT
Parution : 2019
Editeur : La Manufacture de Livres
Pages : 208
Présentation de l'éditeur :
Delafeuille,
l’éditeur parisien, débarque à Copenhague pour y rencontrer le maître
du polar nordique, au moment même où la police locale est confrontée à
un redoutable serial killer : l’Esquimau. Coïncidence ? A peine installé
à l’hôtel avec le dernier roman de l’auteur, Delafeuille découvre que
la réalité et la fiction sont curieusement imbriquées… et qu’il pourrait
bien être lui-même, sans le savoir, un personnage de thriller nordique.
Tueur
fou, flics au bord de la crise de nerfs, meubles Ikéa, livre à tiroirs,
tempête de neige, ours polaires, Sherlock Holmes et la petite fille
aux allumettes : Luc Chomarat nous livre une épopée littéraire jubilatoire, un tour sur le grand huit où le rire le dispute au vertige.
Le mot de l'éditeur sur l'auteur :
Luc Chomaratest né en Algérie en 1959. Remarqué dès son premier roman par le
magazine littéraire, il choisit d’exercer ses talents de rédacteur dans
la publicité où, dit-il, « on trouve l’argent et les filles ». Poursuivi
pour fraude fiscale, il se réfugie dans un monastère tibétain. Il
revient au roman en 2014 avec L’Espion qui venait du livre. En 2016, il reçoit le Grand prix de Littérature Policière pour Un trou dans la toile. Traducteur de Jim Thompson, il est également l’auteur d’essais pour le moins atypiques : Le Zen de nos grands-mères (Le Seuil, 2008) sur son expérience bouddhiste et Les 10 meilleurs films de tous les temps (Marest, 2017) dont le sujet n’est pas clair.
Le Polar de l’été (La Manufacture de livres, 2017) et Un petit chef-d’œuvre de littérature
(Marest, 2018) confirment son goût pour les constructions en abyme, et
son regard particulier sur l’époque, mélange d’ironie et de
désenchantement.
Avis :
Lorsqu'il arrive à Copenhague où il doit rencontrer un célèbre auteur pour négocier les droits de traduction de l'un de ses polars nordiques, l'éditeur français Delafeuille s'aperçoit très vite que les événements lui échappent : alors que sévit dans la ville un tueur en série, fiction et réalité se mettent à s'entremêler au point de devenir indifférenciables. Et si Delafeuille était lui-même devenu un personnage de polar ?
Le récit est tordu à souhait, poussant la complexité de l'intrigue jusqu'à l'absurde, dans un pastiche de polar nordique habilement caricaturé à l'extrême. Plus que l'histoire elle-même, totalement délirante, c'est l'exercice littéraire qui fascine : Luc Chomarat se moque et se joue des codes du genre, dont le succès, et donc la rentabilité, attirent de plus en plus d'auteurs et d'éditeurs, dans une course au profit où s'agglomèrent le meilleur comme le pire des productions.
Il faut reconnaître que la démonstration fait preuve d'audace et d'ingéniosité, voire de virtuosité. L'on s'amuse, surpris et intrigué de la manière dont l'exercice pourrait bien se conclure. Point n'est besoin d'être familier du polar nordique pour saisir la dérision et les messages. Car, au-delà de la pitrerie tirée par les cheveux, dont on sait la maîtrise littéraire qu'elle nécessite lorsqu'elle est aussi bien menée, c'est tout l'avenir de l'écriture et de la création littéraire dont il est question ici.
Lorsque le temps globalement consacré à la lecture rétrécit comme peau de chagrin, que les livres deviennent des produits de consommation, que les contraintes commerciales et la course à la notoriété tendent à prendre le pas sur l'érudition et le talent, que les éditions papier cèdent peu à peu la place au virtuel et à l'interactivité, voire, peut-être un jour, la création humaine à l'intelligence artificielle, comment ne pas s'interroger, voire s'insurger, comme les personnages de ce thriller norvégien amenés à prendre eux-même leurs destins en main pour échapper à leur déliquescence ?
Résolument (trop ?) déjanté, ce vrai-faux polar est indéniablement original et intriguant. Chapeau bas à Luc Chomarat pour cet exercice de virtuosité et de dérision, qui illustre à merveille ses interrogations quant à l'avenir des livres, des auteurs et des éditeurs. (3/5)
Le récit est tordu à souhait, poussant la complexité de l'intrigue jusqu'à l'absurde, dans un pastiche de polar nordique habilement caricaturé à l'extrême. Plus que l'histoire elle-même, totalement délirante, c'est l'exercice littéraire qui fascine : Luc Chomarat se moque et se joue des codes du genre, dont le succès, et donc la rentabilité, attirent de plus en plus d'auteurs et d'éditeurs, dans une course au profit où s'agglomèrent le meilleur comme le pire des productions.
Il faut reconnaître que la démonstration fait preuve d'audace et d'ingéniosité, voire de virtuosité. L'on s'amuse, surpris et intrigué de la manière dont l'exercice pourrait bien se conclure. Point n'est besoin d'être familier du polar nordique pour saisir la dérision et les messages. Car, au-delà de la pitrerie tirée par les cheveux, dont on sait la maîtrise littéraire qu'elle nécessite lorsqu'elle est aussi bien menée, c'est tout l'avenir de l'écriture et de la création littéraire dont il est question ici.
Lorsque le temps globalement consacré à la lecture rétrécit comme peau de chagrin, que les livres deviennent des produits de consommation, que les contraintes commerciales et la course à la notoriété tendent à prendre le pas sur l'érudition et le talent, que les éditions papier cèdent peu à peu la place au virtuel et à l'interactivité, voire, peut-être un jour, la création humaine à l'intelligence artificielle, comment ne pas s'interroger, voire s'insurger, comme les personnages de ce thriller norvégien amenés à prendre eux-même leurs destins en main pour échapper à leur déliquescence ?
Résolument (trop ?) déjanté, ce vrai-faux polar est indéniablement original et intriguant. Chapeau bas à Luc Chomarat pour cet exercice de virtuosité et de dérision, qui illustre à merveille ses interrogations quant à l'avenir des livres, des auteurs et des éditeurs. (3/5)
Citation :
« Eh bien, je pense que sous la multiplicité des péripéties, et leur extrême fantaisie il faut bien le dire, c’est un formatage de la pensée qui est là mis en cause, un certain mode de consommation… des objets culturels. Un livre n’est pas censé surprendre, mais répondre à une attente. »
« Vous nous recommandez donc la lecture de ce thriller… »
« Oui, absolument. En apparence, c’est un livre au discours léger, mais… »
« Vous parliez même de complaisance, dès les premiers chapitres… »
« Oui mais je crois que c’était un leurre. En apparence, parce qu’“Olaf” insistait lourdement sur les scènes porno-gore, faisant appel aux instincts les plus bas de ses lecteurs… Je ne fais que me conformer à mon personnage, vous savez… Mais la vraie complaisance n’est pas là, je pense qu’elle se trouve plutôt dans une inféodation à l’opinion majeure. »
« Pouvez-vous préciser, pour nos amis internautes… »
« Eh bien, à mon avis, le rôle d’un artiste, donc d’un écrivain, est d’introduire le doute là où il y avait certitude. Un peu le contraire du politicien, si vous voulez. »
« Chacun son rôle. »
« Chacun son rôle. La complaisance consiste à fournir, à répondre à la demande. »)