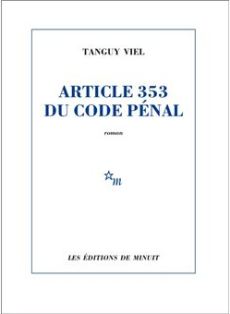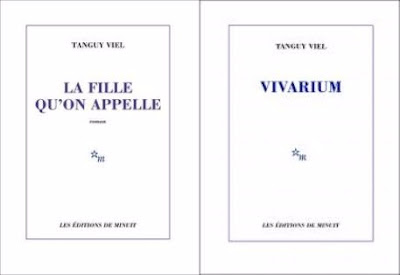J'ai aimé
Titre : Il n'y aura pas de sang versé
Auteur : Maryline DESBIOLLES
Parution : 2023 (Sabine Wespieser)
Pages : 152
Présentation de l'éditeur :
Au tournant de l’année 1868, elles sont quatre très jeunes femmes à
converger vers les ateliers de soierie lyonnaise où elles ont trouvé à
s’employer : « ovalistes », elles vont garnir les bobines des moulins
ovales, où l’on donne au fil grège la torsion nécessaire au tissage. Rien
ne les destinait à se rencontrer, sinon le besoin de gagner leur vie :
Toia la Piémontaise arrive à Lyon en diligence, ne sachant ni lire ni
parler le français, pas plus que Rosalie Plantavin, dont l’enfant est
resté en pension dans la Drôme, où sévit la maladie du mûrier. La
pétillante Marie Maurier vient de Haute-Savoie. Seule Clémence Blanc est
lyonnaise : elle a déjà la rage au cœur après la mort en couches de
l’amie avec qui elle partageait un minuscule garni, rue de la Part-Dieu. Les
mettant littéralement en mouvement par la grâce de sa langue nerveuse
et inventive, Maryline Desbiolles imagine ses quatre personnages en
relayeuses, à se passer le témoin dans une course vers la première grève
de femmes connue.
C’est en juin 1869 que la révolte éclate : les maîtres mouliniers font la sourde oreille aux revendications des ouvrières qui réclament de meilleures conditions de travail et de logement. Les filles s’enhardissent, le mouvement s’amplifie et dès lors le livre avance au rythme exaltant d’une troupe féminine s’autorisant enfin à ne plus courber l’échine : nos quatre relayeuses y apparaissent comme en couleur, dans une foule anonyme en noir et blanc, titubantes dans l’élan de leur propre audace.
Donner vie et chair à leurs émotions, leurs élans et leurs expériences est le plus bel hommage qui pouvait être rendu à ces oubliées de l’histoire.
C’est en juin 1869 que la révolte éclate : les maîtres mouliniers font la sourde oreille aux revendications des ouvrières qui réclament de meilleures conditions de travail et de logement. Les filles s’enhardissent, le mouvement s’amplifie et dès lors le livre avance au rythme exaltant d’une troupe féminine s’autorisant enfin à ne plus courber l’échine : nos quatre relayeuses y apparaissent comme en couleur, dans une foule anonyme en noir et blanc, titubantes dans l’élan de leur propre audace.
Donner vie et chair à leurs émotions, leurs élans et leurs expériences est le plus bel hommage qui pouvait être rendu à ces oubliées de l’histoire.
Le mot de l'éditeur sur l'auteur :
Née en 1959 à Ugine, Maryline Desbiolles vit à Nice. Elle est l’autrice d’une œuvre importante, essentiellement publiée dans la collection Fiction & Cie au Seuil. Elle a été révélée au public avec La Seiche (1998), bientôt suivi d’Anchise (prix Femina, 1999). Son roman le plus récent, Charbons ardents, a remporté le prix Franz-Hessel 2022. Elle rejoint avec Il n’y aura pas de sang versé le catalogue de Sabine Wespieser éditeur.Avis :
Le fil de soie grège ne peut être tissé directement. Il faut le rendre plus résistant en le moulinant, c’est-à-dire en lui faisant subir une torsion avant de l’enrouler sur les bobines de moulins rendus plus performants par leur forme ovale. Au milieu du XIXe siècle, cette opération emploie des milliers d’ouvrières en France, dont beaucoup dans la région lyonnaise où on les appelle les ovalistes. Sans qualification, elles travaillent douze heures par jour, sont payées à la pièce bien moins cher que leurs homologues masculins, et comme on les recrute dans les campagnes environnantes et même jusqu’au Piémont, elles s’entassent dans des dortoirs insalubres et surpeuplés, totalement assujetties au strict règlement de leurs « usines-pensionnats ». A l‘été 1869, ces filles illettrées, qui se voient contraintes d’avoir recours à un écrivain public pour exposer leurs revendications, se mettent en grève, réclamant un meilleur salaire et un temps de travail réduit. C’est la première grève de femmes connue. Elle va durer un mois, se solder par des emprisonnements et des expulsions des ateliers-dortoirs, avant que le travail ne reprenne sans aucune avancée significative. Elle marque cependant l’histoire d’une pierre blanche, celle qui inaugure la longue lutte dont les femmes se sont passé le relais jusqu’à aujourd’hui pour l’amélioration progressive de leur condition.Cette image du passage de relais entre les femmes s’est si bien imposée à l’auteur lorsqu’elle s’est intéressée à la grève des ovalistes qu’elle en a fait le fil conducteur de son roman. Soif d’émancipation, prise de conscience de leur sororité face à la toute-puissance des hommes et des employeurs qui les traitent en « bonnes filles » modestes et dociles : sans violence ni sang versé, avec la seule calme détermination née d’un trop-plein d’injustice et de servitude silencieuse, ces femmes sont les premières, non pas à se révolter, mais à en prendre l’initiative. Ce sont elles qui s’autorisent enfin à ne plus courber l’échine. Et même si elles n’obtiennent pas gain de cause, elles sont des pionnières qui ouvrent à leurs semblables, femmes de leur temps ou des générations à venir, le long chemin du féminisme. Alors, à cette troupe en jupons perdue dans l’oubli incolore de l’anonymat, Maryline Desbiolles a choisi de prêter quatre visages imaginés comme en technicolor, leur redonnant chair et vie en quelques scènes croquées sur le vif, et insistant sur la sororité des femmes par-delà les siècles.
Jonglant avec les mots et les images dans une langue courant comme une rivière en longs rubans de phrases non dénuées de poésie, l’écrivain met l’originalité, probablement clivante, de son style au service d’un roman social et féministe, construit sur un fait historique oublié pour mieux inviter les femmes à reprendre le flambeau de la lutte. (3,5/5)
Citations :
En attendant, toute la semaine, debout douze heures par jour, elles veillent jusqu’à sept heures du soir sur les moulins dont elles garnissent et dégarnissent les bobines, vérifient la qualité de la soie, nouent et dénouent les fils cassés. Nul besoin de qualification. (…) Femmes sans qualification. Femmes sans qualités. Ovalistes. Les mots dépassent la petitesse de la paie comme de la pensée.
Philomène Rozan ne mène pas ses paroles à la baguette, ses paroles s’envolent, elles ne se dispersent pas, elles se posent sur la tête des ovalistes, sur leur langue, des paroles qui ne font pas tourner la tête, ou qui la font tourner mais pas à la manière des ritournelles, des paroles qui n’enivrent pas, mais qui donnent soif, gagner davantage que 1,40 F, gagner 2 F comme les hommes même si c’est impensable, être payées au temps, pas aux pièces, et pas nourries logées comme des domestiques, avoir le droit de s’asseoir, prendre plus de pauses, avoir une chambre à soi, ou du moins un lit à soi, travailler dix heures et non pas douze, avoir un lit et du temps à soi, c’est pas la lune et c’est la lune à voir la tête des patrons auxquels ces doléances sont présentées le 17 juin 1869, de vive voix, bien sûr de vive voix, ces dames et demoiselles ne savent ni lire ni écrire (…).
Philomène Rozan ne mène pas ses paroles à la baguette, ses paroles s’envolent, elles ne se dispersent pas, elles se posent sur la tête des ovalistes, sur leur langue, des paroles qui ne font pas tourner la tête, ou qui la font tourner mais pas à la manière des ritournelles, des paroles qui n’enivrent pas, mais qui donnent soif, gagner davantage que 1,40 F, gagner 2 F comme les hommes même si c’est impensable, être payées au temps, pas aux pièces, et pas nourries logées comme des domestiques, avoir le droit de s’asseoir, prendre plus de pauses, avoir une chambre à soi, ou du moins un lit à soi, travailler dix heures et non pas douze, avoir un lit et du temps à soi, c’est pas la lune et c’est la lune à voir la tête des patrons auxquels ces doléances sont présentées le 17 juin 1869, de vive voix, bien sûr de vive voix, ces dames et demoiselles ne savent ni lire ni écrire (…).