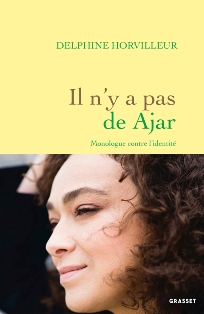Coup de coeur 💓💓
Titre : Le défi de Jérusalem
Auteur : Eric-Emmanuel SCHMITT
Parution : 2023 (Albin Michel)
Pages : 224
Présentation de l'éditeur :
« Marcher là-bas, où tout a commencé. »
Après La Nuit de feu, où Éric-Emmanuel Schmitt décrivait son expérience mystique dans le désert du Hoggar, il revient aux sources avec ce récit de voyage en Terre sainte, territoire aux mille empreintes. Bethléem, Nazareth, Césarée, lieux intenses et cosmopolites qu’il saisit sur le vif tout en approfondissant son expérience spirituelle, ses interrogations, réflexions, sensations, étonnements jusqu’à la surprise finale, à Jérusalem, d’une rencontre inouïe avec ce qu’il nomme « L’incompréhensible ».
Après La Nuit de feu, où Éric-Emmanuel Schmitt décrivait son expérience mystique dans le désert du Hoggar, il revient aux sources avec ce récit de voyage en Terre sainte, territoire aux mille empreintes. Bethléem, Nazareth, Césarée, lieux intenses et cosmopolites qu’il saisit sur le vif tout en approfondissant son expérience spirituelle, ses interrogations, réflexions, sensations, étonnements jusqu’à la surprise finale, à Jérusalem, d’une rencontre inouïe avec ce qu’il nomme « L’incompréhensible ».
Le mot de l'éditeur sur l'auteur :
Dramaturge, romancier, nouvelliste, essayiste, cinéaste, traduit en 48 langues et joué dans plus de 50 pays, Éric-Emmanuel Schmitt est un des auteurs les plus lus et les plus représentés dans le monde. Membre depuis 2016 de l’académie Goncourt, il prolonge ici sa réflexion sur la foi, inaugurée avec La Nuit de feu (2015).Avis :
Sur un coup de fil surprise du Vatican, Eric-Emmanuel Schmitt accepte de suspendre l’écriture de son cycle La Traversée des Temps, dont le troisième des huit tomes est paru l’an dernier, pour une visite en Terre Sainte et, peut-être, la publication d’un journal de voyage.Lui que l’étude des Evangiles et l’expérience du désert du Hoggar ont convaincu de croire au mystère divin – lui inspirant au passage plusieurs livres comme L’Evangile selon Pilate et La Nuit de Feu –, mais qui, peu assidu des églises, observe la liturgie chrétienne avec des yeux de « poisson rouge », débarque donc à l’aéroport de Tel-Aviv pour, passablement décontenancé, rejoindre à Nazareth un groupe de pèlerins réunionnais, menés par le père Henri et la guide Guila. Bardé de sa bonne volonté et de ses carnets de notes qu’il noircit studieusement, le voilà lancé dans le circuit habituel du pèlerinage en Terre Sainte, avec en point d’orgue la découverte de là « où tout a commencé » : Jérusalem.
L’érudition et la qualité de réflexion de l’écrivain se mêlent à sa sincérité pour un compte-rendu souvent aussi drôle qu’intéressant, tandis que ses observations le conduisent d’une certaine frustration – entre contagion du béton, tohu-bohu urbain et flots de bimbeloterie à destination des hordes de touristes, « l’unique berceau de l’extraordinaire est l’ordinaire » – à une franche irritation – « Quand je lis les récits de voyageurs anciens, tels Chateaubriand, Lamartine, Loti, je les jalouse d’avoir foulé des sites vierges » –, et même à de vraies bouffées de rejet – « Que fais-je ici ? La dérision me gagne. Mon esprit voltairien commence à persifler, jugeant ce spectacle aussi navrant que ridicule » « L’envie de déserter cette mascarade me ronge. Je ne m’estime ni en résonance ni en sympathie avec ceux qui m’encerclent, j’aspire à récupérer ma liberté, ma rationalité, mon autonomie. Maillon de cette chaîne de bigots, moi ? Quelle prison ! Je vais m’extraire de ce rituel imbécile. »
Pourtant, à sa plus grande stupéfaction, alors que, s’appliquant à suivre sans broncher le parcours programmé, il se prend insensiblement à lâcher prise, ce n’est pas moins qu’une vraie révélation, l’incompréhensible expérience d’une évidence rappelant le « Il fait Dieu » de Didier Decoin, qui l’attend au détour de ce voyage dont il reviendra confondu et bouleversé.
L’on reste durablement impressionné par ce texte intelligent et sincère, qui sertit si bien l’extrême intimité d’une expérience spirituelle à corps défendant dans la sage objectivité d’observations et de réflexions historiques, politiques et philosophiques, en tout point captivantes. Voilà un écrivain que l’on ne se lasse pas de lire et d’écouter, fasciné par son érudition, son humanité et… son carnet d’adresses où figure désormais le Pape François à qui l’on doit la postface de ce livre. Coup de coeur. (5/5)
Citations :
La photographie, le cinéma, la vidéo ont changé le voyage, car des milliers d’images précèdent l’instant où nous bouclons nos valises. Même lorsque nous nous éloignons de notre quotidien, nous ne nous dirigeons plus vers l’inconnu. Les limites du monde ont disparu, ces au-delà opaques d’une herméticité absolue, ces confins auxquels ne s’accrochaient que des rêves. L’étranger est devenu familier, l’effroi s’amoindrit à mesure que s’élargit le champ de l’iconographie, nous avançons toujours vers de l’entrevu.
De même que le philosophe grec soutenait que les idées préexistent quelque part, que dès lors connaître se réduit à de l’attention, je suis convaincu que les romans et les nouvelles préexistent quelque part, et que écrire consiste à guetter la proie avant de ramener l’animal vivant. Jeune, on croit qu’on crée. Mûr, on comprend qu’on observe. Vieux, on sait qu’on obéit.
Chez l’écrivain, vieillir procure un avantage. Les années apportent une meilleure intelligence de soi : on se connaît, on perd moins de temps, on ne court plus après la légitimité, on canalise ses forces sur les points capitaux, on ne se regarde plus dans le miroir toutes les trois phrases, on a repéré ses limites et surtout les ruses, les expédients, les méthodes qui permettent de les transcender. À vingt ans, j’étais un cheval sauvage que je ne parvenais pas à diriger. À soixante, je suis toujours ce cheval sauvage, mais je sais le mener.
Être chrétien revient à accepter le mystère. Les récits évangéliques nous le présentent sans l’éclaircir, ils nous en rapportent les éléments comme de purs événements : Jésus, Fils de Dieu, né en Galilée, prodigua sa parole, souleva de plus en plus de méfiance, puis fut exécuté à Jérusalem où il ressuscita. À notre cerveau de mouliner jusqu’à admettre cela ! Au cœur d’y adhérer ! Le mystère ne réside pas dans l’inconnu, mais dans l’incompréhensible. (…)
Le mystère désigne donc ce que la pensée n’arrive pas à penser.
La raison scrupuleuse doit traquer ses limites. En même temps qu’elle exploite ses possibilités, elle mesure ses impossibilités ; lorsqu’elle décèle une frontière, elle va au-devant d’elle, l’explore au lieu de la fuir.
En travaillant des milliers d’heures sur le christianisme, ce fut philosophiquement que je transgressai la philosophie, rationnellement que je me risquai à l’irrationnel : la logique me poussait à dépasser la logique. Loin de trahir ou de me fourvoyer, j’avançais.
Enfin, à l’issue de quelques années d’enquête, je me rendis compte que j’étais devenu chrétien. Une alchimie intérieure, presque indépendante de ma volonté, m’avait métamorphosé. Aux deux questions fondamentales – « Jésus constitue-t-il l’incarnation de Dieu ? », « Jésus a-t-il ressuscité ? » –, je répondais par l’affirmative. Le christianisme ne nous aide pas à penser l’impensable, il nous incite à l’affronter humblement. Il tance l’esprit en lui confirmant ce que nous soupçonnions : la raison n’embrasse pas tout, beaucoup de choses lui échappent. L’essentiel peut-être…
Les aéroports n’ont pas été conçus pour faciliter les voyages mais pour en dégoûter, ils se ressemblent tous. En dépit des milliers de kilomètres franchis, nous retrouvons les mêmes couloirs, des enseignes similaires, des boutiques jumelles, une ambiance identique, un cadre technologique interchangeable, une logistique dénuée de singularités. Les aéroports devraient constituer une promesse, celle de la contrée où l’on atterrit ; au rebours, ils se raccordent à un fonctionnalisme universel. Pourquoi un pays commence-t-il après son aéroport ?
Maintenant, la ville de Nazareth, inaltérablement située à 400 mètres d’altitude, s’est agrandie, élargie, mais elle offre un parfum identique, celui de la trivialité. Entre les exhalaisons d’essence et les gras effluves des fast-foods, les pétarades des mobylettes et les klaxons des cars, la musiquette de variété internationale vomie par les autos et le folklore touristique arrosant les boutiques de bibelots, elle s’apparente à mille endroits. Voilà ce pour quoi j’ai franchi des milliers de kilomètres : la banalité. Suis-je déçu ? Non, je reçois ma première leçon : l’unique berceau de l’extraordinaire est l’ordinaire.
J’ai d’abord cru que Jésus trompait les malheureux par de belles promesses, leur annonçant la venue de lendemains meilleurs dans l’au-delà pour compenser leur aujourd’hui calamiteux. Cela me scandalisait. Jésus proposait arbitrairement une consolation future pour les souffrances du moment ? Trop facile ! Quelle parole vide de sens ! L’opium servi au peuple !
Or un jour j’ai compris qu’il ne s’agissait pas d’une promesse, mais d’une constatation. Le bonheur se trouve actuellement chez ceux qui pratiquent les vertus énumérées, humilité, douceur, sensibilité, probité, compassion, pureté, pacifisme, rébellion. Jésus les encourage à les repérer et à en éprouver plus de satisfaction. Son message pourrait se formuler en ces mots : « Heureux, vous l’êtes déjà. Vous l’êtes à votre insu. Prenez-en conscience, puisez-y de la force, et de la sorte engendrez votre avenir. Vous méritez ce bonheur au présent comme au futur. Le Royaume de Dieu appartient à ceux qui se comportent ainsi. » Désirer que le règne de Dieu vienne, c’est être habité par Dieu avant d’aller habiter chez lui.
La secte, c’est toujours la religion des autres.
L’affrontement de deux légitimités. Deux camps s’opposent qui, à leur manière, ont tous les deux raison. Il ne s’agit ni d’un combat entre le bien et le mal, ni d’un assaut du vrai contre le faux ; il s’agit de deux conceptions du bien inconciliables, de deux vérités qui s’excluent.
Israël a raison, la Palestine a raison. Les deux pays justifient leur occupation du territoire par une présence longue, ancestrale, licite.
Les Juifs en furent chassés à deux reprises : une première dispersion de leurs élites en 587 avant Jésus-Christ par les Babyloniens, une seconde, décisive, par les Romains en 70. Titus, futur empereur, assiégea, pilla, incendia Jérusalem, massacra la population et détruisit le Temple, ce qui provoqua l’exil. Au XIXe siècle, la montée des nationalismes et de l’antisémitisme en Europe poussa les Juifs de la diaspora à désirer un État juif. Le mouvement sioniste se forma et rêva d’une réinstallation en Israël. L’horreur absolue que commirent les nazis en organisant leur extermination libéra les verrous de ce projet : avec le soutien de l’ONU, la création de l’État d’Israël fut proclamée en 1948.
Or des populations occupaient légitimement cette terre depuis deux millénaires, lesquelles vécurent sous l’Empire romain, puis ottoman, devinrent musulmanes en majorité, parlaient arabe ou turc. En 1947, les Arabes palestiniens ainsi que les États arabes voisins rejetèrent le plan de partage de l’ONU. La violence redoubla. À leur tour, ces populations subirent des expulsions et connurent par les Juifs ce que les Romains avaient jadis infligé aux Juifs. Elles prirent les armes et tout s’envenima.
Telle est la logique tragique : chacun des blocs possède sa légitimité, laquelle lui est déniée par l’autre.
Telle est la logique tragique : puisque personne n’a raison ni tort, la force se substitue à la discussion, au droit.
Telle est la logique tragique : le problème s’amplifie et demeure sans issue.
Lorsqu’on naît israélien ou palestinien, on choisit vite son clan, car par le sang, les fêtes, les souvenirs, parfois par le deuil et le chagrin, on se rattache à une communauté. J’ai rencontré néanmoins des Israéliens et des Palestiniens choqués par ce conflit qui a pris leur pensée en otage ; ils souffrent de ne pouvoir introduire des analyses, peser le pour et le contre, inaugurer un espace de dialogue, donc de partage. Sous la haine de l’autre se tapit toujours une aversion fondamentale : le refus de la complexité. Les apporteurs de nuances, ceux qui perçoivent la tragédie et ne la balayent pas au moyen d’un choix partisan, tiennent une position difficile : ces écartelés se révèlent inaudibles, promptement traités d’anti-Arabes ou d’antisémites. (…)
Face à ceux, consternés mais conscients, qui gardent à l’esprit le tragique de la conjoncture, les marchands de drame prolifèrent. Sous le drapeau d’une idée réductrice, ils réunissent les gens pour voter ou pour se battre, impatients d’imposer un remède unique à une maladie aux causes multiples. Ici, terroristes et démagogues s’équivalent : ils repoussent la tragédie en nous refilant le drame.
Un jour, pendant que Banksy peignait, un habitant lui avait dit : « Vous embellissez le mur. » Banksy l’avait remercié, mais l’homme l’avait interrompu : « On ne veut pas que ce mur soit beau, on ne veut pas de ce mur. Rentrez chez vous. » [mur de séparation Israël-Palestine]
L’enquête a débuté avec les historiens. Ceux-ci ont montré que, contrairement à la légende, la destruction du Temple par Titus avait provoqué en 70 une dispersion de la population juive massive mais pas totale : des Juifs étaient demeurés sur le sol,en particulier des paysans attachés à leurs champs. Si l’on suit le cours de leur destinée à travers les siècles, on s’aperçoit qu’ils furent hellénisés, romanisés, convertis à l’islam. Les Palestiniens d’aujourd’hui en descendent, ayant gardé des empreintes du passé dans leur dialecte, leurs patronymes, la pratique de la circoncision juste après la naissance alors que l’islam l’impose à l’adolescence.
L’enquête continue avec les travaux d’un biologiste espagnol, Antonio Arnez-Vilna, qui a mis en lumière une parenté génétique entre Juifs et Palestiniens, une proximité relayée par des études sur les maladies héréditaires.
L’enquête continue avec les travaux d’un biologiste espagnol, Antonio Arnez-Vilna, qui a mis en lumière une parenté génétique entre Juifs et Palestiniens, une proximité relayée par des études sur les maladies héréditaires.
Les combats auxquels se livrent Israël et la Palestine depuis soixante-quinze ans se révèlent donc une guerre fratricide. Le même sang coule des deux côtés.
« Je ne crois que ce que je vois », s’exclama Thomas, le disciple qui doutait de la résurrection de Jésus. Ce sceptique ne céda que lorsqu’il posa ses mains sur l’empreinte des clous, ses doigts dans les plaies du revenant.
Je l’ai toujours contredit : « Tu ne vois que ce que tu crois. » Nous avons appris à regarder le monde à travers des concepts, des savoirs, des idéologies, en plus de nos attentes et centres d’intérêt singuliers. Personne n’appréhende la réalité pure, chacun la discerne avec les lunettes qu’il a chaussées, lesquelles apportent leur précision autant que leurs limites. Ce qui paraît prodigieux à telle époque change de catégorie quand la science l’élucide. Voilà pourquoi les miracles se raréfient de siècle en siècle…
Les raisons de croire n’engendrent pas la croyance. La foi ni ne se déduit ni ne découle d’une logique. L’esprit prépare le terrain pour qu’elle s’y enracine à l’occasion, guère davantage. Les démonstrations de Dieu ou de Jésus n’obtiennent jamais le statut de preuves, seulement celui d’arguments.
Croire reste un saut. Se rallier au christianisme ne relève pas du rationnel, c’est consentir à un signe.
L’athée est celui qui croit en la mort, il y voit le néant. Le chrétien est celui qui croit en la vie dont il attend qu’elle triomphe du néant.
Tout relève de la croyance quand il s’agit d’appréhender ce que nous ignorons.
Les pierres savent qu’elles sont pierres, faites d’une matière commune, et n’ont de formes que d’emprunt. L’humanité s’obstine à l’oublier en ce qui la concerne. D’abord nous nous estimons absolument différents les uns des autres alors que nous sommes tous modelés de la même pâte humaine. Quant aux formes que revêt notre être – notre langage, notre spiritualité, notre culture –, au lieu de les reconnaître comme d’emprunt, contingentes, historiques, dues au hasard de la naissance et des circonstances, nous nous convainquons qu’elles composent un béton dont les coulures ont irrémédiablement forgé notre identité.
Jérusalem m’avertit : avoir une religion, ce n’est pas détenir la vérité, une vérité logique que l’on prouve, une vérité découlant d’arguments qui la rendent nécessaire, une vérité universelle. « Deux plus deux font quatre », énonce une vérité, laquelle ne nous demande ni de la valider ni de la préférer mais s’impose ; si l’on désire compter, on l’utilise. En revanche, les spiritualités ne se situent pas dans ce champ-là. Elles proposent. Elles promettent.
Aucune religion n’est vraie ou fausse. La mienne pas davantage qu’une autre. « Si on ne faisait que pour le certain, on ne ferait rien pour la religion car elle n’est pas certaine », rappelait Blaise Pascal. Quand on pratique un culte, on ne possède pas la vérité, plutôt une manière de vivre et de penser. La religion ne se partage pas ainsi que les axiomes ou les sentences incontournables de la raison, elle se répand parce que des individus décident de s’en imprégner, de fonder ou de rejoindre une communauté. Chaque religion est élue, pas démontrée. Lorsqu’elle n’est pas adoptée, elle est héritée.
À la différence de la raison qui soumet notre esprit, la religion sollicite notre liberté. Elle lui présente une vision, un programme, des valeurs, des rites, et espère son acquiescement.
Aucune religion n’est vraie ou fausse. La mienne pas davantage qu’une autre. « Si on ne faisait que pour le certain, on ne ferait rien pour la religion car elle n’est pas certaine », rappelait Blaise Pascal. Quand on pratique un culte, on ne possède pas la vérité, plutôt une manière de vivre et de penser. La religion ne se partage pas ainsi que les axiomes ou les sentences incontournables de la raison, elle se répand parce que des individus décident de s’en imprégner, de fonder ou de rejoindre une communauté. Chaque religion est élue, pas démontrée. Lorsqu’elle n’est pas adoptée, elle est héritée.
À la différence de la raison qui soumet notre esprit, la religion sollicite notre liberté. Elle lui présente une vision, un programme, des valeurs, des rites, et espère son acquiescement.
Cette liberté, certains la détestent. Soit par nostalgie de la raison, soit par inquiétude, ils n’en veulent pas. Les premiers récusent toutes les religions ; les seconds excluent les confrontations qui fragiliseraient leur croyance, jugent que ce en quoi ils croient est la vérité, et virent à l’intégrisme. Ne supportant pas la contradiction, ils vilipendent l’athée, ils méprisent les convictions étrangères, ils dénoncent comme hérétique celui qui interprète dissemblablement leurs textes, ils haïssent l’altérité au point, dès qu’ils en ont les moyens, de convertir les peuples voire, en cas d’échec, de les massacrer. À la force rationnelle qui leur manque, ils substituent la force tout court. À leurs yeux, la violence reste la plus efficace façon d’éradiquer le doute. Les carnages perpétrés au nom des religions dérivent de ce rejet de la critique, d’une allergie à l’incertain.
Chaque religion met une vertu en avant : le respect pour les juifs, l’amour pour les chrétiens, l’obéissance pour les musulmans, la compassion pour les bouddhistes.
La clé de cette nation se trouve là : Israël résulte de cette violence, l’extermination systématique des Juifs par les nazis. Un traumatisme l’a fondée. Comment cette brutalité n’aurait-elle pas encore des répercussions ? Comment ne pas réagir par la force quand on a été victime d’une force écrasante, nihiliste, sans compromis ? Adoptera-t-on l’angélisme après avoir échappé miraculeusement au néant et vu mourir les siens ? Non seulement ce peuple vaincu a besoin de victoire, mais désormais l’essence de l’âme juive comprend la crainte permanente de sa destruction.
Si rien ne légitime la violence qu’inflige parfois le gouvernement d’Israël aux populations arabo-musulmanes, l’Histoire l’explique. Attention cependant : expliquer ne revient pas à justifier.
Pourquoi partir ?
Je me le demandais il y a quelques mois, lorsque, à la perspective hasardeuse de pérégriner en Terre sainte, je préférais le confort de mon métier, fût-il parfois pesant. J’étais alors persuadé que mon esprit ne se nourrissait que de pensées et de livres.
Or il me semble évident aujourd’hui que l’esprit avance avec les pieds.
Je me le demandais il y a quelques mois, lorsque, à la perspective hasardeuse de pérégriner en Terre sainte, je préférais le confort de mon métier, fût-il parfois pesant. J’étais alors persuadé que mon esprit ne se nourrissait que de pensées et de livres.
Or il me semble évident aujourd’hui que l’esprit avance avec les pieds.
Marcher, s’épuiser, transpirer, découvrir, rencontrer, voilà ce qui, chaque fois, a suscité le renouvellement de ma vie spirituelle. Si je n’avais pas traversé le Sahara, je n’aurais jamais reçu la foi. Si je n’avais pas gagné Jérusalem, je n’aurais jamais perçu Jésus comme une personne et comme Dieu. Toujours, au cours de mon existence, des révélations m’attendaient au bout des routes.
Pourquoi partir ? Parce qu’il faut d’abord abandonner son cadre, perdre ses repères, se désenkyster. de ses habitudes : cette rupture constitue une hygiène nécessaire. Le voyage exprime ensuite le respect de soi-même, le soin qu’on apporte à soi-même : consacrer du temps à la rêverie, à l’impromptu, aux sensations, aux sentiments. Enfin, il nous porte à ouvrir les bras, le cœur, l’intellect, à déverrouiller nos préjugés, à assumer notre faiblesse, à cultiver notre fragilité. Sans nos failles, comment la lumière passerait-elle ?
Le voyage coupe, disperse, recentre puis aboutit.
Le voyage coupe, disperse, recentre puis aboutit.
L’humanité se divise entre ceux qui résolvent des énigmes et ceux qui demeurent à l’écoute des mystères.
On ne devient pas chrétien parce qu’on a élucidé le mystère du christianisme, on devient chrétien parce que l’on palpe ce mystère, qu’on le fréquente, qu’on s’en inspire et que, de son contact, on sort modifié. Si la foi chrétienne réclame au départ une intelligence persévérante – lire les Évangiles, les comparer, les interroger, les compléter –, elle la dépasse pour se muer en adhésion. Comment ? Mon expédition me l’a révélé.
Le christianisme est un mystère auquel il reste mystérieux de croire.
Au fond, il y a deux façons d’appréhender un voyage en Israël et en Palestine, deux manières aussi légitimes l’une que l’autre. Certains cherchent leurs racines dans la terre. Moi je les ai trouvées dans le ciel.
Du même auteur sur ce blog :