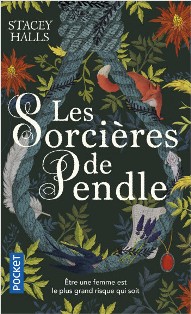dimanche 31 octobre 2021
Bilan de mes lectures - Octobre 2021
J'ai aimé :
samedi 30 octobre 2021
[Brown, Taylor] Le fleuve des rois
J'ai beaucoup aimé
Titre : Le fleuve des rois
(The River of Kings)
Auteur : Taylor BROWN
Traducteur : Laurent BOSCQ
Parution : en anglais (Etats-Unis) en 2017
en français (Grasset) en 2021
Pages : 464
Présentation de l'éditeur :
Il faut dire que l’Altamaha River n’est pas un cours d’eau comme les autres : nombreuses sont ses légendes. On raconte notamment que c’est sur ses berges qu’aurait été établi l’un des premiers forts européens du continent au XVIe siècle, et qu’une créature mystérieuse vivrait tapie au fond de son lit.
Remontant le cours du temps et du fleuve, l’auteur retrace le périple des deux frères et le destin de Jacques Le Moyne de Morgues, dessinateur et cartographe du roi de France Charles IX, qui prit part à l’expédition de 1564 au cœur de cette région mythique du Nouveau Monde. De cette passionnante épopée se dégagent une grâce et une intensité qui imposent Taylor Brown comme un digne héritier de Cormac McCarthy et de Ron Rash.
Le mot de l'éditeur sur l'auteur :
Né en 1982 en Géorgie, dans le sud des États-Unis, Taylor Brown a vécu à Buenos Aires et à San Francisco avant de s’installer en Caroline du Nord. Baroudeur, touche-à-tout, passionné de moto autant que de voitures de collection et jamais en panne d’inspiration, il s’est imposé en quelques années comme l’un des écrivains les plus prometteurs de sa génération. Le Fleuve des Rois est son troisième roman à paraître en France après La Poudre et la Cendre (Autrement, 2017) et Les Dieux de Howl Mountain (Albin Michel, 2019).Avis :
Le pêcheur de crevettes Hiram Loggins était l’un de ces habitants. « Etait », parce qu’il est mort voilà un an, dans d’obscures circonstances qui font s’interroger ses deux fils, Lawton et Hunter. Les deux frères se sont lancés dans la descente du fleuve en kayak, un voyage de quatre jours avant l’océan où ils comptent disperser les cendres paternelles. Le trajet est pour eux un pèlerinage sur les lieux de leur enfance et sur ceux où leur père acheva sa vie en vieux solitaire, mais aussi, espèrent-ils, l’occasion d’en savoir un peu plus sur l’accident qui lui fut fatal. Car l’homme connaissait le fleuve et ses dangers comme sa poche. Brutal et attaché comme il l’était à son marais, il aurait aussi bien pu gêner quelque braconnier, pêcheur à l’explosif, ou encore récupérateur des « mérous carrés » largués par avion par les narcotrafiquants colombiens...
Dès lors, la narration ne cesse d’alterner entre trois récits, vibrants de la même tension addictive : les investigations contemporaines, teintées d’aventure et de nature-writing, des deux frères ; la vie du père, toute entière dédiée au fleuve et réservant bien des surprises ; enfin, dans une mise en perspective éclairant l’histoire du marais et l’origine de ses légendes, la dramatique installation au 16e siècle des premiers colons français sur ces terres inhospitalières et leur confrontation violente aux amérindiens Timucuas. Trois époques, trois tableaux, mais un théâtre unique : une « cathédrale marécageuse » dédiée au culte d’une nature sauvage, splendide et impitoyable, qui, jusqu’ici, mais pour combien de temps encore, s’est toujours montrée plus puissante que la convoitise humaine.
Réaliste dans ses moindres détails et proposant même quelques-uns des dessins du cartographe et membre de l’expédition de 1564, Jacques Le Moyne de Morgues, le roman se construit autour de personnages croqués au plus près de leur psychologie et de leurs ambivalences. Epique, violent, sans concession, il emmêle, dans un fil narratif qui n’a rien à envier à la puissance du grand fleuve, l’Histoire, l’aventure, le mystère et le nature-writing. Bousculé dans les rapides du récit ou suspendu à la majesté de ses évocations, jamais le lecteur ne sent fléchir sa fascination pour cette contrée envoûtante, dont la magnificence n’a d’égale que son inhospitalité. Une dualité qui imprègne tout le livre, puisque capable d’autant de mal que de bien, la nature humaine y apparaît elle aussi d’une complexité pleine de contradictions. (4/5)
Citations :
Le Moyne reste à l’écart pendant que La Caille parle avec le chef indien. Celui-ci ne cesse de gesticuler, son doigt brandi en signe de menace, la paume tendue devant eux, et l’artiste n’a pas besoin d’interprète pour comprendre ce qu’il est en train de dire.
Ils n’ont pas respecté les termes de leur alliance.
ls ne lui ont pas apporté leur aide durant la bataille.
Ils l’ont trahi.
Tout autour, les yeux de ses guerriers sont durs comme des éclats de pierre.
Les Français prennent congé et quittent le village, s’évertuant à avancer de front dans le corridor aveugle. Le Moyne ne peut chasser de son esprit l’image des yeux du chef indien, gonflés de fureur et marbrés de vaisseaux rougeâtres semblant près de jaillir de leurs orbites.
« Je crois que nous sommes en fâcheuse posture, lâche La Caille en secouant la tête.
– Il n’était pas content.
Tu t’attendais à quoi ? Notre commandant lui avait promis des hommes et des armes pour combattre ses ennemis. J’ai pas mal bourlingué à la surface du monde, mon ami. Et manquer à sa parole est la seule chose universellement condamnée. »
Tout de suite il fait plus frais, et plus sombre, dans ce cours d’eau protégé par une voûte de cyprès et de tupélos. Éclats de lumière et morceaux de bois rident sa surface, et le monde semble ici plus ancien et plus vaste, comme retranché de sa partie moderne, livrée au soleil. Des racines, parfois parsemées de crapauds, en émergent comme des genoux cagneux et paraissent grandir à mesure que les deux frères remontent le courant. Bientôt, elles prennent la forme de massues noueuses et renflées qu’on dirait faites pour fracasser des crânes. Le ruisseau s’élargit et ils continuent à pagayer entre des cyprès poussés dans l’eau, aux souches fripées comme des doigts de pied. Hunter comprend que ces arbres appartiennent à une forêt primaire dissimulée plus loin dans les marais ; certains doivent avoir plus de mille ans.
Le spécimen qui focalisait l’attention de tout le monde avait un énorme corps bien gras et une bouche de dessin animé. C’était un monstrueux poisson-chat à tête plate, capable de gober un homme jusqu’à la taille comme s’il avait une queue de sirène. Les pêcheurs durent se mettre à deux pour le hisser sur la balance. L’homme à l’origine de cette prise miraculeuse portait le bouc, une casquette de base-ball à motif camouflage, un jean coupé sous le genou et des tennis blanches souillées. Apparemment, il conduisait les camions de grumes pour le compte de l’usine. Sur sa casquette, on pouvait lire : RAYONIER, du nom de l’une des entreprises les plus importantes u secteur. Il avait pêché ce poisson-chat dans un trou d’eau de cinq mètres, avec un corps de ligne d’un centimètre de diamètre et un plomb de quatre-vingt-cinq grammes. Le doyen de l’association chargé de la pesée avait les yeux rivés au cadran circulaire de la balance et à la flèche rouge qui affichait en tremblant le poids du poisson mort. Suspendu au crochet, celui-ci ressemblait à un têtard mutant, boursouflé par quelque terrifiant produit chimique que l’usine avait rejeté en amont du fleuve.
« Trente-neuf kilos et trois cents grammes, annonça le juge. À deux cents grammes près, le record était battu. »
Notre père était un homme dur. Il n’était pas du genre à aimer les embrassades ou à donner la main, et rejetait toute marque d’affection. Il avait du mal à exprimer son amour. Pourtant, il y avait des choses qui lui tenaient à cœur. Le fleuve, par-dessus tout, était comme un membre de sa famille et comptait beaucoup plus à ses yeux que n’importe quel lien de chair ou de sang. Les jours où il ne travaillait pas, il nous y emmenait mon frère et moi, et nous installait à la proue, bien peignés et très sérieux comme si on allait à l’église. Et peut-être était-ce là qu’on allait. Dans son église. Une cathédrale marécageuse et irriguée par de multiples ruisseaux, avec un toit feuillu que soutenaient des colonnes de cyprès et de gommiers. Il nous apprenait ses beautés et ses secrets, ses endroits cachés. Et je crois qu’en nous montrant le fleuve – son fleuve – il nous ouvrait son cœur, au moins en partie. C’est comme ça que je savais qu’il nous aimait.
jeudi 28 octobre 2021
[Makine, Andreï] L'ami arménien
Coup de coeur 💓
Titre : L'ami arménien
Auteur : Andreï MAKINE
Parution : 2021 (Grasset)
Pages : 216
Présentation de l'éditeur :
Le narrateur, treize ans, vit dans un orphelinat de Sibérie à l’époque de l’empire soviétique finissant. Dans la cour de l’école, il prend la défense de Vardan, un adolescent que sa pureté, sa maturité et sa fragilité désignent aux brutes comme bouc-émissaire idéal. Il raccompagne chez lui son ami, dans le quartier dit du « Bout du diable » peuplé d’anciens prisonniers, d’aventuriers fourbus, de déracinés égarés «qui n’ont pour biographie que la géographie de leurs errances. »
Il est accueilli là par une petite communauté de familles arméniennes venues soulager le sort de leurs proches transférés et emprisonnés en ce lieu, à 5 000 kilomètres de leur Caucase natal, en attente de jugement pour « subversion séparatiste et complot anti-soviétique » parce qu’ils avaient créé une organisation clandestine se battant pour l’indépendance de l’Arménie.
De magnifiques figures se détachent de ce petit « royaume d’Arménie » miniature : la mère de Vardan, Chamiram ; la sœur de Vardan, Gulizar, belle comme une princesse du Caucase qui enflamme tous les cœurs mais ne vit que dans la dévotion à son mari emprisonné ; Sarven, le vieux sage de la communauté…
Un adolescent ramassant sur une voie de chemin de fer une vieille prostituée avinée qu’il protège avec délicatesse, une brute déportée couvant au camp un oiseau blessé qui finira par s’envoler au-dessus des barbelés : autant d’hommages à ces « copeaux humains, vies sacrifiées sous la hache des faiseurs de l’Histoire. »
Le narrateur, garde du corps de Vardan, devient le sentinelle de sa vie menacée, car l’adolescent souffre de la « maladie arménienne » qui menace de l’emporter, et voilà que de proche en proche, le narrateur se trouve à son tour menacé et incarcéré, quand le creusement d’un tunnel pour une chasse au trésor, qu’il prenait pour un jeu d’enfants, est soupçonné par le régime d’être une participation active à une tentative d’évasion…
Ce magnifique roman convoque une double nostalgie : celle de cette petite communauté arménienne pour son pays natal, et celle de l’auteur pour son ami disparu lorsqu’il revient en épilogue du livre, des décennies plus tard, exhumer les vestiges du passé dans cette grande ville sibérienne aux quartiers miséreux qui abritaient, derrière leurs remparts, l’antichambre des camps.
Le mot de l'éditeur sur l'auteur :
Avis :
Magnifique hommage à son ami disparu et aux Arméniens, « ces copeaux humains, ces vies sacrifiées sous la hache des faiseurs de l’Histoire », ce roman autobiographique n’évoque le génocide d’une part, les persécutions soviétiques d’autre part, qu’avec la plus grande pudeur, d’une manière quasiment toujours indirecte. Une vieille photo de famille, une curieuse poupée aux mains jointes, un vol d’oiseaux migrateurs aperçu de la lucarne d’une cellule… : ces bribes d’humanité forment la trame d’une narration tissée autour de vestiges, de ce qui a survécu à la tourmente et qui laisse entrevoir en creux toute la violence et la furie destructrice desquelles elles réchappent. Ainsi, refusant tout apitoiement, le récit assemble les instants de beauté pure, éphémères mais lumineux, ceux que les survivants, mais aussi un adolescent condamné par la maladie, désignent à l’attention du narrateur, changeant à jamais son regard sur le monde et sur la vie.
Profondément touchant dans sa manière de maintenir l’émotion à distance, le texte est souvent d’une grande beauté, soulignée par la facture classique et soignée de son style. Dans cet univers crépusculaire nimbé du désespoir le plus noir, surgit une étonnante lumière, celle d’un humanisme malgré tout irréductible, qui adoucit la tristesse douce-amère de cette histoire et lui donne une portée universelle.
Un roman magnifique, pudique et respectueux hommage aux Arméniens, mais aussi touchante ode aux valeurs humaines. Coup de coeur. (5/5)
Citations :
« Nous étions un peu la main du destin pour ce Roméo et sa Juliette, non ? Si nous n’avions pas braillé comme des fous, ils ne seraient pas là maintenant, à se balader bras dessus, bras dessous… C’est drôle de penser qu’ils n’apprendront jamais quel dieu hurleur les a sauvés. En fait, toute leur vie aurait été différente si nous n’avions pas fait ce boucan ! »
Je fus flatté que, généreusement, il partageât avec moi le résultat de son stratagème. Mais cet honneur immérité s’effaça vite devant l’idée que je ne parvenais pas à formuler et qui devint soudain très claire. Je compris que nos vies glissaient tout le temps au bord de l’abîme et que, d’un simple geste, nous pouvions aider l’autre, le retenir d’une chute, le sauver. Presque par jeu, nous étions capables d’être un dieu pour notre prochain !
« Tu sais, il y a chez nous un proverbe qui dit : “Honteux de ce qu’il voit dans la journée, le soleil se couche en rougissant.” Ce serait bien si les hommes en faisaient autant. »
« Tiens, le mont Ararat, le sommet sacré des Arméniens, il est en Turquie, à présent. Nous l’avons perdu mais… En fait, ne pas l’avoir nous le rend encore plus cher. C’est ça le vrai choix : posséder ou rêver. Moi, je préfère le rêve. »
Ce type est venu pour soutenir les “combattants de la libération nationale”, c’est ainsi qu’il appelle les Arméniens qui vont être jugés. Il voudrait lancer une révolution immédiate, une lutte armée, “une guerre d’indépendance jusqu’à la dernière goutte de sang”…
— Et que dit Sarven ? (…)
« Sarven a dit : “Écoute, mon brave, si tu regardes la carte de l’Arménie, tu verras d’un côté les Turcs et de l’autre, les Azéris. Et au sud, les Iraniens. Et cela, même avec tes plus beaux projets de liberté et d’indépendance, tu ne le changeras pas. À moins d’envoyer les Arméniens sur la Lune… Donc, avant de lancer une guerre longue et meurtrière, tes camarades devraient étudier un peu la géographie…”
Du même auteur sur ce blog :
mardi 26 octobre 2021
[Bordes, Gilbert] Tête de lune
J'ai aimé
Titre : Tête de lune
Auteur : Gilbert BORDES
Parution : 2021 (Presses de la Cité)
Pages : 320
Présentation de l'éditeur :
Et bientôt avec l’espiègle Salomé qui va s’inviter dans sa folle odyssée pleine de rencontres et d’aventures…
Une fugue magique hors du temps, pour deux enfants en quête de reconnaissance. Et un beau chant d’espérance.
Le mot de l'éditeur sur l'auteur :
Membre de l'Ecole de Brive, il est l’auteur de plus d'une cinquantaine de romans régionaux et historiques. Il a obtenu le prix RTL Grand Public pour La Nuit des hulottes et le prix Maison de la Presse pour Le Porteur de destins. Grand amoureux de la nature, il a notamment publié La Garçonne et de Chante, rossignol aux Presses de la Cité.
Retrouvez ici l'interview de Gilbert Bordes en Avril 2019.
Avis :
Gilbert Bordes a choisi une histoire pleine de tendresse pour nous emmener dans son univers de prédilection : l’enfance en terre de nature. Loin de la ville et de l’hyper-connectivité, l’écrivain nous propose une sorte de bain de jouvence, une plongée dans l’authenticité simple du contact avec la nature, tout ce qu’il a connu enfant et qu’il continue d’apprécier, sur les bords de Loire, ou, comme ici, en terre de Corrèze. Au travers de son personnage, c’est aussi l’écrivain qui rêve de fugue, loin de cette vie moderne qui s’est développée hors-sol, oubliant dans la virtualité les plaisirs les plus simples et les plus instinctifs, compliquant si bien le quotidien que plus personne ne saurait même survivre en milieu naturel, et, surtout, déshumanisant dramatiquement nos relations à autrui, en particulier en ce qui concerne les plus faibles et les personnes âgées.
Cette nostalgie profonde lui a ainsi dicté un conte comme hors du temps, une échappée pour quelques personnages meurtris et assoiffés d’humanité, enfin une histoire attachée à son rêve d’espérance. Entamée avec une tendresse touchante pour ses trois abandonnés, l’enfant, le vieillard et le chien, la narration nous emmène dans le périple aventureux de robinsons perdus sur le plateau désertifié de Millevaches, avant de nous jeter dans l’accélération des péripéties provoquées par quelques protagonistes toxiques. Le tout pourra paraître plutôt léger, peut-être un peu convenu et parfois même assez improbable, mais Tête de lune n’en constitue pas moins un joli récit, à la lecture fluide et agréable, dont les bons sentiments et le rythme soutenu ne manqueront pas de séduire, entre autres, les nostalgiques des histoires d’antan pour la jeunesse, comme par exemple Belle et Sébastien.
Ce dernier roman s’inscrit en droite ligne de ces gentilles et sympathiques histoires proches du terroir, de la nature et de l’enfance, auxquelles l’auteur nous a agréablement accoutumés. La tendresse qui l’imprègne et ses aventures sans violence en font une lecture pour tous les âges, à déguster comme un bon petit téléfilm familial. (3/5)
Du même auteur sur ce blog :
dimanche 24 octobre 2021
[Reza, Yasmina] Serge
J'ai beaucoup aimé
Titre : Serge
Auteur : Yasmina REZA
Parution : 2021 (Flammarion)
Pages : 240
Présentation de l'éditeur :
Le mot de l'éditeur sur l'auteur :
Avis :
« Serge » est d’abord l’histoire d’une famille, avec ses dissensions, ses jalousies et ses conflits, mais aussi ses liens indéfectibles. Le temps a passé depuis les jeux insouciants de l’enfance, les trois Popper se sont frottés à la vie, et, tandis que la génération de leurs parents s’éteint sans bruit, leur tendant le miroir de leur prochain déclin, ils commencent à décompter leurs échecs et leurs renoncements, s’observant les uns les autres avec un esprit d’autant plus critique qu’il les renvoie à leur propre image et à leurs angoisses personnelles. Yasmina Reza impressionne par l’intelligence et la parfaite justesse de son observation railleuse. Elle nous livre une satire féroce, où l’ironie corrosive laisse parfois percer quelques bouffées de tendresse, au contact de Lucas, cet enfant dont Jean semble être le seul à détecter la différence et la fragilité, ou encore de Maurice, le vieux cousin malade et impotent auquel Jean rend visite avec une affection triste.
L’incapacité des personnages à relativiser leurs petits maux et leurs querelles apparaît dans toute sa dérision, lorsqu’en visite au camp d’Auschwitz, désabusés par l’ahurissant décalage entre la réalité historique des lieux et la décontraction des hordes de touristes en tongs dont rien ne semble décourager la manie des selfies, ils se retrouvent plus émus de leurs dissensions immédiates qu’atteints par la mémoire de l’horreur la plus absolue. Le constat de l’écrivain est implacable : l’homme n’est au fond capable de ne se préoccuper vraiment que de ce qui le touche intimement, peu importe les cataclysmes passés, présents ou futurs, s’ils ne le menacent pas directement. Alors, faudra-t-il attendre la réalisation du pire pour l’un des Popper, pour qu’enfin, la fratrie se ressoude ?
Yasmina Reza signe ici un livre terriblement désenchanté sous son ironie ravageuse. D’une plume acide, elle y décape les innombrables faux-semblants dont nous habillons le vide et le ridicule de nos égocentrismes. Un roman intelligent, dérangeant, et profondément tragique sous la raillerie. (4/5)
Citations :
Les conjoints interagissent, la transmutation qui en résulte est aussi imprévisible que le visage de leur descendance.
Est-ce le jour, la nuit ? La neige a laissé sa trace partout, sur les traverses du chemin de fer, sur les remblais de terre. Elle habille la toiture noirâtre de centaines de pointillés blancs comme une dentelle géométrique. Dans une salle sombre de l’exposition française, projetée en grand sur un mur, cette photo du portail d’entrée de Birkenau, un crépuscule noir et blanc un peu rougeoyant, prise de l’intérieur du camp au milieu des rails. À hauteur du ciel et du poste de garde vitré l’espace est barré de fils électriques et de fils barbelés. Le long de ces portées sinistres on peut lire en lettres blanches brillantes et glaciales comme la diapositive elle-même « Vernichtungslager ». « Toi qui sais l’allemand qu’est-ce que ça veut dire ? » « Nicht, c’est : rien, néant. Vers le rien, vers le néant. Cela veut dire camp d’anéantissement. » Dans Charlotte Delbo, Le Convoi du 24 janvier.
En une seule image, l’allégorie de la désolation happe le visiteur. Supériorité des images sur le réel. Le réel a besoin d’interprétation pour rester réel.
Souviens-toi. Mais pourquoi ? Pour ne pas le refaire ? Mais tu le referas. Un savoir qui n’est pas intimement relié à soi est vain. Il n’y a rien à attendre de la mémoire. Ce fétichisme de la mémoire est un simulacre. Quand le président avait fait son ineffable itinérance mémorielle, un chauffeur de taxi m’avait fait ce résumé « Hier soir j’ai vu le reportage à Verdun. On leur dit quinze mille morts sous vos pieds, les boyaux à l’air ! Les touristes extasiés. Ils viennent avec leurs gosses : grand-papa s’est battu pour toi. Pour moi ? Et comment il me connaît ? dit le gamin. »
Les Fouéré ont pris un chien. Rien d’étonnant. Ils font partie des couples qui finissent par s’ajuster dans la vieillesse. Après des années de chaos ils finissent main dans la main avec voyages, chien, parfois une masure quelque part. Toute sa vie Nicole avait aspiré à un autre que Jean-Louis et quand ils ne se faisaient pas la gueule les Fouéré s’étripaient avec des formules humiliantes. Mais un beau jour ils ont perçu le petit coucou de la mort et ils ont posé les armes. On accepte que la vie soit un truc de solitude tant qu’il y a de l’avenir.
Je n’ai pas su me comporter affectivement dans ces lieux aux noms cosmiques, Auschwitz et Birkenau. J’ai oscillé entre froideur et recherche d’émotion qui n’est autre qu’un certificat de bonne conduite. De même me dis-je, tous ces souviens-toi, toutes ces furieuses injonctions de mémoire ne sont-ils pas autant de subterfuges pour lisser l’événement et le ranger en bonne conscience dans l’histoire ?
Le père disait, il a la bougeotte, toujours mieux ailleurs ! Ça n’augurait rien qui vaille à ses yeux. Il ne voyait que vanité dans cette agitation, il ne voyait que folie ou maladie. Moi je n’ai jamais cru qu’il s’agissait d’une simple agitation. Les oiseaux ne sont ni agités ni fous. Ils cherchent le meilleur endroit et ne le trouvent pas. Tout le monde croit à un meilleur endroit.
Dans la chambre nous nous taisons. Chacun des deux côtés du lit dont les barreaux sont à présent baissés. Me revient en mémoire la descente allègre des Champs-Élysées derrière l’homme carré en manteau de laine de chameau, nous étirions nos jambes pour rester dans ses pas, jusqu’au Normandie où Kirk Douglas nous attendait avec un esquimau. Se peut-il que Serge revoie aussi ce trajet de pure joie ?
Une image suffit pour faire tenir un homme entier.
vendredi 22 octobre 2021
[Kiefer, Christian] Fantômes
Coup de coeur 💓💓
Titre : Fantômes (Phantoms)
Auteur : Christian KIEFER
Traductrice : Marina BORASO
Parution : en anglais (Etats-Unis) en 2019,
en français (Albin Michel)
en 2021
Pages : 288
Présentation de l'éditeur :
Printemps 1969 : de retour du Vietnam, et hanté par les fantômes de la guerre, John Frazier cherche son salut à travers l’écriture d’un roman. En s’emparant accidentellement du destin de Ray, le jeune écrivain ignore tout des douloureux secrets qu’il s’apprête à exhumer.
En revenant sur l’histoire méconnue de dizaines de milliers de Nippo-Américains internés dans des camps après l’attaque de Pearl Harbor en 1941, Christian Kiefer tisse un drame familial poignant et lumineux, qui interroge notre rapport intime à la mémoire et au passé.
Le mot de l'éditeur sur l'auteur :
Avis :
Près de 120 000 Japonais et Américains d’origine japonaise furent déportés en 1942 dans des camps de concentration aux Etats-Unis. Les deux tiers étaient des Nisei, des Japonais de seconde génération et donc de nationalité américaine, dont une partie s’engagea sous la bannière étoilée. Après plusieurs années de détention dans de pénibles conditions, leur libération s’accompagna de grandes difficultés de réinsertion. Beaucoup avaient tout perdu, mais ils restèrent aussi longtemps en butte à l’agressivité et à la discrimination. Il leur fallut attendre les années quatre-vingt pour que l’État américain commence à reconnaître ce préjudice et ses causes raciales, dans une nation depuis longtemps en proie au fantasme du péril jaune, et rendue paranoïaque par la guerre.
Fort d’une impressionnante documentation, l’auteur s’est inspiré de ce drame historique pour nous livrer une histoire romanesque, si habilement construite qu'elle prend toutes les apparences d’un récit autobiographique. En totale empathie avec des personnages plus vrais que nature, le lecteur est d’autant plus happé par la narration qu’il se retrouve bluffé par son absolue authenticité apparente, dans un exercice de parfaite illusion littéraire. Bâti autour d’une thématique historique déjà dramatique en soi, le récit crée une spirale infernale de plus en plus poignante, tandis que le narrateur découvre pas à pas, la plupart du temps quand ils semblent perdus à jamais, les secrets portés leur vie durant par les autres protagonistes. Tous les personnages sont restitués avec une grande finesse psychologique, leur logique et leurs motivations ne s’éclairant que progressivement, à mesure que le temps passé, la disparition des uns et des autres, et le poids des doutes et de la culpabilité, favorisent enfin la prise de recul et la libération de la parole.
Enchanté par la perfection architecturale du récit, par la profondeur des personnages et par la vérité de la restitution historique, c’est avec émotion que l’on se plonge dans cette narration addictive aux effets dramatiques en cascade. Rares sont les créations romanesques suscitant une telle impression de réalité. Coup de coeur. (5/5)
Citations :
J’ignore quel est le nombre des décès au Vietnam dont je suis responsable, ce qui est une manière adroite de dire que je ne sais pas combien de gens j’ai tués. (…)
Que dire de tous ces gens que j’avais assassinés ? Ils avaient eu un nom, tous ces gens, et ils avaient reçu de l’amour, ils avaient eu un père et une mère, des grands-parents, certains parmi eux étaient même des enfants. Et moi je n’avais eu qu’à lancer des appels radio pour que les Phantoms arrivent avec leur napalm et leur phosphore blanc, leurs roquettes Zuni et Sidewinder, et que tous ces individus se transforment en colonnes de cendres emportées par les pluies de la mousson. Ces gens à qui l’on avait donné un nom et de l’amour.
Ray a continué à porter l’uniforme, comme si, en le gardant toujours sur lui, il lui était possible de l’incorporer à sa chair et de devenir enfin un véritable Américain. N’était-ce pas dans ce but qu’il avait boutonné la chemise militaire sur son torse nu, enfilé le pantalon et lacé les bottes ? Dans ce but qu’il avait tiré sur les nazis en France, regardé ses camarades se faire réduire en charpie jour après jour et nuit après nuit, dans tout le sud de l’Europe ? Est-ce que cela ne faisait pas enfin de lui, au bout du compte, un Américain ?
mercredi 20 octobre 2021
[Stassart, Gilles] Grise Fiord
J'ai beaucoup aimé
Titre : Grise Fiord
Auteur : Gilles STASSART
Parution : 2019 (Rouergue)
Pages : 240
Présentation de l'éditeur :
Avec ce grand roman du peuple des glaces où l’homme et le chien défient l’ours, l’orque et le béluga, Gilles Stassart ranime l’esprit du loup noir, Amarok le bien nommé, qui veille à la survie des Inuits. Guédalia, l’homme qui a goûté à la culture des Blancs et traverse l’Arctique comme une conscience perdue, saura-t-il trouver son chemin dans les périls de la mer gelée?
Le mot de l'éditeur sur l'auteur :
Avis :
Aborigènes d’Australie, Evenks de Sibérie, Samis de Laponie, tribus amérindiennes bien sûr, mais tant d’autres encore : la main-mise « occidentale » a produit partout les mêmes désastres, imposant la substitution de son mode de vie consumériste aux autres types de relation au monde. Chaque fois, la conséquence est la déliquescence de ces peuples anciens, amenés à la détestation d’eux-mêmes par l’humiliation de leur destruction et par la perte de leur repères identitaires. Alcoolisme, toxicomanie, délinquance et taux record de suicide : le Nunavut n’échappe pas à la malédiction apportée par les blancs.
L’histoire de Guédalia est l’occasion de découvrir le sort de ces familles inuites, déportées à Grise Fiord en 1953 par le gouvernement canadien préoccupé de sa souveraineté en Haut-Arctique en pleine guerre froide. Une souveraineté aujourd’hui toujours hautement stratégique, puisque cette zone inhabitée, loin au nord du cercle polaire, regorge de ressources minières et pétrolières, et, surtout, donne sur le futur passage que le réchauffement climatique et la fonte de la banquise promettent d’ouvrir entre l’Asie et l’Europe, par le nord de l’Amérique. Face à ces enjeux, l’acculturation du peuple inuit passe aisément et majoritairement pour un dommage collatéral.
Perdu dans l’univers des blancs, Guédalia tente bien de renouer avec l’esprit de son peuple. Mais lui qui s’est frotté au monde occidental doit réapprendre tout ce qui fondait la vie de ses ancêtres. Sa fuite vers le passé prend vite les dimensions d’une aventure de tous les dangers, vers ce qui pourrait bien ne plus être qu’un mirage inaccessible. S’il ne trouve pas sa place au sein des villes canadiennes, il n’est pas plus adapté à ce qu'il reste de vie libre et sauvage dans les étendues arctiques. A concilier les contraires, l’on finit par n’être plus rien, avalé par le néant.
En nous racontant l’agonie du peuple et de la culture inuits sous la pression de notre monde consumériste, c’est notre appauvrissement général, par le pillage des ressources naturelles, la destruction de la vie sauvage et l’uniformisation des modes de vie que ce livre pointe du doigt. Un récit mélancolique, où la débâcle de la banquise, si singulièrement consécutive à celle des peuples qui avaient su l’habiter et la respecter, semble emporter dans ses eaux tout ce que l’humanité entière continue allégrement à détruire. (4/5)
Citations :
Notre langue n’est pas seulement orale, c’est aussi une écriture dont les signes formant l’alphabet sont la nature qui nous environne. C’est notre livre à nous, comme la Torah est celui des Juifs.
L’entrée du sanctuaire du Nunavut intérieur, un passage naturel, un goulet incontournable pour toutes les espèces. La morue, les phoques barbus, du Groenland, annelés, les morses, les narvals, les bélugas, les baleines boréales, les orques et les oiseaux aussi, les sternes arctiques, les mouettes, les oies des neiges… Un espace luxuriant où tous et tout convergent et que tous convoitent pour sa richesse, pour ses accès, les routes qu’il distribue. Une zone de prédation et de reproduction, où l’on s’entre-tue, où l’on tente de s’échapper. Jack adorait cette bande de mer. (…)
À mon sens, la destruction de ce sanctuaire et de la culture inuite était bien évidemment un désastre pour les autochtones mais aussi pour l’ensemble de l’humanité qui perd ainsi la diversité de ses relations au monde.
Les Inuits perçoivent leur environnement naturel, la faune et la flore comme le prolongement de leur corps physique. Cet espace qui s’étale devant mes yeux est un morceau de moi. J’en suis responsable, comme je suis responsable de mon corps devant les générations qui en découleront. Comment ne pas essayer de faire passer cette idée, convaincre les climatosceptiques, les fous de la grande industrie, qui s’apprêtent à sacrifier l’avenir de leurs rejetons, voire le leur ? Comment l’humanité a-t-elle fait pour arriver à un tel niveau de détestation d’elle-même ?
Depuis, la banquise a perdu la moitié de sa surface. Bientôt la zone sera à découvert, les eaux libres. Ici se croiseront, sans discontinuer, allers et retours, des porte-conteneurs. Toutes les marchandises assemblées dans les usines asiatiques iront par Lancaster satisfaire la fringale des consommateurs de la côte est des États-Unis, de l’Europe, pourquoi pas de l’Afrique. Le goût du profit est plus fort que le plus fort des ours polaires. Tout ce qui ne crèvera pas s’adaptera à cette nouvelle ère. Il n’y aura, cette fois, plus aucun refuge, plus de pôles.
lundi 18 octobre 2021
[Halls, Stacey] Les sorcières de Pendle
J'ai moyennement aimé
Titre : Les sorcières de Pendle
(The Familiars)
Auteur : Stacey HALLS
Traductrice : Fabienne GONDRAND
Parution : en anglais (Etats-Unis) en 2019
en français en 2020 (Michel Lafon)
et 2021 (Pocket)
Pages : 448
Présentation de l'éditeur :
Mais quand s'ouvre un immense procès pour sorcellerie à Pendle, tous les regards se tournent vers Alice, accusée comme tant d'autres femmes érudites, solitaires ou gênantes. Fleetwood fera tout pour arracher, coûte que coûte, sa bienfaitrice à la potence…
Un mot sur l'auteur :
Avis :
Parmi les plus célèbres d’Angleterre, ce procès pour sorcellerie est inhabituel par le nombre – onze - des sorcières exécutées en même temps. Il s’inscrit dans un contexte général de chasse aux contestataires religieux, lancée par un Jacques 1er soucieux d’imposer l’Église anglicane, et à ce point préoccupé par la sorcellerie qu’il a lui-même écrit un ouvrage incitant à pourchasser ses adeptes. Restées dans les mémoires, les sorcières de Pendle ont, depuis, largement inspiré la littérature, suscité récemment quelques pétitions pour leur réhabilitation, et font aujourd’hui le bonheur de l’activité touristique et de l’industrie du souvenir locales…
Si Stacey Halls a le mérite de nous faire découvrir ces événements du 17e siècle en Angleterre, elle s’en est toutefois si librement inspirée qu’on en reste largement sur sa faim sur le plan historique. Faute en est à la narration totalement centrée sur le personnage imaginaire de Fleetwood, dont les préoccupations sentimentales et procréatrices occultent presque tout le reste. A la fois bien trop moderne et d’un cruel manque d’épaisseur qui finit par la rendre exaspérante de naïveté, elle fait du récit une romance trop inconséquente et simpliste, qui, non contente de rejeter sa thématique historique à l'arrière-plan, crée une dérangeante sensation d’anachronisme. Reste un texte fluide et agréable, sans grande originalité de style, qui, après la lenteur de sa première moitié, s’anime des tentatives de son héroïne d’empêcher l’inéluctable, avant une conclusion sucrée à souhait.
Cette exploitation très légère et romanesque d’une thématique dans le vent séduira davantage les amateurs – à vrai dire, plutôt les amatrices ? -, de romance que de roman historique. Une déception pour ma part, qui m’aura néanmoins fait découvrir l’existence d’un intéressant fait d'histoire. (2/5)
Citation :